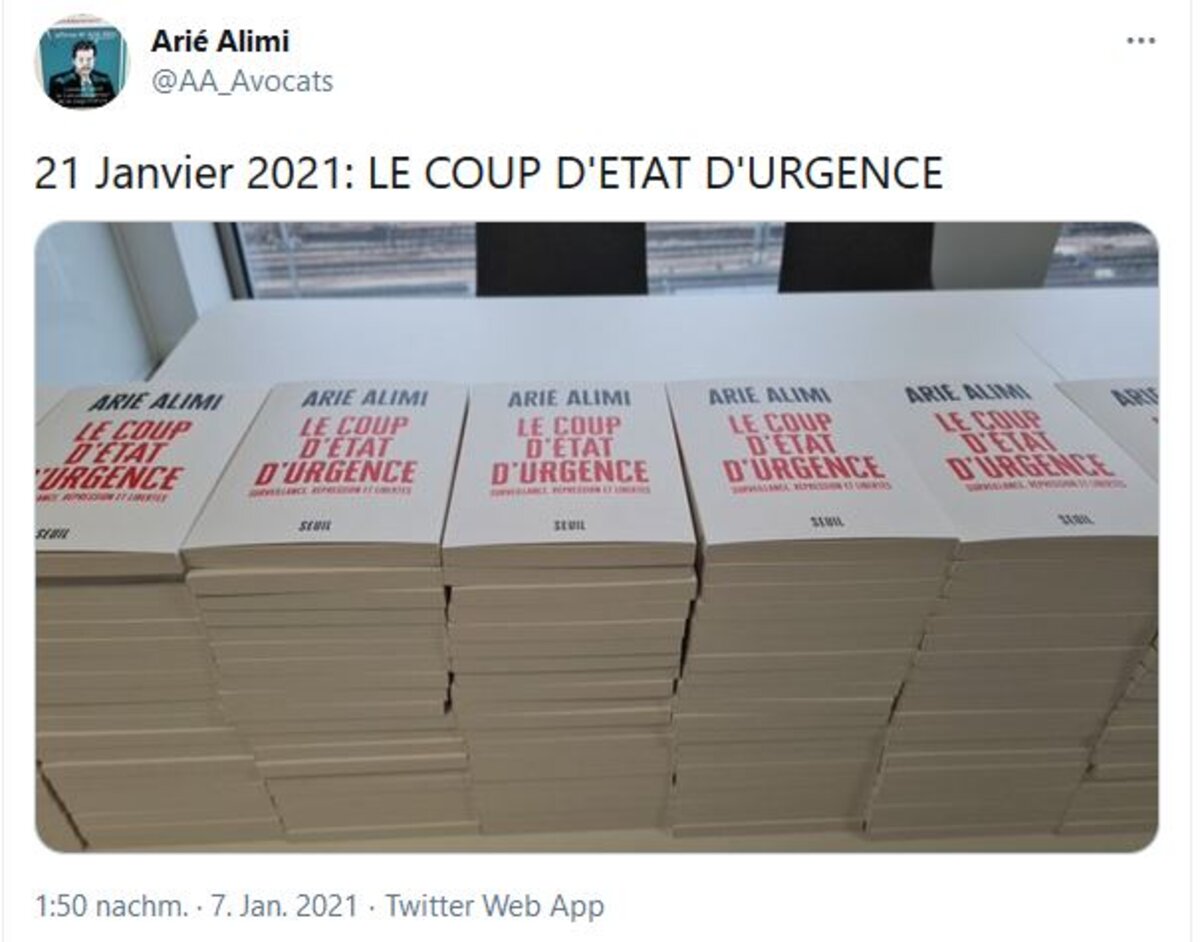
Agrandissement : Illustration 1

Si l’on n’y prend garde, insidieusement, parce que « les circonstances » l’exigent, ce régime d’exception contamine peu à peu le droit commun, « à la manière d’une tache d’huile » estime Arié Alimi, sans garantie de retour à l’état précédent.
État d’exception par définition, l’état d’urgence remonte à la loi du 3 avril 1955, qui organisait à l’origine « l’assignation à résidence administrative des militants politiques ou de toute personne de constituer une menace pour la sécurité ou l’ordre public ». Utilisé à huit reprises depuis (1955, 1958, 1961-1963, janvier 1985, octobre 1986, octobre 1987, novembre 2005, novembre 2015 à fin octobre 2017), c’est la première fois en mars 2020 qu’il est associé à un état de crise sanitaire. Par ordonnance du 25 mars 2020, prise par le Gouvernement dans le cadre d’une habilitation votée au Parlement dans la loi, l’état d’urgence sanitaire a été décrété, d’abord jusqu’au 11 mai puis prorogé jusqu’au 10 juillet, suivi d’une loi organique transitoire jusqu’au 30 octobre où il a de nouveau été décrété, jusqu’en février 2021, prorogé jusqu’en juin 2021… pour l’instant ! Il permet au Gouvernement de prendre nombre de dispositions, notamment en matière de restrictions des libertés fondamentales, sur lesquelles en temps « normal » les Français, ces « Gaulois réfractaires » se seraient promptement insurgés : limitation des rassemblements sur la voie et lieux publics ; limitation de déplacements ; mesures de confinement de la population ; couvre-feu à 20h sectorisé puis national à 18h, etc.
« L’un des mécanismes essentiels du passage du droit commun à l’état d’urgence, qu’il soit sécuritaire ou sanitaire, repose sur la façon dont chaque individu est appréhendé par l’État. Dans le droit commun, tout individu est sujet de droit. Il est paré d’un masque juridique protecteur qui lui permet d’avoir un état civil, une capacité juridique, de conclure des contrats, de saisir la justice. Lorsqu’il est interpellé par la police et jugé devant un tribunal, il dispose de droits. (…) Il bénéficie d’un grand nombre de libertés, notamment celles d’aller et venir, d’avoir une vie privée ou de travailler » précise Arié Alimi dans un intéressant chapitre L’état d’urgence sanitaire, ou l’avènement du « sujet virus ». Pendant l’état d’urgence sécuritaire de 2015, « un grand de ces libertés sont profondément restreintes ». Le passage à l’état d’urgence sanitaire « implique un mécanisme similaire mais à plus grande échelle, puisque toute la population est également privée, du jour au lendemain, de sa liberté d’aller et venir, de son droit à la vie privée, et, pour certains, de leur droit au travail ou à la liberté d’entreprendre. (…) Pour appliquer de telles mesures à l’ensemble de la population, il a fallu considérer que toute personnes était susceptible d’être contaminée et contagieuse. C’est une véritable identification au virus lui-même qui s’est alors mise en place à travers le discours scientifique et la décision politique. Le sujet virus a remplacé le sujet de droit et il peut, dès lors, se voir appliquer l’ensemble des mesures de l’état d’urgence sanitaire ».
Que ce soit par l’utilisation controversée et déclarée illégale par le Conseil d’État d’utiliser des drones pour surveiller l’application des mesures de confinement au printemps dernier (déclaration d’illégalité dont beaucoup de préfectures de police se sont allègrement affranchies) ; ou l’incitation à télécharger l’application « Stop Covid » puis « Tous anti Covid » habituant peu à peu la population au traçage des smartphones, Une fois que la population est habituée à cette nouvelle réduction de ses libertés, une fois que ces techniques sont devenues partie intégrante de nos vies, la mesure de surveillance persiste définitivement, rendant impossible tout retour en arrière. L’extension de la tache d’huile répond ainsi à un deuxième mécanisme, celui de l’effet cliquet : lorsqu’une liberté ou un droit a disparu ou a été restreint, le retour en arrière est pratiquement impossible ».
Des abus ont été constatés – et dénoncés par des avocats – notamment autour du régime de détention provisoire, lequel doit pourtant être sévèrement encadré. Pourtant, l’ordonnance prise en matière de procédure pénale et une circulaire du ministère de la Justice prise en application a prolongé automatiquement tous les titres de détention provisoire en mars-avril 2020, lors du désormais célèbre premier confinement (« nous sommes en guerre »…). Une mesure jugée par beaucoup d’avocats et de magistrats comme anticonstitutionnelle, pourtant validée par… le Conseil constitutionnel. Le même a censuré l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars, jugé contraire à l’article 66 de la constitution, selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».
« La question n’est pas tant de se demander ce qui restera de l’état d’urgence sanitaire après sa fin, mais plutôt de s’interroger de ce qu’il restera du droit commun », questionne l’avocat Arié Alimi dans sa conclusion. « Le monde d’après, c’est celui dans lequel nous vivons déjà. Un monde de l’urgence et de l’exception ».
Un livre salutaire pour éviter l'aveuglement lié, justement, à l'urgence et à cette exception, qui deviennent progressivement la règle...
F.S.
Arié Alimi, Le coup d’état d’urgence. Seuil, janvier 2021.



