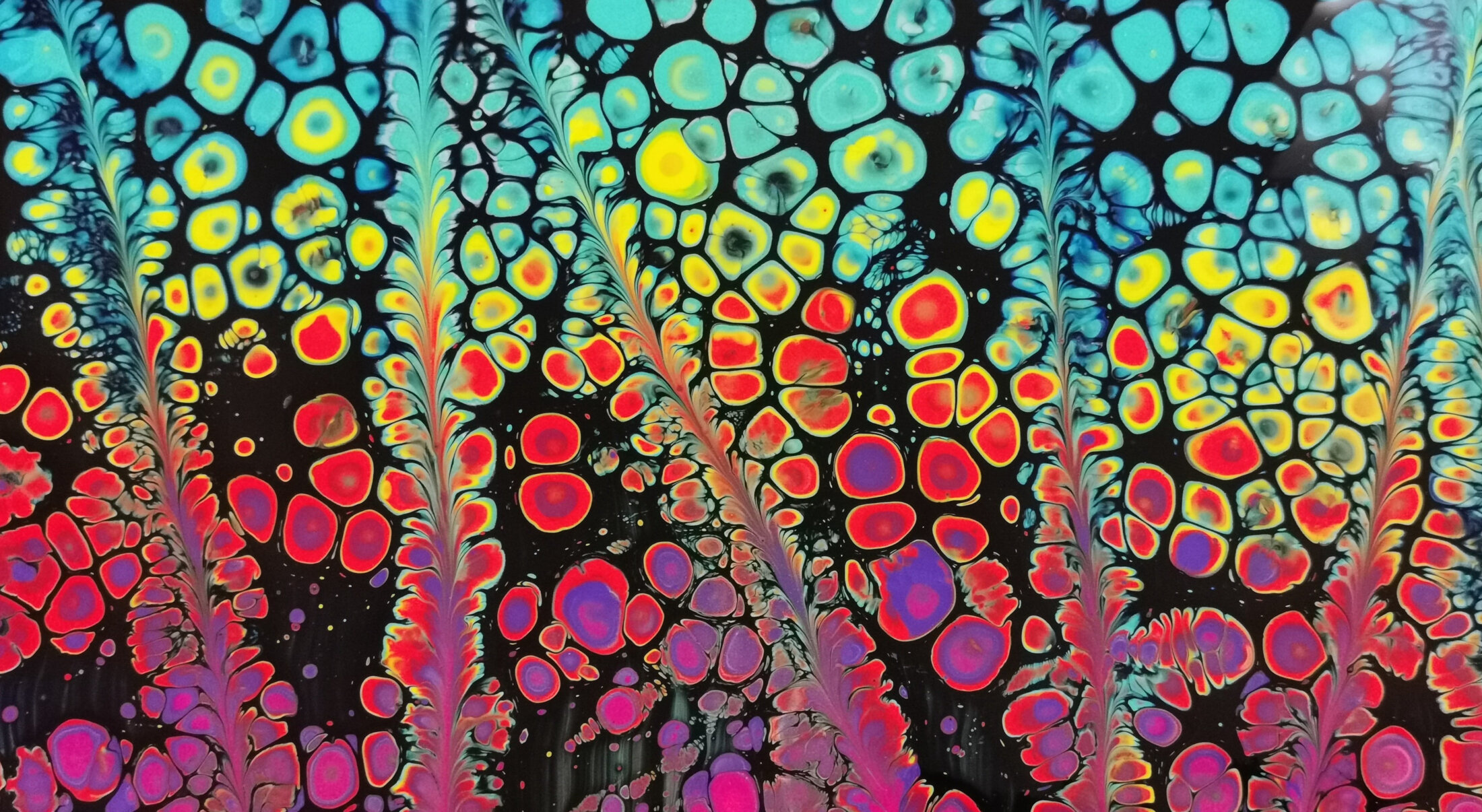Pour l’intellectuel cherchant à s’engager dans le débat public, il existe cinq modes principaux d’intervention.
- Le premier consiste à identifier, dénoncer et déconstruire les paroles ou les actes qu’il considère comme irrationnels ou dont les axiomatiques paraissent peu désirables.
- Le second consiste à diffuser, expliquer, valoriser et articuler entre eux les champs du savoir dans lesquels il possède l’expertise la plus pointue ; c’est ce que l’on appelle communément la vulgarisation.
- Le troisième consiste quant à lui à utiliser une capacité à voir plus loin, à embrasser une complexité plus grande et à imaginer des mondes alternatifs plus riches pour proposer de nouvelles solutions aux problèmes actuels ou anticiper sur les problèmes futurs.
- Le quatrième est celui de la lutte politique, c’est à dire de la mise au service des ressources intellectuelles évoquées précédemment au service d’une cause dont les enjeux dépassent de beaucoup les cercles savants.
- Le cinquième, enfin, correspond au commentaire ou à l’éditorial, rendus possibles par la reconnaissance sociale d’une légitimité à produire un discours qui n’aurait plus besoin de faire la démonstration de son utilité, de sa cohérence ou de sa vraisemblance. Il s’agit généralement la situation offerte aux intellectuels politiquement alignés avec l’ordre dominant.
Jusqu’ici la vocation de ce blog était largement alignée sur le premier mode d’intervention, forme d’éxutoire pour un chercheur inquiet pour l’avenir et insatisfait par le peu d’impact de son travail quotidien sur des problèmes sociétaux qui définissent bon gré mal gré la finalité de ce travail. D’une certaine manière, avec le tollé national suscité par mon précédent billet, la mission est accomplie: des milliers de Tweets, des dizaines d’articles couvrant la quasitotalité du spectre éditorial de la presse francophone et, pour finir, moins de 4 jours plus tard, une plainte déposée par Gérald Darmanin.
Quoi qu’il advienne, après avoir pris le temps de réfléchir, j’ai décidé que cet épisode devait être l’occasion de tourner une page et de modifier ma façon d’intervenir dans le débat public. Outre que je n’ai ni les moyens, ni les soutiens, ni l’énergie nécessaires pour m’engager dans l’interminable série de convocations, d’auditions et de procès promise à ceux qui blasphèment la République, j’ai pu constater combien ce mode d’engagement provocateur peut exacerber les divisions sans parvenir à élever d’un iota la qualité des débats. Au contraire. Je laisse donc l'analyse des errements du gouvernement à la rédaction de Mediapart et de ses homologues qui font ça infiniment mieux que moi.
En tant que blogueur, la dénonciation provocante du système en place (ou de celui qui se met en place) est sans doute le moyen le plus simple —si ce n’est le seul— d’accèder à une viralité maximisant à très court terme l’impact d’un écrit. Mais quid du long terme? Quelques mois plus tard, ma critique contribue-t-elle encore à structurer la pensée de qui que ce soit? Certes, des dizaines voire des centaines de milliers de personnes ont lu le billet ou en ont entendu parler, mais seulement parce qu’il s’inscrivait dans un sillon déjà largement creusé par l’interminable débat sur les violences policières. C'est ainsi qu'il est soudainement sorti du tréfond des serveurs de Médiapart pour symboliser le supposé déni de solidarité de la part d’une “islamogauche” fantasmée par une “cathodroite” bien réelle.
Quitte à dédier une partie de mon temps libre à écrire des billets de blog avec l’espoir un peu coupable de passer encore la barre de la viralité, j’aimerais autant que ces derniers soient instrumentalisés par ma famille politique plutôt que par ses adversaires. Et quitte à ne jamais retrouver la moindre viralité, je préfèrerais que cet effort contribue à structurer une pensée à long terme et un projet alternatif plutôt qu’à alimenter la dénonciation éternelle d’un système qui glisse de toute manière à tombeau ouvert dans le sanibroyeur de l’humanité.
Ce blog deviendra donc un espace exclusivement dédié au troisième mode d’engagement consistant proposer de nouvelles idées et à imaginer une alternative au futur promis à nos sociétés par la corruption intellectuelle et la léthargie conceptuelle des partis de pouvoir.
Sans transition, je propose donc une première idée: celle de l’augmentation et de la refonte partielle des “aides à la presse” qui (ne) représentaient (que) 870 millions d’euros en 2020.
Tout le monde s’accorde à dire qu’une grande démocratie ne saurait vivre sans une presse indépendante, qui soit à la fois pluraliste et de qualité. Et malgré la dérive plus ou moins spectaculaire de certains titres, on peut également s’accorder sur le fait qu’il existe dans notre pays de nombreux organes de presse qui font un travail remarquable couvrant un large spectre de sensibilités politiques. De Mediapart à La Croix en passant par le Figaro, le Monde ou Libération, pour ne citer qu’eux, il existe encore dans notre pays une offre pléthorique et une grande majorité de journalistes soucieux des règles de déontologie qui définissent leur métier.
Malheureusement, l’existence d’une presse de qualité ne suffit pas: encore faut-il qu’elle soit lue! Et c’est à ce niveau que le bât blesse le plus: l’offre peine à trouver sa demande. De nombreux foyers autrefois abonnés à plusieurs titres se contente aujourd’hui des informations “gratuites”, qu’elle soient sous format papier, en ligne ou dispensées par les journaux télévisés. Pour résoudre ce problème, il pourrait être tentant de simplement mieux subventionner les titres de presse payants afin de réduire leur prix en kiosque et/ou de les affranchir des annonceurs publicitaires — voire des investisseurs prêts à perdre de l’argent pour participer à la “fabrique de l’opinion”.
Cependant, ces subventions posent un double-problème. D’une part, elles impliquent une emprise directe de l’État qui doit juger quels titres méritent ou nécessitent d’être le plus soutenus. Or, comme le film les “Nouveaux chiens de garde” l'illustre, à tort ou à raison, les citoyens se méfient tout autant des dépendances publiques que des dépendances privées lorsqu’il s’agit de la presse. D’autre part, parce qu’elles agissent sur l’offre (dans la droite ligne de la logique libérale), leur pouvoir incitatif reste très faible sur la demande qu’il s’agit de stimuler.
Ayant fait ce constat, je propose de réviser le système d’aides à la presse de façon à soutenir la demande de façon bien plus active. Cela peut se faire de différentes manières, mais il me semble qu’une possibilité serait d’offrir à chaque citoyen une allocation-lecteur d'une dizaine ou d'une vingtaine d'euros lui permettant de s'abonner à un ou deux titres de presse sans réduire son pouvoir d'achat. Pas besoin d’être grand clerc pour prédire que cela renforcera considérablement la demande en créant ce que les économistes appellent un “coût d’opportunité” pour les ceux qui n’utiliseraient pas la somme à disposition. Dans ce dernier cas, l’allocation pourra être redistribuée comme une subvention classique aux organes de presse, minimisant ainsi la discontinuité avec le système précédent. En plus de réduire les inégalités d'accès à l'information, l’autre avantage d’une telle mesure serait de renforcer considérablement le contrôle démocratique sur celle-ci, puisque les lecteurs eux-mêmes détermineraient une partie significative de la dotation étatique en matière d’aide à la presse.
Certes, le catalogue des titres éligibles continuera à dépendre de l’État, mais on peut imaginer deux mécanismes supplémentaires pour éviter que la gestion de ce catalogue soit contaminée par des considérations politiques. Premièrement, cette éligibilité pourrait être décidée de façon transparente par une commission de journalistes, de juristes et si besoin d’experts issus de la société civile suivant une charte excluant strictement la discrimination des lignes éditoriales et autres motifs contraire au droit de la presse. Deuxièmement, les titres candidats pourraient proposer à leurs lecteurs d’appuyer leur entrée au catalogue de façon à faciliter le travail de cette commission en déclenchant automatiquement l’examen des candidatures bénéficiant d’un nombre suffisant d’appuis.
Dans les cas rares où l’entrée au catalogue ne serait pas accordée, une justification claire et fondée devra être donnée, ainsi que des recommandations dans l’optique d’une possible qualification ultérieure. Enfin, une procédure d’appel devra donner aux représentants des titres jugés non-éligibles de faire entendre leurs arguments et permettre une éventuelle révision de la décision initiale.
Pour suivre Futur Possible (ex-HorsLesMurs) sur Twitter
https://twitter.com/futurpossible

Agrandissement : Illustration 1