“Aujourd’hui, la question posée par Freud et par Bullitt est plus que jamais d’actualité. Comment empêcher une personnalité instable d’accéder et de demeurer au pouvoir, de mener un pays et parfois le monde à la catastrophe ? Le temps n’est-il pas venu en France, aux États-Unis et ailleurs de rouvrir la discussion ?”
Patrick Weil, 2022, Le Président est-il devenu fou?
Si la santé mentale des puissants a toujours défrayé la chronique, de Néron à Wilson en passant par Charles VI, l’exégèse psychanalytique ou psychiatrique des discours politiques est devenue un exercice médiatique incontournable, un marronnier de l’ère post-vérité. À chaque crise, les diagnostics fusent et permettent aux commentateurs de tout bord d’expliquer, à peu de frais et dans un frisson d’insolence, les décisions de Trump, Musk, Poutine, Netanyahu, et tant d’autres. Pourtant, comment ne pas voir que les subversions et les outrances de ces monarques modernes s’inscrivent aussi et peut-être surtout dans une logique d’ensemble et une stratégie de communication qui servent les intérêts qu’ils représentent? Quels sont les risques que peut poser le recours excessif aux concepts psychiatriques dans l’analyse politique?
Si le pouvoir de nuisance d’un chef d’État est proportionnel aux diagnostics psychiatriques dont celui-ci fait l’objet, Emmanuel Macron fait incontestablement partie du gotha des hommes qui comptent. Depuis la dissolution de juin 2024, leur nombre et leur variété ont explosé et l’idée selon laquelle nous serions dirigés par un malade mental semble presque faire consensus dans certaines sphères.
On ne compte plus les psychanalystes ayant partagé leur opinion sur Emmanuel Macron depuis l’interview —très reprise par l’extrême-droite— du psychanalyste Adriano Segatori qui qualifiait déjà Emmanuel Macron de psychopathe entre les deux tours de la présidentielle 2017. Roland Gori évoque un “complexe de castration” (2024). Michel Fize le décrit comme un mégalothymique (Un président anormal, 2024). Et dans La pensée perverse au pouvoir (2024), Marc Joly s’appuie sur la pensée de Paul-Claude Racamier pour le dépeindre comme un pervers narcissique (2024). Cependant, ces profils de personnalité issus de la psychanalyse ne sont pas des maladies mentales au sens propre du terme. S’ils peuvent être mobilisés par un discours critique, ils ne véhiculent pas les mêmes risques pour le débat public que les diagnostics qui reprennent mot pour mot le vocable clinique de la psychiatrie.
Avant de détailler ces risques, mentionnons pêle-mêle quelques-uns des diagnostics émis —de façon plus ou moins figurée ou péremptoire— par des journalistes ou des personnalités politiques au sujet d’Emmanuel Macron.
- La schizophrénie a été évoquée par des figures d’extrême-droite comme Jordan Bardella (Salon de l’Agriculture, 2024), Laurent Jacobelli (RTL, 2024) ou Gilles-William Goldnadel (CNews, 2021).
- La bipolarité (ou trouble maniaco-dépressif) a été évoquée notamment par Philippe Moreau-Chevrolet (Public Senat, 2018) et Emmanuel Perrat (Marianne, 2024).
- Le trouble obsessionnel-compulsif a été évoqué notamment par Emmanuel Maurel (Le Point, 2015).
- Le jeu pathologique ou compulsif a été évoqué par Nicolas Beytout dans l’Opinion (2024) et Olivier Faure dans l’Express (2025).
- L’addiction et la kleptomanie ont été évoquées respectivement par François Asselineau (Youtube, 2024) et Gilbert Collard (Twitter, 2025).
- Le trouble de la personnalité narcissique a bien sûr été évoqué à de nombreuses reprises, notamment par Marc Joly dans son livre et Olivier Duhamel sur France 5 (2018).
À ces pseudo-diagnostics s’ajoute un flot quasi-ininterrompu de qualificatifs qui semblent promettre à Emmanuel Macron une entrée imminente à l’asile. Emmanuel Macron serait ainsi un “taré” pour François Ruffin, un “dingue” d’après Richard Ramos, et on ne compte plus les références au “forcené de l’Élysée”, expression reprise notamment par Sandrine Rousseau, Emmanuel Bompard ou Boris Vallaud sur les plateaux de télévision.
Mais le recours au lexique de la folie comporte trois risques majeurs qui devraient dissuader d’en faire un usage aussi abusif: la psychophobie, la déresponsabilisation et la diversion. Les deux premiers ayant déjà été en partie traités ailleurs nous analyserons plus longuement le dernier, qui est aussi le plus dangereux politiquement parlant.
La psychophobie
Lorsqu’ils s’apparentent plus à une insulte déguisée qu’à un véritable jugement sur la santé mentale de la personne visée, ces diagnostics participent à la stigmatisation déjà trop répandue des patients souffrants réellement de troubles mentaux. Cette dérive, parfois nommée “psychophobie”, fait l’objet d’une attention croissante et ce n’est peut-être pas un hasard si ces problématiques de stigmatisation sont traitées dans le cadre de la “Grande Cause nationale 2025”, dédiée à la santé mentale.
Emmanuel Macron a lui-même évoqué avec ironie dans le journal Gala la “dépression très grave” que certains éditocrates comme Franz-Olivier Giesbert lui ont diagnostiqué durant la période ayant suivi les élections de 2022. Si quelques confidences faites en "off" par des proches du pouvoir ont pu rapporter dès son premier mandat des périodes de “déprime” ou de fatigue, il est navrant qu'un magazine comme Le Point y trouve une justification suffisante laisser FOG publier un billet titré "La dépression du Président". Compte tenu des pouvoirs qui sont les siens, il serait évidemment tentant de disserter sur les causes et les conséquences d'une éventuelle dépression et de son traitement, si ce diagnostic était avéré et rendu public. Mais est-il sain d’exploiter politiquement de telles rumeurs, que cela soit pour dénigrer ou décrédibiliser le président?
La déresponsabilisation
Sans spéculer sur sa santé mentale, les propres propos d’Emmanuel Macron —ajoutés aux diagnostics hâtifs et aux rumeurs persistantes— nourrissent une atmosphère de déresponsabilisation à son égard. Politiquement, cela importe peu, puisque l’irresponsabilité du président est constitutionnelle. En revanche, humainement, cette ambiance peut jouer sur ses relations avec ses collaborateurs, à l’Élysée comme dans les ministères.
De nombreux témoignages “off” et enquêtes, tel Le Président toxique d’Étienne Campion, décrivent un Macron plus dur et imprévisible depuis son arrivée au pouvoir, enclin à des contradictions entre parole et action. Des comportements jugés inacceptables chez d’autres sont tolérés chez lui. Peut-être ses proches les excusent-ils en les attribuant à une fragilité mentale, sans remettre en cause son intelligence ni son autorité : s’il dort si peu, quoi d’étonnant à ce qu’il appelle la nuit ? N'est-ce pas compréhensible qu’il s’emporte facilement en conseil des ministres ? Cette logique illustre une déresponsabilisation insidieuse dans ses rapports humains.
La diversion
Troisièmement, l’emphase mise sur le rôle premier des humeurs et des pulsions nous dissuade implicitement de réfléchir sérieusement aux buts poursuivis par l’individu en question. Ainsi, même dans la presse de gauche, pourtant farouchement opposée à Emmanuel Macron et sceptique dès ses débuts en politique, il n’est pas rare de lire que telle ou telle décision du président reflète une forme d’empressement ou d’obstination, un manque de lucidité ou une erreur stratégique. En filigrane, on retrouve fréquemment l’idée selon laquelle les actions d’Emmanuel Macron ne servent pas les buts que lui-même s’est fixés, et donc l’hypothèse d’un potentiel dysfonctionnement d’ordre intellectuel ou psychologique.
Certes, après 8 ans de présidence, même ses soutiens les plus aveuglés ont fini par comprendre que la promesse d’une politique plus juste et plus vertueuse n'engageait que ceux qui avaient bien voulu y croire. Emmanuel Macron apparait désormais comme un homme de droite. Dès lors, nul besoin de la psychiatrie pour appréhender ses faveurs à l’endroit des plus fortunés ou de l’école privée, et sa férocité vis-à-vis des chômeurs ou des services publics. Cependant, en 2025, considérer Emmanuel Macron comme un simple homme de droite ne suffit plus.
Et c’est évidemment la dissolution inattendue de l’assemblée nationale le 9 juin 2024 qui a produit une explosion sans précédent de commentaires questionnant sa santé mentale. En effet, même parmi les déçus du macronisme et une partie de ses opposants historiques, l’idée selon laquelle Emmanuel Macron menait un combat sincère contre l’extrême droite était restée solidement enracinée, comme une prémisse dont il serait impossible de questionner la validité. Comment pouvaient-ils, dès lors, comprendre cette décision dont le timing ne pouvait qu’amener à un immense succès électoral du Rassemblement National, autrement qu’en faisant l’hypothèse d’un profond manque de lucidité?
Cette incompréhension devenue quasiment structurelle se décline en réalité sous deux formes principales, qui alimentent toutes deux la propension à envisager notre président comme un homme souffrant d’une maladie mentale.
Maladie mentale ou stratégie électorale?
L’incompréhension prend d’abord la forme d’une incohérence entre les discours d’un président qui se présente comme un rempart contre l’extrême-droite et ses actions qui contribuent indirectement —et parfois directement— à la croissance spectaculaire des idées et des partis d’extrême-droite dans le pays. Outre la dissolution et ses conséquences, la présence de Bruno Retailleau dans les gouvernements Bayrou et Barnier s’apparente à un “en même temps” si extrême qu’il peut donner le sentiment d’une duplicité pathologique. L’incohérence est en outre exacerbée par le sentiment largement partagé qu’Emmanuel Macron torpille dorénavant son parti d’origine, contrariant l'émergence d’un successeur “légitime” pour les présidentielles de 2027. Faut-il réellement voir dans ce constat le signe d’une incohérence interne? Ou faut-il simplement admettre que la croissance de l’extrême-droite fait partie des objectifs d’Emmanuel Macron, sa stratégie étant alors tout à fait rationnelle et efficace en la matière?
Cette dernière possibilité est étayée par les révélations établissant qu’Emmanuel Macron a appelé en personne plusieurs candidats du bloc présidentiel pour leur demander de se maintenir au second tour des législatives lorsqu’une triangulaire pouvait amener à l’élection d’un député RN ou UDR. En contradiction directe avec les consignes données par Renaissance, son propre parti. Face à ce constat, une petite musique revient de plus en plus souvent chez les commentateurs: Emmanuel Macron serait en réalité en train de jouer une partie de billard à trois bandes visant à lui assurer une réélection en 2032 après l’élection d’un.e président.e RN en 2027. Si tel est le cas, il n’y a toujours pas lieu de voir dans ses décisions le signe d’une quelconque pathologie mentale, mais seulement le calcul froid d’un homme prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. On pourrait d’ailleurs évoquer l’hypothèse encore plus simple selon laquelle Emmanuel Macron est un homme qui, sans en partager toutes les orientations, a désormais plus d’affinités avec l’extrême droite qu’avec son parti d’origine.
Destruction et autodestruction
Ceci étant dit, le comportement d’Emmanuel Macron vis-à-vis de l’extrême-droite n’épuise pas toute l’incompréhension qu’il suscite. Même si l’on admet que celui-ci reflète une véritable dérive idéologique ou bien une stratégie dénuée de tout scrupule, l’incompréhension prend également la forme plus générale d’une sidération vis-à-vis de la situation économique et sociale désastreuse dans laquelle ses choix ont plongé le pays. Dans ce contexte, comment expliquer qu’Édouard Philippe appelle Emmanuel Macron à démissionner ou que Gabriel Attal confesse ne plus comprendre ses choix, si ce n’est en faisant l’hypothèse d’un dysfonctionnement réel du chef de l’État?
L’incompréhension renvoie ici à la déception abyssale des espoirs placés par de nombreux électeurs et élus dans un homme présenté comme un parangon d’intelligence et de clairvoyance, mais dont le bilan objectivement catastrophique est dorénavant perçu comme tel par la quasi-totalité des forces en présence. Blocage des institutions, absence de budget, délais interminables dans la nomination du premier ministre, volte-face des alliances, le tout dans un silence assourdissant de l’Élysée dans les moments qui comptent: la crise actuelle est en tout cas jugée à gauche, au centre et à droite comme grave et profonde.
Sans même lui prêter le génie que certains ont pu lui reconnaitre, comment croire qu’un homme comme Emmanuel Macron soit à ce point incapable de saisir le sens et d’anticiper les conséquences des décisions qu’il prend? Est-on réellement face à un homme malade, fatigué et perdu dans les méandres de sa vie intérieure, dépassé par sa propre complexité ? Un homme qui aurait développé une forme de cécité ou d’indifférence vis-à-vis du pays dont il a la charge ? Si l’on ne peut pas formellement exclure cette possibilité, il ne faut pas non plus s’en contenter.
Mais dès lors, comment ne pas revenir, d’une manière ou d’une autre, à l’hypothèse d’une pathologie si l’on accepte qu’Emmanuel Macron est capable d’anticiper les conséquences de ses choix pour le pays et pour lui-même? Après tout, être capable de reconnaître les conséquences négatives d’un comportement sans pour autant réussir à s’en défaire est un critère central pour le diagnostic de nombreuses maladies mentales. Certains, sans doute, persistent encore à voir en Emmanuel Macron une personne réellement altruiste qui sacrifie consciemment son image et son héritage pour l’idée qu’il se fait de l’intérêt général. Mais quelle pourrait bien être cette idée, si ce n’est ni celle des Français qui l’ont élu, ni celle des premiers ministres chargés de la mettre en œuvre ?
Un président sous influence ?
Avant de se résigner à croire notre président malade, une dernière hypothèse doit être envisagée : une hypothèse qui ne remet pas en cause sa lucidité mais plutôt sa capacité à choisir. Se peut-il que les choix autrefois « jupitériens » d’Emmanuel Macron soient aujourd’hui contraints par une (ou plusieurs) force(s) qu’il n’est pas —ou ne se croit pas— capable de défier, ni même de dénoncer publiquement. Bien entendu, il ne nous est pas possible de nommer ces forces ou de déterminer par quelles voies elles pourraient s’exercer sur notre chef d’État. Mais l’absence de preuves n’est pas preuve de l’absence, et les exemples de coercitions sont légion en politique, un des derniers en date étant le sordide chantage à la sextape subi par Gilles Artigues, premier adjoint au maire de Saint-Etienne.
Pour mettre en perspective et donner corps à cette possibilité, imaginons un instant que les documents prouvant l’existence d’un pacte corruptif entre les clans Sarkozy et Kadhafi ne soient pas tombés dans les mains de Mediapart en 2012, mais dans celles d’une puissance étrangère hostile à la France quelques années plus tôt? Quel impact un chantage à la divulgation de ces documents aurait-il eu sur la politique menée par Nicolas Sarkozy durant son quinquennat? On peut penser que la cohérence de sa présidence et son bilan en matière économique ou diplomatique en auraient souffert. L’incompréhension profonde qui entoure le second quinquennat d’Emmanuel Macron se révélera-t-elle dans quelques années comme le symptôme d’une présidence compromise par un ou plusieurs groupes de pression nationaux ou internationaux?
Lors du scandale Pégasus révélé en 2022, on a en tout cas appris que des traces de ce logiciel espion avaient été retrouvées dans les téléphones de cinq ministres. Si l’analyse des appareils d’Emmanuel Macron n’a pas été rendue publique, on sait néanmoins que ces derniers ont été immédiatement remplacés suite à l’affaire et qu’un chantier a été lancé pour permettre de sécuriser, bon an mal, an les appareils commerciaux qu’il privilégie —au détriment du téléphone ultra-sécurisé fourni par les services de sécurité. Il n’est pas utile de disserter outre mesure sur Pégasus. Il est d’ailleurs possible, pour ne pas dire probable, que le président soit la victime de plusieurs initiatives agissant par des canaux distincts, simultanément ou successivement, de concert ou indépendamment.
En outre, le pouvoir de nuisance des programmes tels que Pégasus ne se borne certainement pas au chantage à la divulgation de documents compromettants. Si une puissance étrangère a été en mesure de révéler à des tiers influents, à plusieurs reprises, le contenu de discussions confidentielles entre le chef de l’État et ses plus proches collaborateurs, l’isolement et la volonté de contrôle excessive de ce dernier apparaîtraient alors comme une adaptation logique à un environnement de travail dégradé, et non comme le symptôme d’une quelconque maladie mentale.
Les armées des pays développés s'intéressent chaque année de plus près aux techniques et problématiques de la “guerre cognitive” (cognitive warfare). Apparentée aux psyops qui ont rythmé la guerre froide, celle-ci consiste non pas à induire une maladie mentale, mais à créer un environnement informationnel susceptible d’altérer la prise de décision des individus ou des populations ciblées. Dans le monde occidental, c’est la plateforme Tiktok qui a d’abord attisé les craintes en la matière. Mais tout individu qui accède à internet via un smartphone ou un ordinateur personnel s’expose à la possible manipulation de ces flux informationnels, que ce soit par les réseaux sociaux, les créateurs d’application ou les services d’information tels que Google News, en particulier si son téléphone est infecté par un programme malveillant…
Pour conclure, il est naturel d’envisager qu’une dégradation de la santé mentale d’Emmanuel Macron puisse être la cause d’une série de choix ayant mené au chaos politique et à l’ascension fulgurante d’une extrême-droite qu’il s’était engagé à combattre. Mais cela suffit-il pour en conclure qu’Emmanuel Macron souffre de pathologie mentale ? Même s’il ne s’agit que d’une façon de parler, adopter et reprendre à son compte ce genre de discours, c’est aussi une façon de renoncer à comprendre ce qui anime et motive réellement les décisions de notre président.
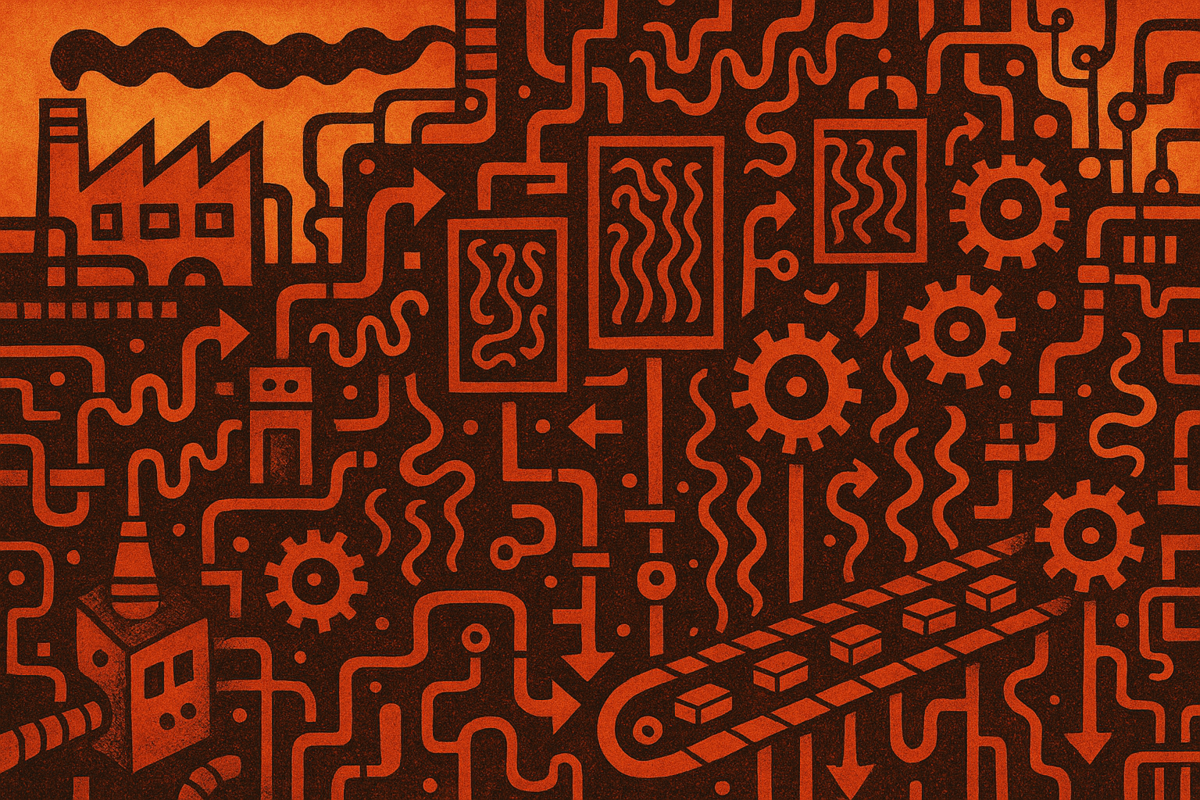
Agrandissement : Illustration 1




