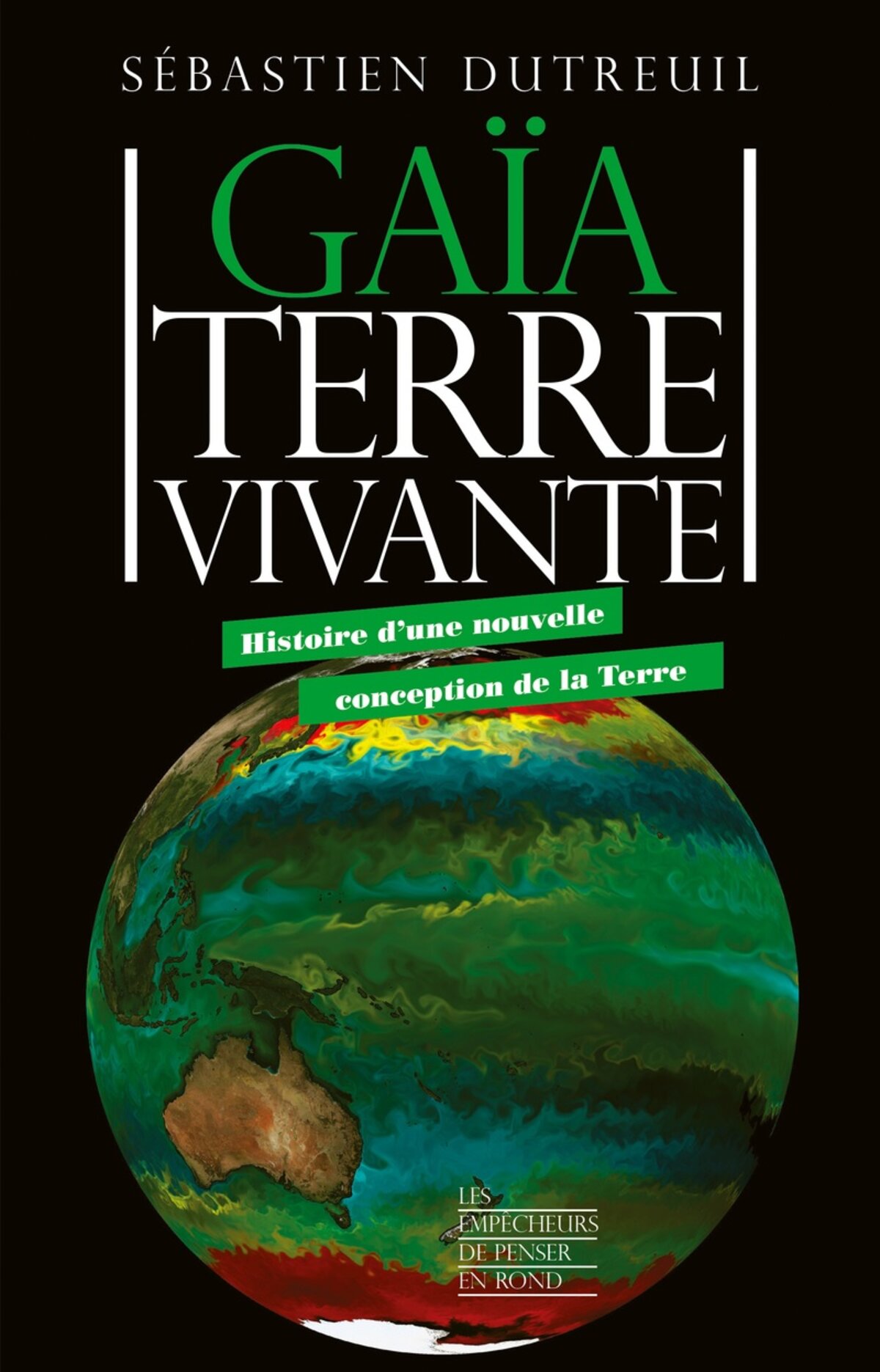
Agrandissement : Illustration 1

Il y a vingt-cinq siècles, les Grecs enfantaient Gaïa dans leur mythologie, une déesse surgie après Chaos et qui engendre le monde. Gaïa a disparu des radars de l’histoire jusque dans les années 1970 lors que l’ingénieur chimiste James Lovelock (1919-2022) et la microbiologiste Lynn Margulis (1938-2011) la convoquent depuis le panthéon grec pour en faire une proposition scientifique, voire un «nouveau rapport spirituel, philosophique et politique à la nature». Cette histoire est racontée par l’historien des sciences Sébastien Dutreuil (CNRS/université Aix-Marseille) qui met à jour cette hypothèse d’une régulation de l’habitabilité de la Terre par les êtres vivants. Gaïa a semé le doute chez les scientifiques et les philosophes mais elle s’est imposée dans la littérature écologiste.
Lovelock cherchait comment détecter la vie sur Mars et réalise que la Terre est une entité vivante, un organisme. Du coup, les biologistes ne peuvent plus parler de la vie sur Terre, mais d’une planète qui vit. Prudent, le chimiste parle d’une «hypothèse» qu’il porte au débat en 1974 dans un article fondateur de la revue Teellus avec sa collègue : la vie sur Terre régule l’atmosphère et, donc, l’habitabilité de la planète. Dix ans plus tard, Lovelock développe sa pensée dans La Terre est un être vivant. L’hypothèse Gaïa (Flammarion). La Gaïa de Lovelock est un «écosystème de taille planétaire». Et notre climat ainsi que la composition de l’atmosphère sont régulés de telle manières qu’elles soient «toujours plus ou moins confortables pour la vie». La vie est imaginée comme une créature se déployant à travers la biosphère, l’atmosphère, les océans et les sols et elle et aurait façonné la Terre pour la rendre propice à son existence.
Cette approche d’un mégaorganisme déchaîne les critiques qui lui reprochent l’idée d’un altruisme global, invalidé par la sélection naturelle. Les années 1970 ne sont-elles pas celles où le New Age prospérait entre Amérique du Nord et Europe ?
Du reste, l’appropriation culturelle de Gaïa donne à Lovelock l’idée de fédérer dans les années 1990 ce mouvement dans Magazine Gaïa et dans la Gaïa Society. Devant la violence et les offenses personnelles faites à Lovelock et Margulis, le chimiste tente de montrer que son hypothèse est scientifique car réfutable, en mettant au point un modèle informatique, Daisyworld, pour valider la possibilité d’un mécanisme de régulation planétaire. Il n’y parvient pas. Du coup, Dutreuil s’éloigne de « ’hypothèse» pour faire de Gaïa un «programme de recherche » : quelles questions pose cette conception de la Terre ?
Pourtant l’approche de Lovelock et Margulis n’est pas imaginaire : si les êtres vivants ont besoin de conditions physico-chimiques particulières, si la biosphère est trop «puissante» pour être passive et s’il y a une régulation climatique empêchant la Terre de se figer dans la glace comme au Quaternaire, alors on peut supposer qu’un organisme stabilise ces conditions pendant des milliards d’années. On quitte les idées mécanicistes de la Terre puisqu’il y a eu adaptation. Au diable la Vie, vue comme une compétition, puisque Lovelock y voit des interactions visant à un équilibre. La vie des Gaiens prend une majuscule comme on en donne à toute personne. Pour Dutreuil, Lovelock montre «l’existence d’une entité que nous n’avions jusqu’à présent pas reconnue.»
Précisons que le Galilée de Bruno Latour avait fait un détour par la physique de Erwin Schrödinger (1887-1961) expliquant que les organismes vivants luttent contre la loi de la thermodynamique imposant une trajectoire de la matière vers la dispersion. Une idée que Lovelock avait appliqué à la planète Terre. La généticienne Lynn Margulis ne pouvait qu’appuyer cette hypothèse puisqu’elle imaginait la coopération et non la compétition entre les espèces pour maintenir la vie.[1] Ne lui doit-on pas, entre autres, l’idée que nous ne pouvons vivre que grâce aux millions de microbes qu’on trouve dans nos microbiotes (buccal, cutané, intestinal, etc.).

Pourtant, Gaïa va s’éloigner de la biologie et se rapprocher des sciences de la Terre qui travaillent sur les interactions entre éléments (eau, carbone, azote...). Une approche d’abord influencée par une nouvelle vision de la Terre offerte par la Nasa et mission Apollo qui résulte de la guerre froide, et celle d’une industrie toute puissante à l’origine d’un «géopouvoir» au service de l’armée. Mais qui s’oppose à l’approche de Buckminster Fuller (1895-1983) donnant aux humains le rôle de pilotes, maîtres de la planète pensée comme une machine, tout comme Gaïa pensée comme une totalité organique. Il faut atterrir, plaide Bruno Latour sans perdre les images de la «Bille bleue» (1972) perdue dans le Cosmos.
Lovelock n’a pas été le premier à imaginer la Terre comme une planète vivante. Une idée émise dans l’Antiquité, reprise à la Renaissance et théorisée par le géochimiste Vladimir Vernadski (1863-1945). Pour l'historien Jean-Baptiste Fressoz, c’est plutôt la fin d’un oubli. Mais reprendre un nom de déesse grecque ne peut que brouiller le message vers les scientifiques. D’autant que les conflits d’intérêts que Lovelock entretient avec les services secrets britanniques, la pétrochimie (Shell), l’électronique (Hewlett-Packard) et une multitude d’entreprises connues pour être écocidaires. Dutreuil émet l’hypothèse que Lovelock pensait comme les industriels, qu’il était prisonnier d’une idéologie du progrès fondé sur la chimie qui était sa formation. De ce fait, Leah Aronowsky a pu interpréter cette attitude comme du négationnisme climatique, dû à cette image d’un climat fondamentalement stable qui va, donc, surmonter la crise actuelle.
Quoiqu’il en soit, Gaïa passe à l’ombre des sciences appliquées dans les années 1980 qui voient monter les sciences du système Terre (SST), de nouveaux programmes de recherche comme l’International Geosphere Biosphere Programme (IGBP) en 1986 et le GIEC en 1988, en redécouvrant Vernadski. Les SST intègrent aussi le concept de «zone critique», porté en France par Jérôme Gaillardet (IPGP), comme l’enveloppe où se déploie le vivant ainsi, qu'en l'an 2000, l’appellation d’anthropocène proposée par Paul Crutzen (1933-2021). On voit mieux désormais comment les scientifiques s’emparent de l’expertise du GIEC pour penser des ruptures, des catastrophes, voire des transitions.
Faudra-t-il brûler Gaïa ? Pour lors, elle apporte une nouvelle appréhension de la crise écologique, vue comme une intersection entre la géographie – la zone critique – et l’histoire des industries extractivistes qui ont bâti une scène où tout s’emballe.
----------
[1] Microcosmos, coécrit avec Dorion Sagan (Wildproject, 2022).
----------
Pour aller plus loin :
De nouvelles façons de penser la Terre
Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les Révoltes du ciel (Seuil, 2020).
----------
Pour nous suivre sur Facebook : http://facebook.com/geographiesenmmouvement/



