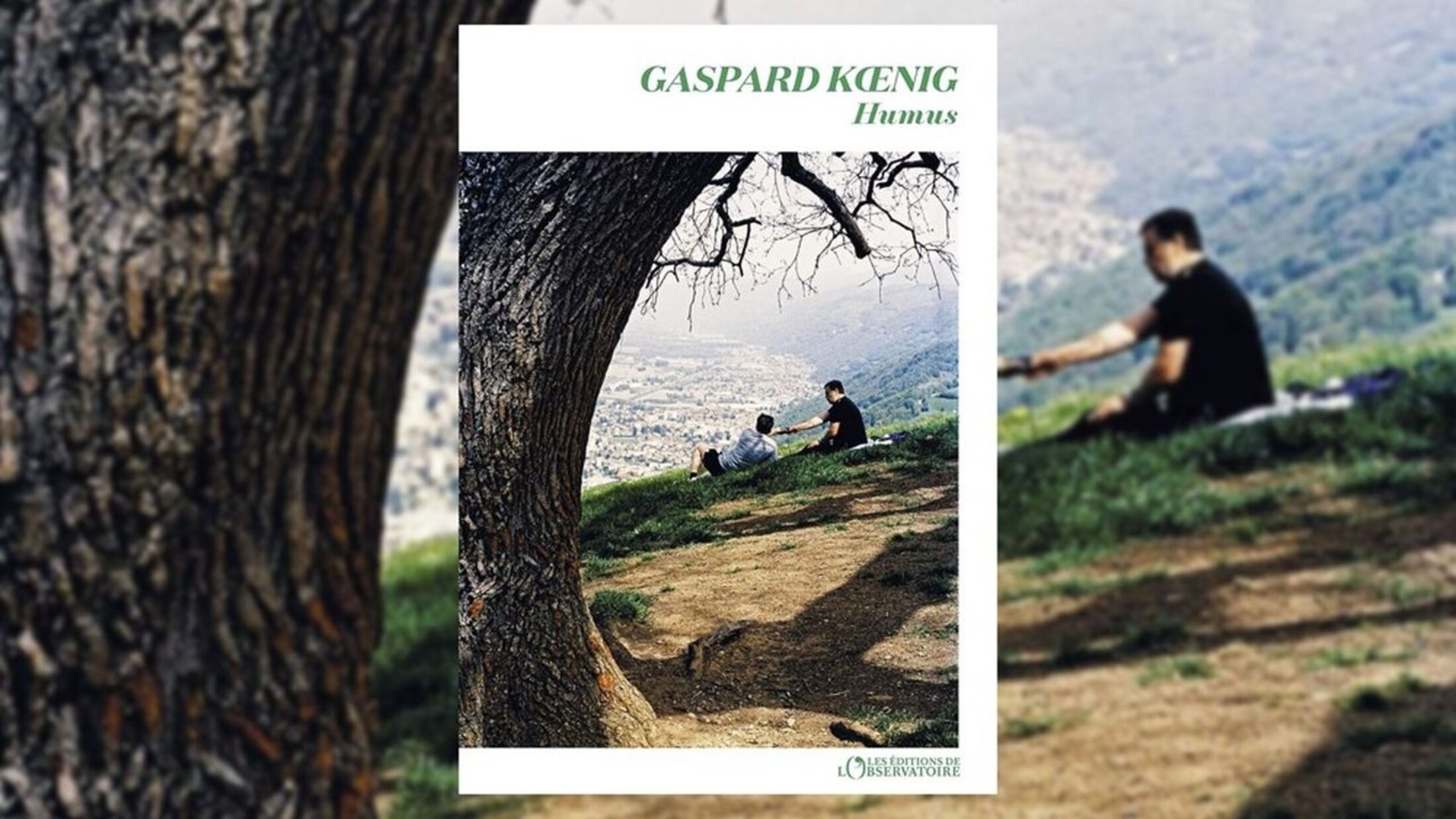Agrandissement : Illustration 1

L’agronomie est-elle la mère des batailles du futur ? Avec l’hypocrisie consistant à nommer l’agrochimie comme une agriculture «conventionnelle» (on se demande bien de quelle convention il s’agit, à part celle de donner le pouvoir à des apprentis sorciers qui saccagent le vivant), il faut beaucoup de pédagogie pour montrer où se situe la crise actuelle tant la destruction des sols est avancée. Tous les moyens sont bons. Y compris l’écriture romanesque de Gaspard Koenig qui publie Humus, sa sixième fiction dont les héros sont des… lombrics, ces «intestins de la terre» comme les nomme Aristote, présents sous terre à raison de trois tonnes par hectare.
Cette géographie des profondeurs est menée par Arthur et Kevin, qui se rencontrent à AgroParisTech. L’un caricaturé en citadin bobo qui veut réintroduire des vers dans un champ brûlé par les pesticides en Normandie. L’autre, un transfuge de classe limougeaud montant une entreprise industrielle de traitement de déchets par des vermicomposteurs. Leur belle histoire se fracasse contre le mur du capitalisme. Koenig qui a tenu, jadis, la plume de Christine Lagarde à Bercy mais devenu, depuis, éco-anxieux, dessine le moteur politique de cette mégamachine qui va broyer et brouiller les deux amis.
Gaspard Koenig plante sa tragédie dans les amphis de l’école d’agronomie bâtie sur les terres fertiles du plateau de Saclay, les recoins du bocage normand, du Limousin, et les lieux du pouvoir qu’il a fréquentés à Bercy et son paquebot ministériel, non loin de l’hypercentre du jardin du Luxembourg, devant le Sénat, qui devient le siège d’une guérilla finale durement matée par l'armée. Pour des enjeux climatiques planétaires, on a vu plus large. Le parti pris veut que tout converge vers les « laboureurs de la terre » (Darwin) chargés de réparer les sols pollués qui assureront la survie alimentaire de l’humanité.

Agrandissement : Illustration 2

Balzac et Zola auraient-ils imaginé de tels héros ? En cela, Koenig enrichit la veine littéraire naturaliste par un sujet qui préoccupe les chercheurs aujourd’hui : la zone critique, décrite par les géologues comme la pellicule externe de notre planète, siège d’interactions chimiques entre l’air, l’eau, les roches, milieu poreux où les minéraux se transforment au contact de l’oxygène, du CO2 et de l’eau, un milieu justement critique où nous cultivons sur les sols, où circule l’eau et où stockons les déchets. Koenig s’étonne qu’on ne s’intéresse pas à cette très vitale bande de terre nourricière, alors que nous nous épuisons à regarder le ciel et comprendre l’ordre des galaxies. Après tout, les invertébrés sont les infatigables transferts de nutriments, fertilisant nos écosystèmes comme le rappelait Darwin juste avant sa mort.
Pour être pédagogique, Koenig oppose deux trajectoires sans choisir celle qu’il affectionne : capitalisme vert contre radicalité écologique. Mais aucune ne réussit, tout se déconstruit depuis les laboratoires et les usines pour un retour à la nature qui s’avère, ici, l’antichambre de la catastrophe. Terminée, l’aventure imaginée sur les bancs de l’Agro ! Le temps du roman, les lombrics deviennent les référents permettant le raccordement des humains au vivant. Le véritable amour sera celui de la terre. La révolution viendra d’elle et du chaos qu’elle engendre. Il y a là quelque chose qui évoque les Soulèvement de la Terre, luttant contre l’hydre politique d’un Darmanin dépassé par son hubris. Pour Koenig, Don Quichotte de la politique qui a culbuté fortement à l’élection présidentielle, la leçon est bonne à prendre.
Car finalement, les deux types qui s’accordent sur une photo de Depardon en couverture du livre sont les deux faces de Koenig qui a sans doute usé paresseusement de la pensée binaire à Sciences Po. On croirait ces Bouvard et Pécuchet sortis d’un tableau de Caspar David Friedrich, entre deux mondes au-dessus duquel ils signent un pacte. Leurs destins vont les conduire là où rien ne les y assignait : l’un, péquenot du Limousin après avoir disséqué la géodrilologie dans les filets des banques et du Cac 40, l’autre, bobo parigot bifurqueur dans le bocage pour sauver des sols devenus poussières stériles. Comment soigner son éco-anxiété dans ces conditions ?
Le matériau d’Humus ne saurait faire gagner le zadiste, le banquier, ni même le ministre. Le chaudron dans lequel les sciences de la terre et la géographie mijotent une planète inhabitable pourrait bien exploser comme la colère du peuple à la fin du roman. Après tout rappelle Koenig, les Romains nous ont légué la même racine : « Homo vient d’humus. Homo vit d’humus. Puis Homo a détruit humus. Et sans humus, pas d’Homo. Simple. » Telle est la leçon de ce roman d’apprentissage écologique avec hommage aux vers de terre. L’occasion de relire, une fois reposés de la bataille finale, l’indépassable La terre détruite par l’homme du géographe Elisée Reclus (1830-1905) qui n’a pas pris une ride.
-----------
Pour nous suivre sur Facebook : https://facebook.com/geographiesenmouvement/
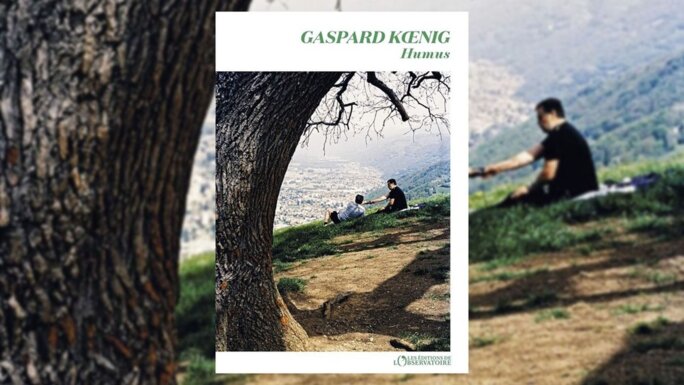
Agrandissement : Illustration 3