Aux sources de l’extractivisme
Un retour dans le passé nous apprend que l’on collecte l’or depuis des millénaires, d’abord dans le lit des rivières (grâce à des peaux de bêtes dont la fourrure piégeait l’or) puis en l’extrayant dans des puits et gisements.
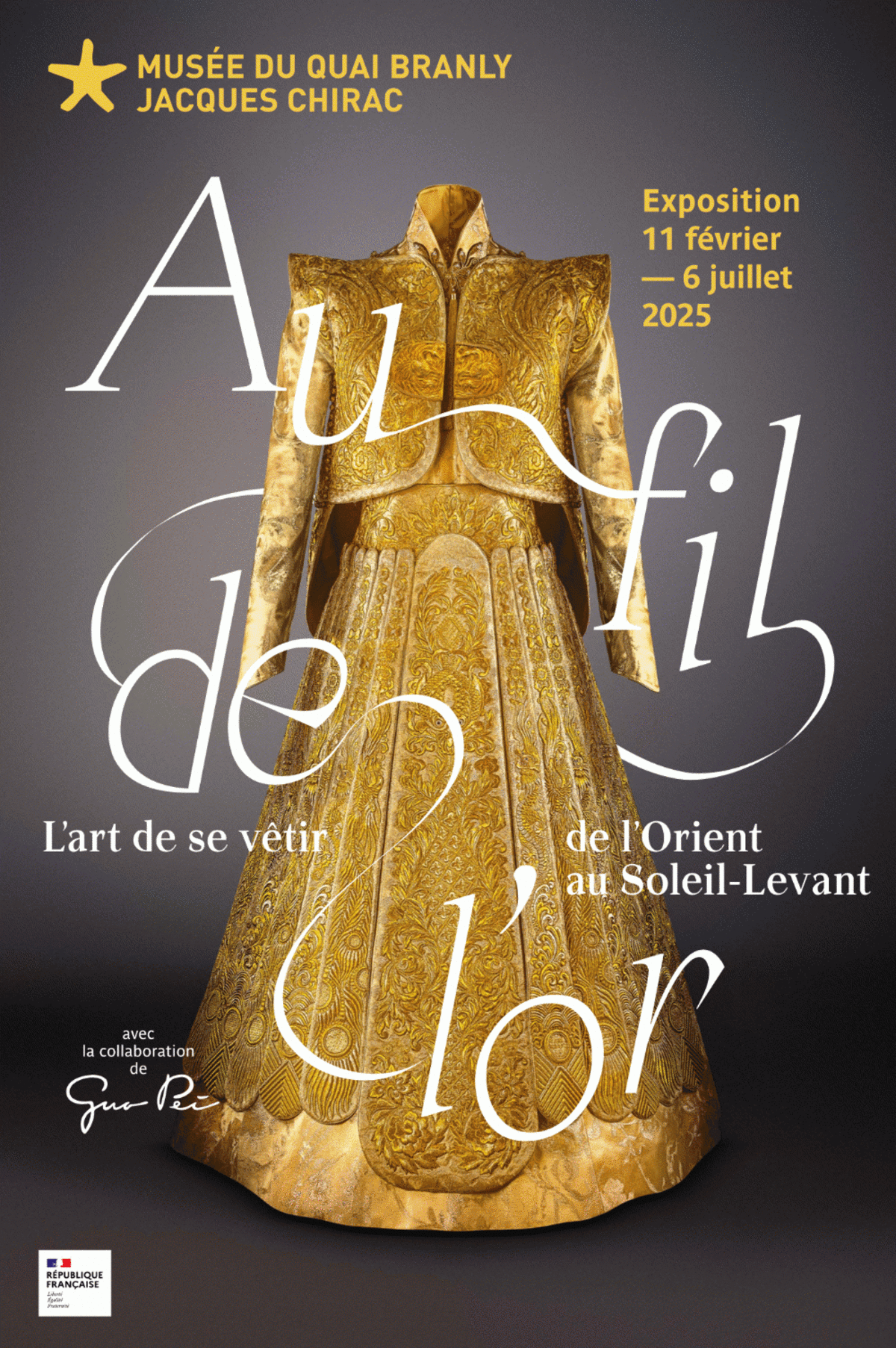
Agrandissement : Illustration 1
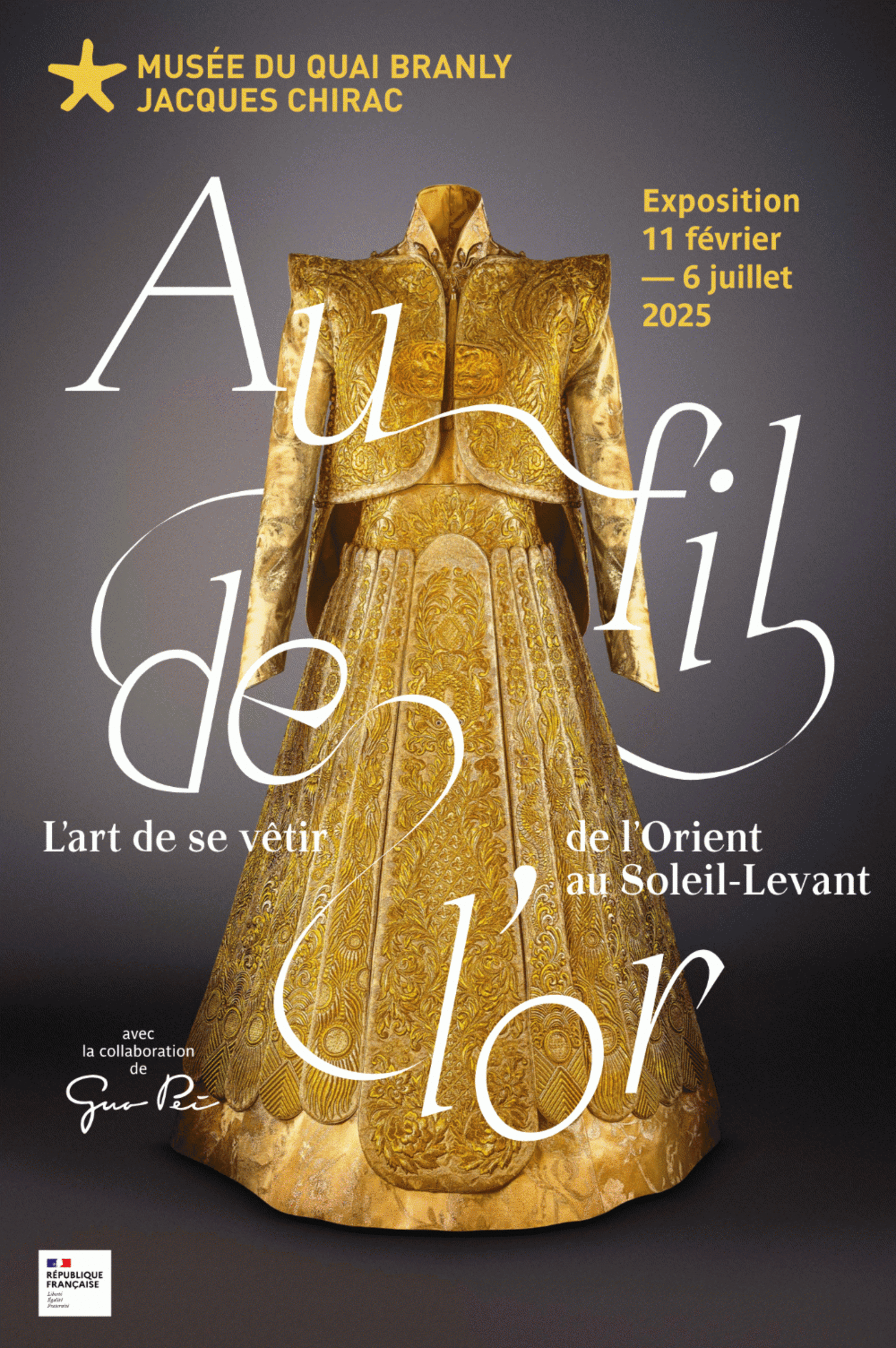
L’attrait de ce métal est largement dû aux vertus sacrées qu’on lui confère: les civilisations précolombiennes le prennent pour un morceau de soleil équivalent à la « chair des dieux », les Égyptiens prêtent à son scintillement la capacité à éloigner le mal, quand les Indiens l’associent à une déesse importante du panthéon hindouiste. En Chine comme ailleurs, l’or devient un symbole de pouvoir réservé aux parures impériales et aux habits des hauts dignitaires.
Plus prosaïquement, l’or est aussi malléable et indestructible: quand on découvre le tombeau de la reine de Saddam, le corps se désintègre en poussière et seuls subsistent les fils d’or qui en formaient le décor.
La fièvre de l’or s’explique également par sa rareté, car l’or est d’origine extraterrestre. Issu de poussières émises par la fusion d’étoiles, bien avant la formation du soleil et de la Terre, c’est en s’accrochant à des météorites qu’il est arrivé sur notre planète, se fichant entre le magma et la croûte terrestre. Quand le magma remonte, il emporte avec lui de l’or qui se refroidit et forme des pépites (nugget en anglais). Un détour géologique qui permet de comprendre que l’or soit difficile à extraire sans utiliser des tonnes de produits chimiques toxiques qui le détachent de la roche.
Des similis or très convoités
En plus de l’or, on exploite aussi les trois matières naturelles qui lui ressemblent à s’y méprendre.
La grande nacre produisant des filaments dorés pour s’accrocher aux rochers, on a abondamment pêché ce long coquillage pour confectionner gants et bonnets avec sa «laine de mer».
À Madagascar, l’araignée néphile dorée produit des centaines de mètres de soie depuis son abdomen. Vers 1880, le missionnaire Paul Camboué invente une machine à filer spécifique et fait cueillir 300 000 araignées pour fabriquer un lit à baldaquin en soie, à présenter lors de l’Exposition universelle de 1900. Peu après, une recrudescence du paludisme décime les habitants, et l’on comprend trop tard que les araignées se nourrissaient des moustiques porteurs de la maladie. Une histoire aux airs de fable écologique, qui prouve l’utilité des bestioles jugées indésirables dans le maintien d’écosystèmes vitaux.
L’histoire cambodgienne est plus positive. Là-bas, la production issue du ver de soie est restée rurale, et sert à maintenir un savoir-faire et une culture ancestrale - pour faire vivre la tradition, les tissus reprennent des motifs issus de l’art khmer.
Métissages et échanges
Mais en matière d’or, les traditions se sont rapidement hybridées, dans un métissage fécond. La diffusion des techniques relatives au tissage de l’or témoigne de l’existence précoce d’une forme de mondialisation commerciale et culturelle. C’est en effet avec les conquêtes d’Alexandre le Grand que le savoir-faire oriental se diffuse en Grèce et séduit les Romains. Les progrès de la cartographie et de la navigation permettent ensuite aux marchands arabes d’étendre leurs activités commerciales vers l’océan indien et la Chine, notamment entre le 9è et le 13è siècle (remettant en cause l’idée de « grandes découvertes » exclusivement européennes survenues à la Renaissance).
L’expansion musulmane entraînera peu après un essor de la production de luxe, avant que la pax mongolica instaurée par Genghis Kahn ne permette à des marchands italiens comme Marco Polo de ramener des tissus dorés dans les cours européennes. Témoin de ces échanges mondiaux, la chasuble d’Henri II est tissée dans l’Empire mongol et ornée d’une inscription en arabe. Peu après, c’est l’expansion de l’Empire ottoman qui diffuse la mode turque au Moyen-Orient, quand les vêtements de mariage de la péninsule arabique restent marqués par l’influence indienne.
Et si le Lurex américain, un fil en polyester recouvert d’un métal brillant et d’une peinture or, démocratise le fil d’or dès 1946, les techniques ancestrales n’ont jamais disparu.
Ce voyage à travers cinq régions géographiques et culturelles, des caftans marocains aux kimonos japonais, rappelle l’intensité des métissages et des transferts culturels, la valeur sociale et symbolique du vêtement, mais également la tentation de sacrifier l’environnement pour se procurer le précieux métal ou ses avatars. Passionnant.
Au fil de l’or. L’art de se vêtir de l’Orient au Soleil-Levant, Musée du Quai Branly
----------
Sur le blog
«Bangladesh dix ans après: les ravages de la mondialisation textile» (Gilles Fumey)
----------
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/
Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social



