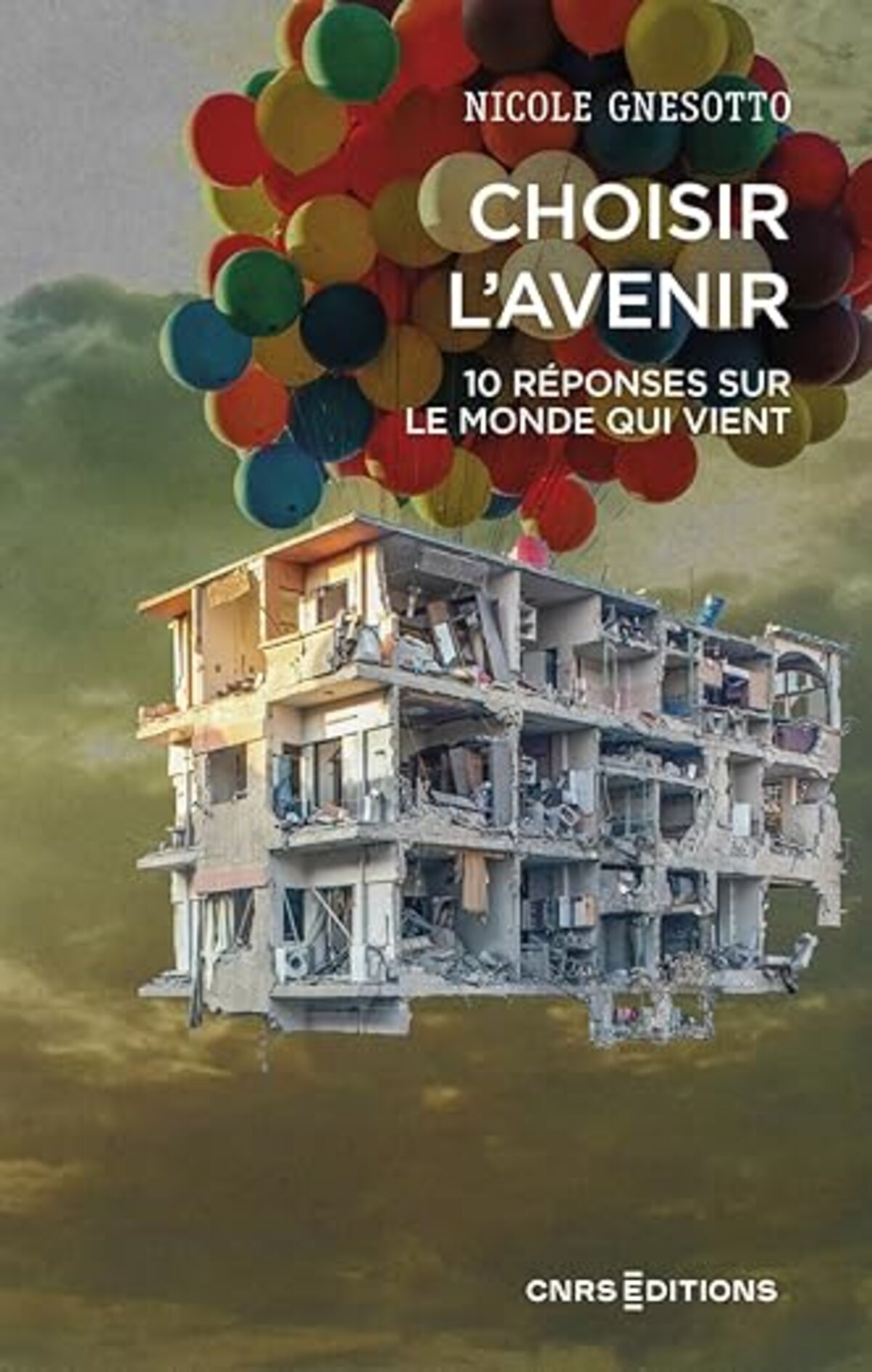
Regardons la vitrine éditoriale: L’ensauvagement du monde (T. Delpech), L’affolement du monde, L’accélération de l’histoire (Gomart, Raufer, Bauer), Le déclin du néolibéralisme (Cayla), L’impuissance de la puissance (Badie), La défaite de l’Occident (Todd), La guerre des mondes (Tertrais). Ambiance...
Le retour de Trump à la Maison blanche va accentuer une «mondialisation de l’insécurité», entamée pour la période actuelle, lors des printemps arabes (2011). Paul Valéry parlait déjà en 1939, sans se tromper, de «l’intoxication par la hâte». Sans se tromper. L’incertitude et la surprise, l’intrication des crises, l’incompatibilité des réponses, la force contre le droit, la contestation de l’Occident : telles sont les accroches de la réflexion de Nicole Gnesotto (Institut Jacques Delors) qui se demande, bien dans l’esprit de l’ancien président de la Commission de Bruxelles, si l’équation actuelle c’est «Nous d’abord ou tous ensemble ?». Car il y aurait beaucoup à dire sur le fonctionnement des institutions mondiales, notamment la terrible hypocrisie des Occidentaux qui n’accordent aucun siège à l’Inde au Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne trouvent rien à redire que la Chine ne possède que 6,8M des votes au FMI contre 16,5% pour les Etats-Unis...
L’avenir, c’est la guerre ?
Sur l’Ukraine, la guerre devient-elle l’avenir du monde ? Pendant la «pause d’Obama», l’Occident semble avoir démissionné. Aucune réaction aux attaques chimiques de Bachar el-Assad contre sa population en 2013, ni lors de l’invasion du Donbass. Quant au 7 octobre, le livre de N. Gnesotto est paru avant... Avec l’Ukraine et la guerre israélo-palestinienne, les «guerres [sont] locales à effet mondial », avec un cumul de haute technologie et du «corps à corps barbare». On peut écrire tous les scénarios possibles. Y compris celui d’une intervention occidentale, s’il fallait défendre Taïwan? « Il est possible que l’Ukraine ne gagne pas totalement sa guerre, qu’Israël soit obligée d’accepter une solution à deux États plus ou moins imparfaits, que Taïwan reste dans une ambiguïté permanente sur son véritable statut, autrement dit que le compromis l’emporte sur l’idée de victoire claire et nette. Est-ce une erreur ? Ne peut-on pas préférer parfois le brouillard de la paix à la fausse simplicité de la guerre ?»
Nicole Gnesotto s’interroge sur la démocratie : est-elle mortelle ? Pourquoi le monde est-il devenu de plus en plus autoritaire ? La chute du mur de Berlin a, sans doute, dessillé les regards sur la véritable nature des démocraties : hypocrites, immorales, inefficaces, ingérentes sans respecter la souveraineté des autres, en crise à l’intérieur... En Europe, l’Union est désignée comme la coupable. Sur le climat, la numérisation des sociétés a prospéré le complotisme. La Chine, tout en s’enrichissant, garde son modèle libéral-autoritaire... Comment peut-on être démocrate lorsqu’on n’est pas riche, éduqué, protégé?
Démondialisation ?
Ne vivons-nous pas la fin de la mondialisation, se demande l’autrice. Avec des inégalités qui explosent (1% des plus riches possèdent 48% des actifs financiers en 2024). Avec une destruction sans précédent de la planète, en termes de biodiversité. Pourtant, le Covid et le climat donnent le sentiment que la mondialisation serait plus contrôlée. Et Trump va sans doute réactiver le protectionnisme...
Que se passe-t-il avec un réchauffement de la planète à 3,2°C d’ici la fin du siècle? Plus de 3,5 milliards d’humains sont très vulnérables. Et le reste de l’humanité est en danger. Le débat? Depuis 1992, les Nations unies ont été sur le pont, mais le climatoscepticisme progresse... La géographe Sylvie Brunel reçoit le grand prix de la Société de géographie en 2024. Et, avec elle, que penser des Bruckner, Ferry pour lesquels la science est la solution... Ce qui est sûr : la solidarité sera coûteuse, les erreurs continuent (Cop à Dubaï, JO énergivores dans des pays désertiques)... Hypocrisie à tous les étages. Pour autant, est-ce la fin de la géopolitique? Du capitalisme? L’autoritarisme est-il inéluctable?
La science est-elle une solution? «Sans conscience», elle est vouée à l’échec. L’IA est une vraie menace. Comment ne pas laisser faire? Encadrer, comme le font la Chine avec Google, l’Argentine avec les réseaux sociaux et tout ce que produisent les comités d’éthique qui bataillent, avec les États, contre les firmes californiennes?
Que faire de la puissance ?
Pour l’instant, le monde va devoir accepter que la Chine puisse être obsédée par sa puissance. Qu’elle pratique un capitalisme autoritaire destiné à séduire les pays du Sud. Veut-elle le leadership? Les Etats-Unis accepteront-ils de partager cette puissance? Pour l’instant, c’est le containment, mais à l’avenir? Quant à l’Europe, on peut la voir puissante ou misérable, mais elle ne sera, sans doute, ni totalement l’une, ni totalement l’autre. Certes, «les crises font avancer l’Europe, mais pas toujours». Au Moyen-Orient, l’Europe est introuvable. En Ukraine, elle fait ce qu’elle peut, c’est-à-dire pas beaucoup quand bien même souhaiterait-elle plus... Elle s’élargit encore, sans avoir réglé la question de la démocratie chez certains de ses membres, ni la défense, ni la croissance. Là encore, les scénarios ne sont pas forcément ceux du pire, mais la partie ne sera pas facile face à Trump, au moins jusqu’en 2028. Quant au Sud (les trois quarts de l’humanité), ce que veulent les puissances qui peuvent parler, c’est ce que craint l’Occident : la critique coloniale, l’influence de la Russie...
Si la paix est une « invention de l’homme » pour Pierre Hassner, elle est pour l’instant, bien malade. Les empires ne l’assurent plus. Les technologies non plus. La sécurité collective est en faillite. Les peuples sont-ils la solution? Depuis 1798, le peuple devenu soldat, mais la boucherie de 1914-1918 n’a pas convaincu qu’il était la solution. La diplomatie? Peut-être, mais aujourd’hui? Certes, il faut bien chercher la paix, mais en évitant le piège de la vertu occidentale. «La paix géopolitique ne suffit plus».
Nicole Gnesotto n’oublie rien. En terminant son livre par l’évocation de la démographie «qui nous interroge crûment sur notre propre évanescence». L’africanisation du monde est en route. Le désir d’enfants s’émousse dans nos sociétés embourgeoisées. Au point qu’on pose la question de la disparition de la puissance occidentale par rétrécissement démographique. Faut-il rappeler que ce fut le cas de la Grèce et de Rome, dans l’Antiquité? Faut-il redire que nos « valeurs » ne sont pas universelles?
Le monde a-t-il les moyens de régler ces deux contradictions ? La première qui est la question climatique, urgente, alors que la Chine ment sur son état sanitaire, que les énergies fossiles ne reculent pas, que les solutions à une crise en aggravent une autre? La seconde, sur les progrès scientifiques face à la barbarie des guerres actuelles, laissant penser que la violence militaire s’est désinhibée depuis dix ans au mépris du droit.
Peut-on imaginer reconstruire un minimum d’«ordre mondial» ? Nicole Gnesotto revient sur les prétentions occidentales à détenir la vérité, le savoir, la puissance en ne voulant pas voir la faillite du système néo-libéral. Comment réparer, répondre sans conserver les positions de puissance ? Daniel Cohen aurait-il le dernier mot ? Pas sûr.
Lisons: « L’économie est sommée de prendre en charge la direction du monde à un moment où les besoins sociaux migrent vers des secteurs qui peinent à s’inscrire dans la logique marchande. La santé, l’éducation, la recherche scientifique, le monde d’Internet forment le cœur de la société post-industrielle. Aucun n’entre dans le moule économique traditionnel » (Homo Economicus, 2012). Aussi brillant qu’ait été cet économiste, on n’a pas lu, sauf erreur, qu’il ait inventé d’autres objectifs, d’autres normes que les seules règles du marché.
Pour l’instant, le monde est promis à des orages et de la colère. Nicole Gnesotto cite Hannah Arendt et son cher Amor mundi : « Je veux dire par là se soucier davantage du monde – qui existait avant notre apparition et qui continuera d’exister après notre disparition – plus que de nous-mêmes, de nos intérêts immédiats et de notre vie » (Abécédaire d’HA, 2018).



