
Agrandissement : Illustration 1
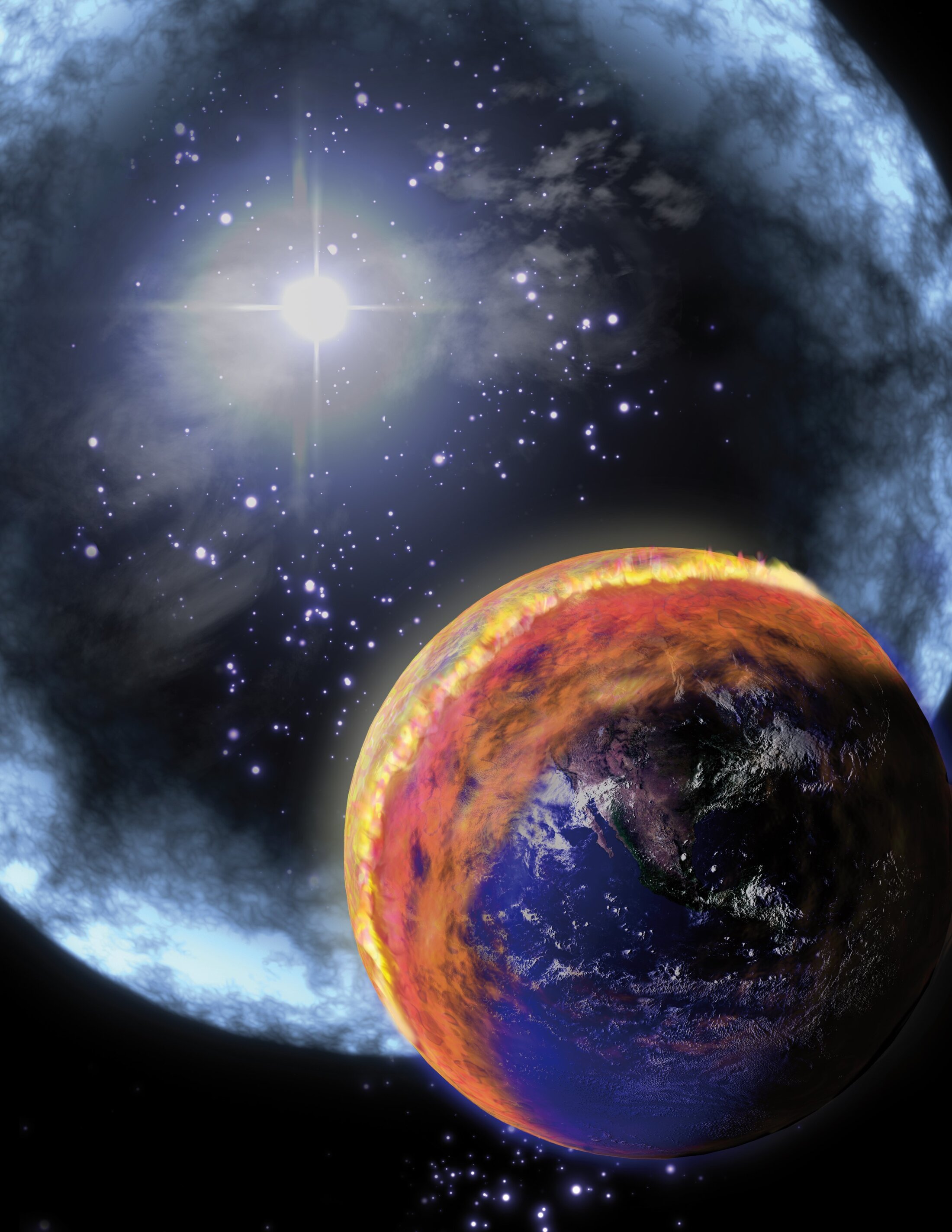
Depuis les grottes préhistoriques jusqu’aux plus sophistiqués des télescopes qui sondent l’univers, la question hante l’humanité. Les savants grecs, ceux du Moyen Age et de la Renaissance, des Lumières ont tenté de percer les secrets de la situation de notre planète dans l’Univers. Peut-on « écrire la Terre » dans le Cosmos ? Quelques géographes se sont spécialisés sur la géomorphologie des planètes de notre galaxie, mais peu sont allés au-delà, peu ont travaillé sur les impacts physiques que procurent nos voisines Lune, Mars, Jupiter, Neptune, etc., en dehors de ce qu’on connaît déjà : les marées, le climat, etc. Les Coronelli, pour ne citer qu’eux, imaginent bien un « globe céleste » offert à Louis XIV qu’on peut voir à la Bibliothèque nationale, pour « ranger » un peu le ciel.

Le naturaliste Alexandre de Humboldt, fondateur de la géographie, fut le premier sans doute, polymathe passionné par les mesures, à explorer le ciel, les étoiles, tenter une « géographie céleste » dans une œuvre monumentale, Cosmos, dont il emprunte le sens aux pythagoriciens chez qui le mot signifie « ordre de l’Univers », d’où « Univers ».
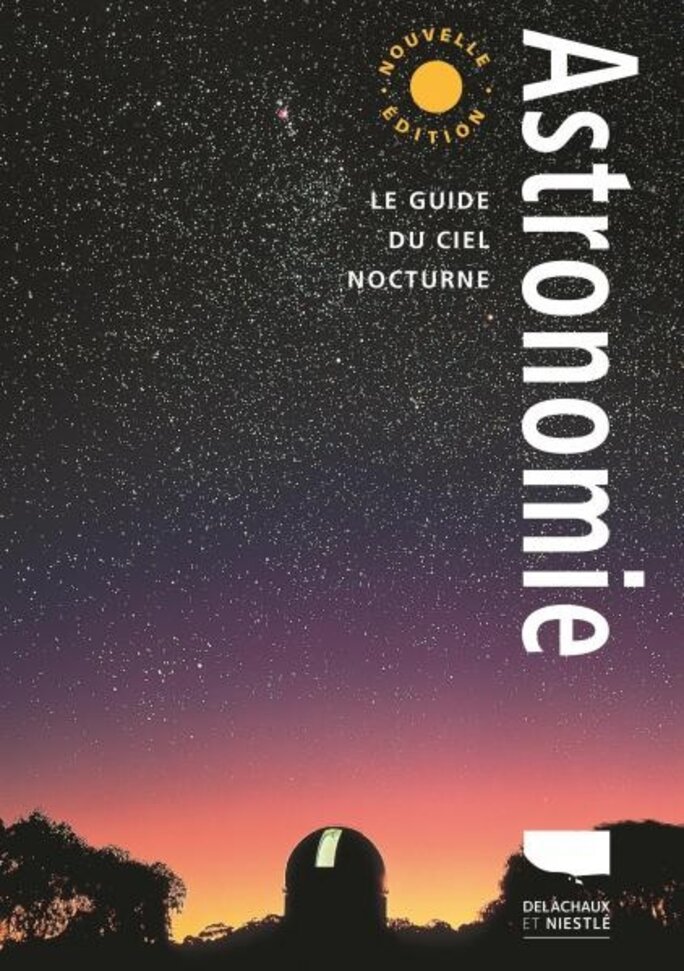
Aujourd’hui, les astrophysiciens explorent toujours les planètes dans notre galaxie, et au-delà. Ils estiment leur nombre à environ mille milliards, et un nombre de galaxies dans l’Univers – mille milliards également, pour Jean-Pierre Luminet[1]. Ils sont de plus en plus nombreux à parier que les humains ne sont pas seuls. La question est celle de la preuve, on ne saurait se contenter de statistiques…

Agrandissement : Illustration 4

Si on en croit l’exobiologie, la discipline qui traite des connaissances en physique, en chimie, en planétologie, en biologie, J.-P. Luminet ne comprend pas, pour autant, comment se fait le saut de la chimie à la biologie. « Il ne suffit pas d’avoir des acides aminés et autres protéines macérant ensemble dans le même chaudron (un solvant universel comme l’eau liquide et de l’énergie) pour fabriquer un être vivant, même microscopique », plaide-t-il. Pour lui, l’argument des milliards de planètes comparables à la Terre, gravitant autour de soleils comme le nôtre, contenant même de l’eau liquide, du carbone et « autres épices nécessaires », n’est pas suffisant pour que la vie y soit apparue automatiquement. Ni même que ce soit « probable ». Puisqu’on ne connaît pas tous les facteurs qui président à l’émergence du vivant. Plus les facteurs sont nombreux, plus leur convergence est improbable. Et comment être sûr que si la vie apparaît ailleurs, elle puisse aller au-delà du stade des bactéries ? Qu’elle débouche sur la conscience ?
Pour les astrophysiciens, la vie sur Terre apparaît il y a 3,8 milliards d’années, sur la Terre « chaude et boursouflée ». Au fond des océans, seules les bactéries ont « vaqué », travaillant comme les briques recherchées par les architectes, « sans plan préconçu ». « Prenez une colonie de bactéries quelconques, laissez-la s’ébattre au soleil, et quand vous reviendrez quelques centaines de millions d’années plus tard, vous pourrez admirer des baobabs, des mousses, des mangues, des coléoptères, des hirondelles, des tyrannosaures ou des ruminants, selon le temps et les ressources locales disponibles ».
Petit retour en arrière. D’Aristote au drapier de Delft Antoine van Leewenhoek qui fabrique un microscope lui permettant de repérer des « animalcules », jusqu’à l’invention du mot « bactérie » en 1838, de Pasteur à Koch, la science a bien fait des bactéries la fameuse brique. J.-P. Luminet gage que « si la Terre flambait d’un bout à l’autre […], la vie, réduite à sa source bactérienne, repartirait vers d’autres aventures et rédigerait de tout nouveaux traités d’histoire ».

Agrandissement : Illustration 5

« La Vie dans le Cosmos » revient sur les conditions physico-chimiques présidant à l’émergence d’une vie extraterrestre. Elle pose la question de savoir comment la Vie est apparue sur Terre. Existe-t-il des sites extraterrestres où l’on peut en trouver des traces, des fossiles ?
Ceux qui penchent pour des mondes habités se réjouissent d’une découverte sur Terre de « bactéries extrémophiles », signifiant que la vie est plus flexible et adaptable. Les déserts, les lieux les plus inhospitaliers ont, on le sait depuis trente ans, une grande activité biologique. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans d’autres mondes galactiques ? Attention, pas de « terrocentrisme » consistant à penser que la vie ailleurs serait comme ici, mettent en garde les astrophysiciens. Pourquoi pas des êtres vivants faits de silicium, de gouttes d’huiles ou de structure gazeuse ? se demande Luminet.
En attendant, dans le petit village du système solaire, il y a peut-être des lieux où il a pu y avoir de l’eau liquide et du carbone (sur Mars, Europe, Titan, Encelade, Callisto, Ganymède et les comètes). Mais dans notre galaxie, il existe des centaines de millions d’exoterres. D’où une réflexion copieuse dans « La Vie dans le Cosmos » sur les exoplanètes, inexistantes dans l’astrophysique il y a seulement trente ans.
Le livre nous titille : les formes de vie que nous connaissons sont-elles uniques, singulières, banales, se déclenchant chaque fois que les conditions sont réunies ? Comme Pascal aimait les paris, pourrions-nous imaginer que nous serions sortis seuls du néant (« à moins que ce soit le doigt de Dieu » ajoute Luminet, admiratif de Michel Ange). Ou alors nous avons des voisins nombreux, cachés quelque part. « Si la vie peut apparaître deux fois, c’est qu’elle peut apparaître mille fois, ou un milliard de fois, c’est du pareil au même ».
Cet excellent outil « La Vie dans le Cosmos » chapitre l’origine de la vie sur la Terre par la reconstitution du chemin qui mène à la vie, imagine des scénarios, le code génétique, donne un visage à LUCA (le dernier ancêtre universel des êtres vivants). Sur la vie extraterrestre, les astrophyisiciens imaginent l’Univers comme un « théâtre biologique », donnent des lieux ayant offert (ou pouvant offrir) les meilleures conditions pour l’émergence d’un certain type de vie, traquent les phénomènes d’expansion de la vie dans le Système solaire, recherchent la vie au-delà et imaginent le contact avec des intelligences lointaines. Avec quel langage cosmique ? Stephen Hawking avait lancé le mouvement : « Le moment est venu de se lancer dans la quête d’une vie en dehors de la Terre. […] Mais attention : une autre civilisation pourrait avoir des milliards d’années d’avance par rapport à la nôtre ».
Ce livre donne le vertige.
----------
[1] Préface de La Vie dans le Cosmos, Glénat/Le Monde, 2023
-----------
Pour aller plus loin :
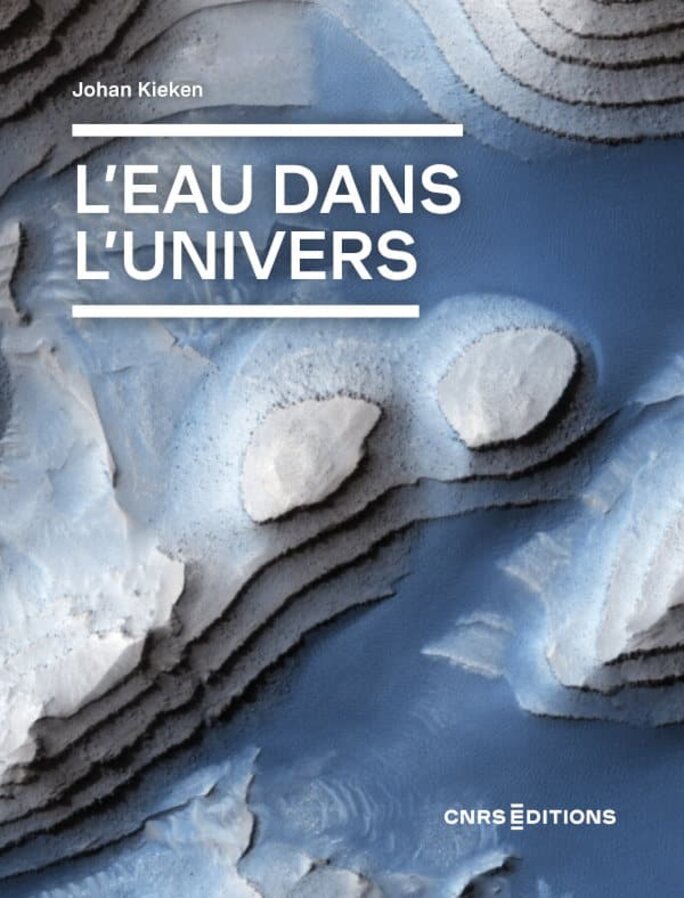
Agrandissement : Illustration 6
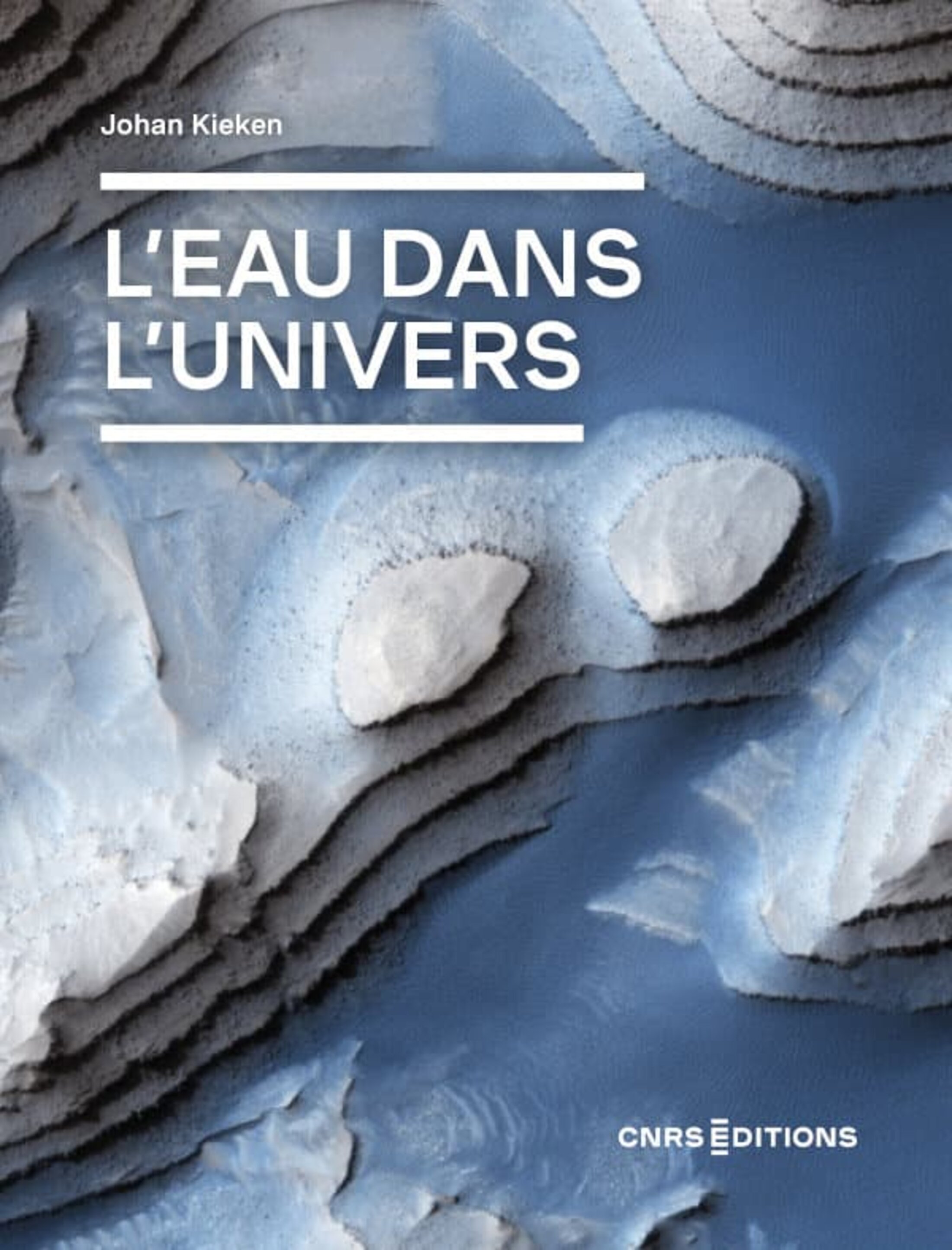
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'eau est universelle : on la détecte partout. Sur Terre, bien sûr, mais aussi à travers tout le Système solaire, dans le milieu interstellaire, dans les galaxies les plus éloignées... et même à la surface des étoiles. C'est grâce aux techniques permettant de détecter l'eau dans notre environnement planétaire proche que les astronomes l'ont trouvée à travers tout l'Univers, dans ses phases gazeuse et solide. Des propriétés physiques et chimiques de l'eau à son apparition sur Terre, des océans hypothétiques cachés sous les glaces des satellites de Jupiter et de Saturne aux disques de matière où naissent des exoplanètes, du passé très reculé de Mars où l'eau liquide semble avoir coulé en abondance au futur lointain de notre planète où toute trace d'eau aura disparu, ce voyage dans l'espace et le temps nous entraîne jusqu'aux confins du cosmos. (Johan Kieken, spécialiste en planétologie, travaille au département Astronomie-astrophysique du Palais de la Découverte. Depuis 2014, il est chargé de médiation pédagogique au département Education et formation d'Universcience (Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l'industrie).
-------------
Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/geographiesenmouvement/



