
Agrandissement : Illustration 1

L’alerte est venue d’un festival littéraire au Bhutan, lorsque le romancier indien Amitav Ghosh expliquait au public que la fonte des glaciers de l’Himalaya stockant les réserves des grands fleuves d’Asie allait impacter l’approvisionnement en eau de 47% de la population mondiale : « Ici se rencontrent les craintes et les rêves liés à l’eau de la moitié de la race humaine »[1]. Cette région se réchauffe deux fois plus vite que le reste du globe. En 2008, on constatait que les glaciers de l’Himalaya avaient perdu toute la glace qui s’y était formée depuis les années 1940. Et selon certaines estimations, un tiers d’entre eux auront disparu d’ici 2050.
Cette annonce glaçante d’une pénurie d’eau catastrophique n’était pas la seule. Au Pakistan, l’Indus qui n’atteint plus la mer tant il est exploité, voit l’eau salée remonter sur 65 kilomètres à l’intérieur des terres engloutissant près de 400 000 ha de terres agricoles[2]. En Inde, la hausse du niveau des mers va entraîner la disparition de presque 600 000 km2 de terres fertiles. En même temps, pas moins de 24% des terres arables indiennes se transforment lentement en désert[3]. Au Vietnam, c’est un dixième de la population qui va devoir se déplacer[4]. En Chine, pays qui nourrit plus de 20% de la population mondiale avec seulement 7% des terres arables du monde, la désertification engendre déjà des pertes directes annuelles de 65 milliards de dollars[5].
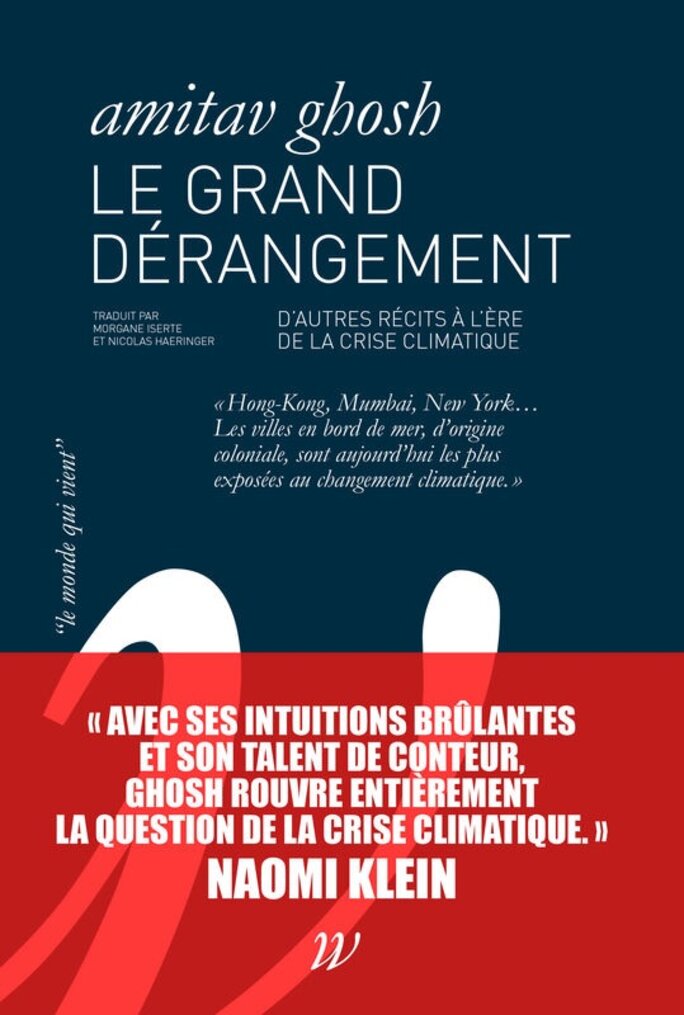
Agrandissement : Illustration 2
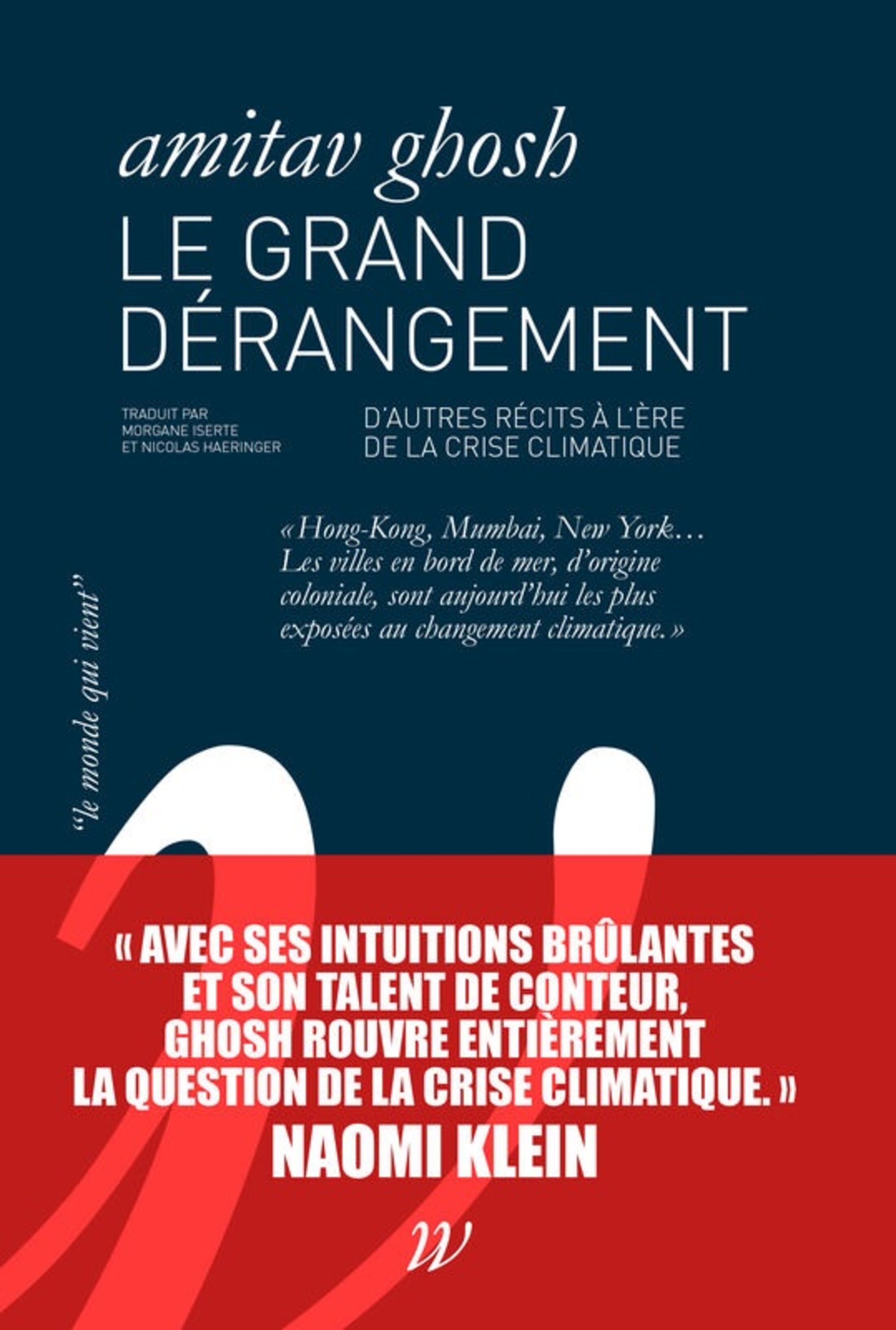
Alors que le monde réalise avec retard que les prévisions scientifiques sur une pandémie possible se sont réalisées depuis le début 2020, Amitav Ghosh enfonce le clou : pourquoi les artistes, les écrivains, les cinéastes ferment les yeux sur le changement climatique – le « grand dérangement » du titre – sinon parce qu’il est terrifiant ?
Ghosh nous dit que nous pourrons regarder l’avenir que si nous acceptons d’en parler, si nous en explorons les prochaines manifestations. Et parler de l’Inde en voie d’être le pays le plus peuplé du monde et gravement menacé, c’est reconnaître la faillite de la « révolution verte » qui prive d’eau les paysans mourant ou migrant vers les villes.
Pour Ghosh, c’est très simple : nos désirs « ont tous quelque chose à voir avec le carbone. Le fermier indien, qui avant savait cultiver des variétés résistantes à la sécheresse comme le millet et l’orge est plus apte à faire face au changement climatique que le citadin de base qui se nourrit de riz »[6]. Il faut travailler à une justice climatique dont les Etats-nations doivent endosser les responsabilités. Pour lui, « La Chine et l’Inde méritent des réparations pour voir choisi des voies plus durables (modèle spartiate ghandien en Inde, politique de l’enfant unique en Chine) alors que l’Occident poursuivait sans frein une économie consumériste et gourmande en carbone." Ce qui l’amène à critiquer sèchement l’accord de Paris à l’issue de la COP21.
L’Inde n’est pas indemne de reproches : pourquoi ne fait-elle pas de compromis sur son développement ? Il faut tout faire pour éviter de nouvelles catastrophes. Car la grande vague va arriver… Et les pauvres du Sud sont dans un canot de sauvetage armé, abandonnés par les riches. A moins qu’ils se montrent plus résilients, comme on le voit dans le cas du Covid pour certains pays.
On reprochera à Ghosh de ne pas donner de solutions. Mais si les scientifiques ne parviennent pas à expliquer au monde ce qui se passe, il faut alors se dire que nous sommes devant un problème de culture. « C’est un problème de nos désirs […]. Si vous voyagez au Moyen Orient ou en Australie, vous verrez des gens qui essaient de faire pousser des pelouses. Ils se servent d’énergies fossiles pour faire de l’eau. Ils purifient l’eau de mer. Et en vrai, pourquoi ? Les gens qui y habitaient il y a 200-300 ans […] ne voulaient pas de pelouses. Alors, d’où vient ce désir ? Il faut penser à toute une histoire, toute une culture de gens qui lisent, peut-être, Jane Austen et qui imaginent la pelouse d’un parc anglais autour d’eux. Cela devient le modèle de la belle vie. Ce que nous poursuivons tous est un modèle de la belle vie qui nous vient de la culture. La fiction forme nos désirs et notre imagination de façon très puissante ». [7]
Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/geographiesenmouvement
[1] https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-etcontemporaine-
2015-1-page-7.htm
[2] A. T. Guzman, Overheated : the Human Cost of Climate Change, Oxford University Press, 2014, p. 156.
[3] L.R. Brown, World on the Edge : How to Prevent Environnemental and Economic Collapse, W.W.Norton, 2011, p. 40.
[4] C. A. Thayer ; « Vietnam », in Climate Change and National Security : A Country Level Analysis, ed. Daniel Moran, Georgetown University Press, 2011, pp. 29-41,30.
[5] J. I. Lewis, « China », in Climate Change and National Security : A Country Level Analysis, pp.9-26. Voir aussi K. Pomeranz, Water, Energy and Politics : Chinese Industrial Revolutions in Global Environnemental Perspective, Bloomsbury, 2017, p.5.
[6] Kavitha Rao, « Le changement climatique, c’est comme la mort, personne ne veut en parler », The Guardian, 8/9/2020.
[7] « Où est le grand roman du changement climatique ». Conversation avec A. Ghosh, par S. Paulson, The Los Angeles Review of Books.
L'auteur : Né en 1956 à Calcutta, Amitav Ghosh est l’un des plus importants écrivains anglophones contemporains. Mondialement reconnu pour ses vastes romans historiques comme Un océan de pavots (2010, sélection Booker Prize) et Les Feux du Bengale (Prix Médicis étranger, 1990), et également salué pour ses essais (par Giorgio Agamben, Naomi Klein, Roy Scranton...), Ghosh est considéré comme l’un des plus grands penseurs de l’Anthropocène.
La question du changement climatique, auparavant présente à l’arrière-plan de son œuvre, est au cœur du Grand Dérangement. Cet essai a également inspiré son dernier roman, Gun Island.
Pour en savoir plus : Editions Wildproject



