D’autres mesures viennent compléter ce tableau des grandes orientations à des fins très urbaines:
- la relocalisation, dorénavant promue, d’activités dans les régions au nom de la souveraineté économique (avec notamment la multiplication des sites industriels d’énergies renouvelables dans les campagnes - EnR);
- la libéralisation des pratiques agricoles intensives bénéficiant de la préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers dans le cadre du ZAN;
- des réglementations visant à contraindre l’usage domestique des sols dans les mêmes ruralités (autorisation nécessaire pour grands abris de jardin, interdictions du stockage domestique d’eau, dissuasion des habitats légers et mobiles…);
- le tout en continuant à y implanter des grands équipements pour desservir toujours plus les grandes villes (systèmes autoroutiers et RER Métropolitains, notamment)…
Sinon d’essence tout du moins de justification urbaine, cette armada institutionnelle/législative a pour conséquence de conditionner la totalité des choix d’aménagement. Or, comme chacune et chacun l’aura remarqué, ces mesures sont loin de faire l’unanimité. Il existe même, comme l’actualité récente l’a rappelé, des clivages croissants, entre villes et campagnes justement. Avec des effets électoraux de plus en plus tangibles eu égards aux fractures revêtues (progressisme métropolitain vs conservatisme des campagnes).
Mais, n’est-ce pas pour améliorer la situation et limiter les conséquences écologiques de nos habitats et modes de vie que de telles dispositions sont prises ? Consistant à décarboner les circulations urbaines, les ZFE n’ont-elles pas été instaurées pour réduire les pollutions et le ZAN, visant à limiter les droits à la construction et l’artificialisation des sols ? Les parcs éoliens cherchent bien à réduire nos productions carbonées, de même qu’une ville du quart d’heure, qui souhaite satisfaire les besoins nécessaires à moins de quinze minutes de chez soi, à améliorer la qualité des services de proximité… En quoi cela fait-il problème ?
Le grief premier depuis un extérieur plus ou moins éloigné des grandes densités est que cette écologie, que certains qualifient de bourgeoise[1], non seulement donnerait le la des politiques menées mais, surtout, s’imposerait partout selon un même schème comportemental dominant, orienté vers l’électro-mobilité, les éco-quartiers, les épiceries bio… et l’éco-citoyenneté.
En clair, des modes de vie métropolisés et leur culturalité, dont la prétendue soutenabilité reste encore à démontrer. Se prévalant d’une conscience écologique tout en faisant souvent fi de la diversité des environnements de vie, exploitant l’ensemble des écosystèmes en dehors de toute réciprocité tangible et matérielle, ces modes de vie uniformisent espaces et conduites, reléguant les autres formes d’habiter.
Deuxième problème, cette imposition perpétue une asymétrie ; celle du primat des pensées d’un développement, dorénavant durable et urbain, sur les territoires finalement encore considérés comme inféodés et servants.
L’asymétrie historique des relations villes-campagnes est ainsi poursuivie voire amplifiée, cette fois-ci au nom d’une certaine écologie et de sa territorialité. Dès lors, loin de produire une harmonie villes-campagnes pourtant promue par les pensées dominantes car posée comme essentielle à l’écologie préconisée (omettant de dire que l’harmonie recherchée est historiquement l’argument des gagnants)[2], le fossé se creuse, les rapports se tendent et surtout les fractures sont de plus en plus béantes.
C’est l’exemple des vives critiques adressées à la mise en place et la systématisation des ZFE. Alors même que seules quatre agglomérations excluront environ 30 % de leur parc automobile et surtout que des mesures d’accompagnement sont proposées[3], au final seules Paris et Lyon se verraient imposées à la suite des récents débats critiques auxquels la mise en place des ZFE a pu conduire.
Pourquoi ? C’est bien là la représentation d’une dichotomie croissante entre des mesures métropolitaines pour une écologie urbaine et la réalité des territoires environnants, les habitants et habitantes des seconds étant sommés d’adopter des pratiques inadaptées à leur quotidien et à leur espace d’habiter[4].
Plus encore, la ZFE véhiculerait une disqualification des territoires extérieurs, le solutionnisme métropolitain se présentant comme plus légitime car mobilisé depuis les espaces concentrant les grandes institutions du pouvoir et des savoirs.
Or, et là est un angle mort des débats relayés, les conditions géographiques de production de ressources ont commencé à changer, et cela va s’accélérer. La descente énergétique et la compression matérielle sont engagées, enjoignant un rapprochement de chacune et chacun des activités nécessaires à sa propre subsistance (alimentaire, énergétique, matérielle…).
Largement déliée de cette option, et ce par effets de densité et ce faisant d’artificialité, cette écologie urbaine est, bien que de bonne volonté, notoirement inadaptée aux crises engagées, pour ne pas dire aggravante des situations qu’elle cherche à améliorer, continuant de considérer les ruralités comme des espaces aux ressources dont il faudrait disposer (par l’agriculture et l’élevage industriel, par l’exploitation forestière ou l’extraction minière…).
Les luttes et mobilisations apparues ces dix dernières années en constituent des témoins, comme celles contre les projets de mégabassines visant à accroître techniquement les rendements agricoles pour alimenter les marchés urbains, ou celles contre l’A69, autoroute pensée pour desservir une métropole déjà estampillée (Toulouse) et une ville souhaitant en avoir les colifichets (Castres). Et nous ne parlerons pas des oppositions croissantes aux parcs éoliens ou aux centrales agrivoltaïques.
Loin d’être envisagées comme les espaces premiers de l’avenir écologique, les ruralités restent les territoires servants du développement urbain et métropolitain, perpétuant sentiment d’abondance et surtout mythe de la délivrance[5].
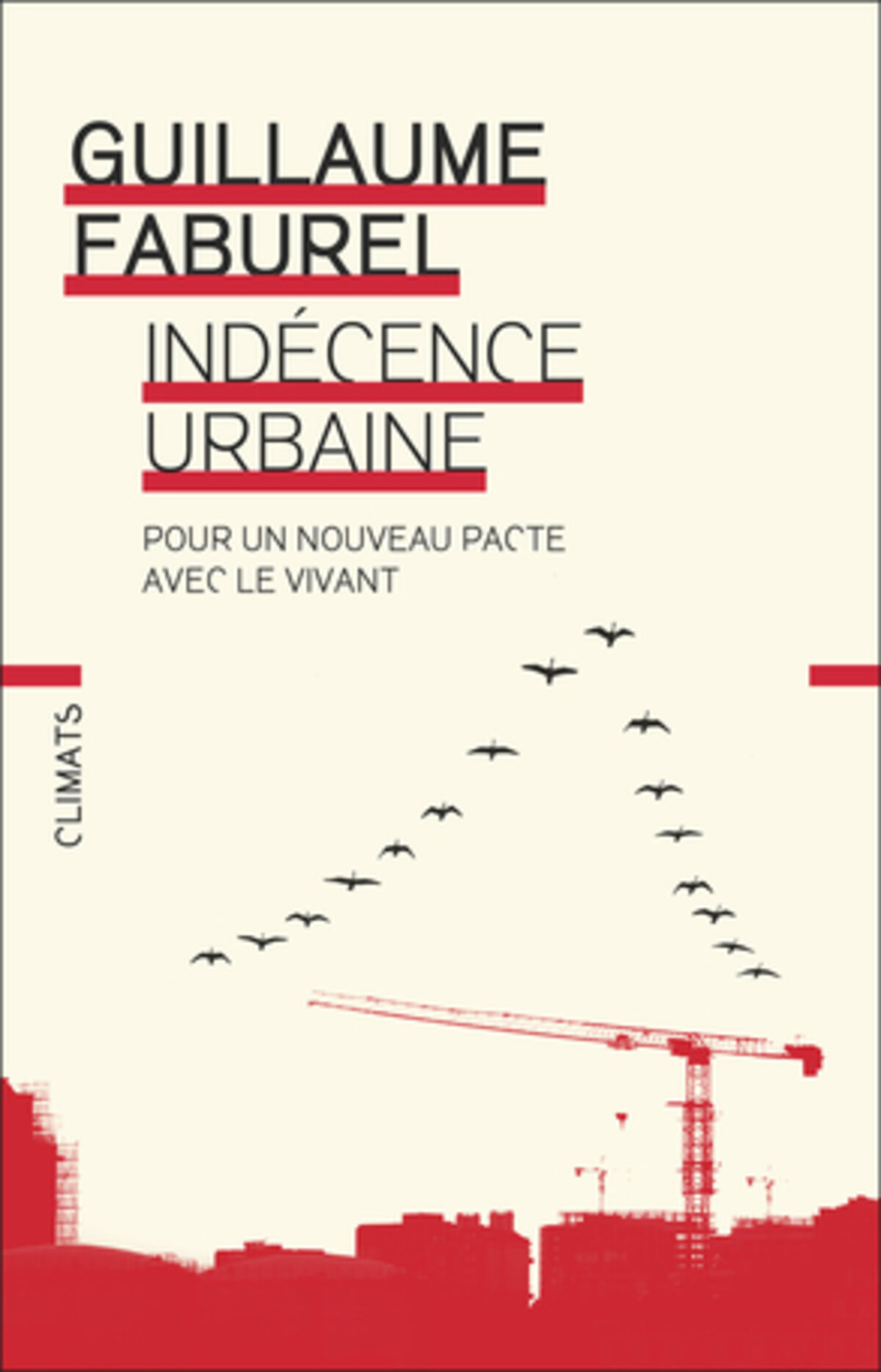
Si l’on souhaite prendre au sérieux la limite des ressources, et ce faisant les conditions mutantes de nos subsistances du fait de la dégradation rapide de tous les environnements, c’est à une tout autre écologie qu’il conviendrait de s’atteler: ruraliser toutes nos manières de penser et d’agir.
Il en va sans doute des conditions d’habitabilité, d’ici 30 à 40 ans tout au plus, de l’ensemble des sociétés[6]. C’est à une inversion qu’il conviendrait de travailler, lorsque l’asymétrie historique villes-campagnes, dorénavant amplifiée par l’écologie urbaine, nous maintient dans l’inertie.
Les campagnes sont les seuls espaces tangibles de la transition et de la bifurcation... à condition de les comprendre autrement, ce que le tropisme urbain ne permet nullement en multipliant les plans de friction, entre chasseurs et cyclistes, chimie de synthèse et permaculture, régimes carnés et véganisme…
Pour ce faire, quelques modèles d’analyse sont selon nous à remettre au goût du jour, tel celui de centre-périphéries, dont les discours installés s’évertuent à nier le bien-fondé (cf. controverse autour des écrits de Christophe Guilluy), ou encore celui liant cosmopolitiques de la nature et les cultures du vivant, en réinvestissant les communs propres au paysannat et à l’artisanat notamment. Ce sera l’objet de deux autres articles à venir pour Géographies en mouvement.
*
[1]Clément Sénéchal, 2024, Pourquoi l’écologie perd toujours, Seuil.
[2]Magali Talandier, 2020, «Opposer ville et campagne ne nous fera pas avancer», Le Monde, 1er juin
[3]Aide au changement de voitures, circulation libre le weekend, 24 journées autorisée en semaines à l’année…
[4]Que penser, par exemple, de l’injonction aux mobilités douces lorsque, du fait même de la distance, le temps d’accès aux services quotidiens par l’usage du vélo (par exemple) pourrait varier du simple au triple entre les espaces urbains et ruraux?
[5]Aurélien Berlan, 2021, Terre et Liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur.
[6]Guillaume Faburel, 2023, Indécence urbaine. Pour un nouveau pacte avec le vivant, Climats-Flammarion.
----------
À Lire
Guillaume Faburel, Indécence urbaine. Pour un nouveau pacte avec le vivant, Paris, Flammarion, 2023.
----------
Sur le blog
«Guillaume Faburel: "Il faut en finir avec le genre métropolitain"» (Renaud Duterme)
«Les campagnes, décors pour citadins?» (Renaud Duterme)
«Fragiles métropoles» (Gilles Fumey)
----------
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/
Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social



