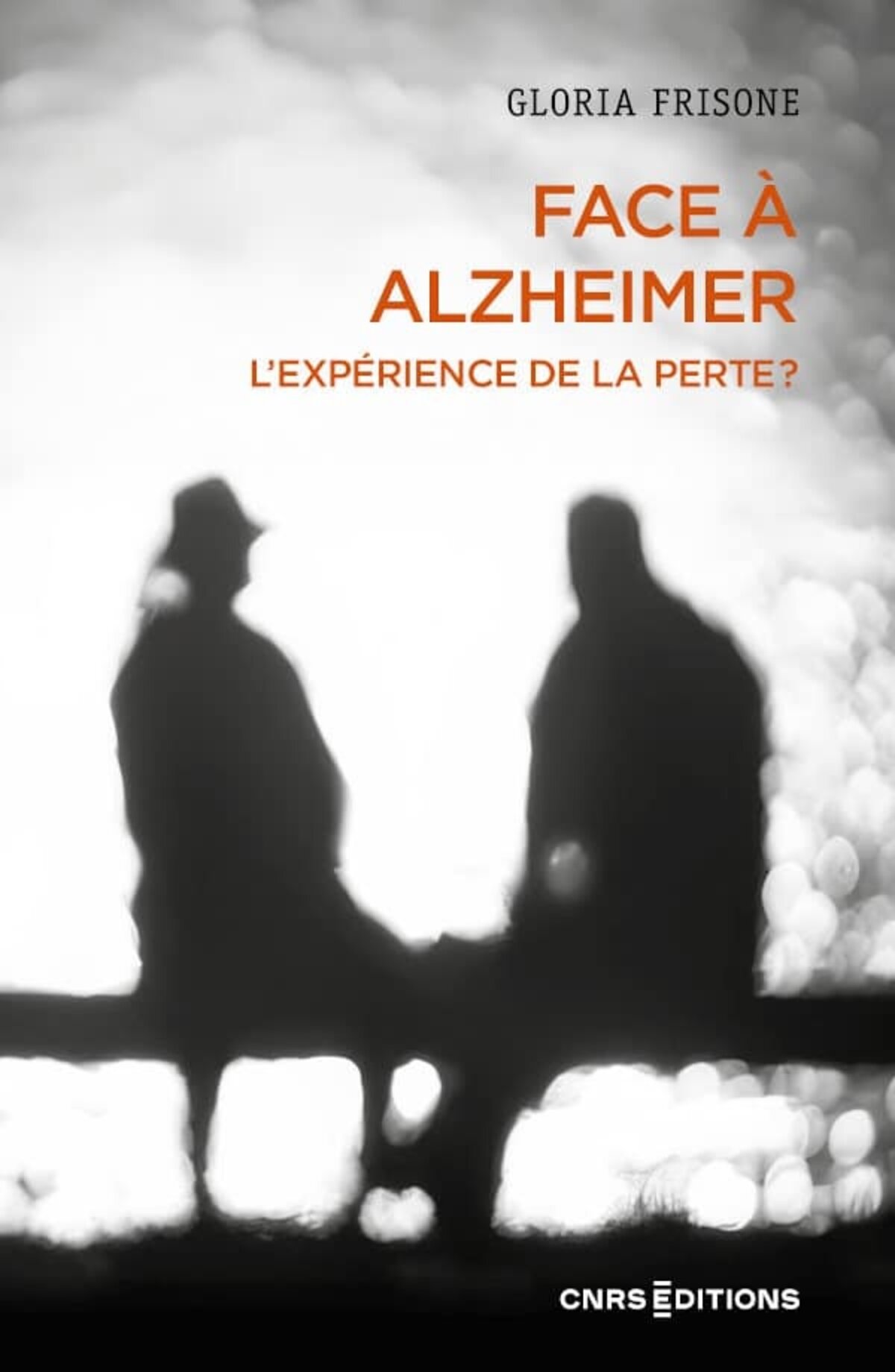
Agrandissement : Illustration 1
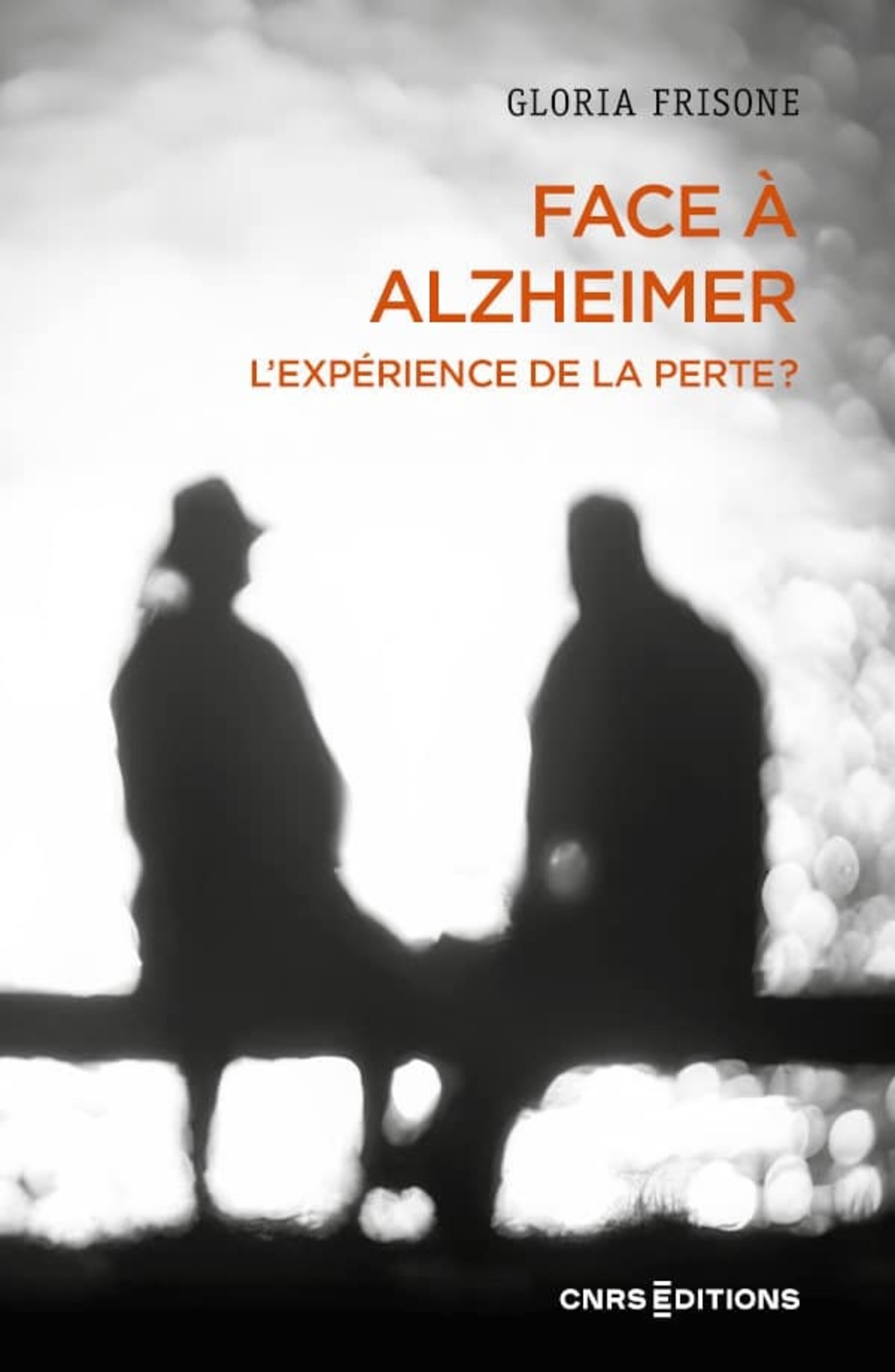
Quand on est atteint par la démence, lentement ou non, la mémoire des lieux s’effrite, finit par s’effacer, ceux qui sont atteints de cette pathologie neuro-dégénérative perdent leur autonomie. Car l’expérience humaine est à la fois un apprentissage des lieux pendant l’enfance et, parfois, une perte lente ou brutale, liée à une chute ou à une pathologie cognitive.
Mise au point dans les années 1990, la gériatrie œuvre avec les politiques à imaginer comment soigner les 55 millions de personnes atteintes dans le monde de ces troubles de l’Alzheimer. Sous l’influence de la gériatrie mondiale dominée par une approche étatsunienne, les maladies neurodégénératives sont expliquées par un prisme scientifique, poussant la santé publique à mieux comprendre la notion de fragilité, marquée par des désavantages sociaux auxquels s’ajoute la perte d’autonomie et la dépendance physique et psychique.
Simone de Beauvoir, comme, du reste, De Gaulle («la vieillesse est un naufrage») et bien d’autres ont installé dans la culture française le fatalisme de la décrépitude, menant à une vision alarmiste du grand âge perçu comme une maladie. L’anthropologue Gloria Frisone (Ehess/université de Pavie et Milan-Bicocca) veut dépasser l’approche purement biomédicale. Elle relit les travaux d’Aloïs Alzheimer au début du 20e siècle sur le cerveau d’une patiente de cinquante et un ans, qui avaient défini la norme de la sénescence comme une maladie.
Fortement critiquée par les sociologues américains qui combattent l’idée de «vieillissement réussi» ou de «mort sociale», les Français ont privilégié l’idée de «déprise». Ils contestent le rôle de l’État, comme le faisait Foucault qui refuse les catégories de subjectivation, les personnes atteintes ne subissant pas passivement leur état de santé qui les expose souvent à la violence ou menace leur survivance. La maladie d’Alzheimer ne doit pas conduire les personnes à être des non-sujets, conduits à une «déposition de soi» voire comme une déshumanisation, une «mort anticipée». Face à une société qui médicalise la vieillesse, Michel Billé dans La société malade d’Alzheimer (Erès, 2014) inverse l’ordre des termes : ce n’est pas le vieux dément qui est malade, mais la société qui aurait développé les symptômes de la maladie, tels que la perte d’orientation dans l’espace. Gloria Frisone rappelle qu’en Chine et au Japon, la dégénérescence des anciens est considérée comme naturelle, ne nécessitant pas de soins, et qu’en Inde, elle est perçue comme une forme de sagesse mystique.
Victimes
Que dit l’anthropologie médicale ? Depuis Marcel Mauss, le corps individuel est vu comme un corps social, le trouble est perçu comme une construction par des pratiques techniques, des narrations. Ce «constructivisme social» est quand même difficile à accepter, tant la maladie d’Alzheimer est invalidante.
Gloria Frisone explore la maladie comme une altération, puis comme une pathologie, avant de la voir comme un malaise. Dans l’Histoire de la folie, Foucault montrait comment l’institution de la folie a délimité l’espace d’exclusion sociale (et la normalisation) ; tout comme l’Alzheimer, vu comme une nouvelle figure de l’aliénation, où l’on perd son statut juridique, son autonomie et l’on devient une «victime innocente» et ceux qui l’accompagnent des «victimes sacrificielles», entraînant accusations et culpabilisations réciproques.
Remontons le temps. Cette vieillesse dans l’Antiquité, comment est-elle perçue? Age de la sagesse ou âge sénile? Les deux. Même si on préfère retenir Sénèque et Marc-Aurèle la pensant comme une vie propice à la méditation, Cicéron parlant de «couronnement de la vie». Globalement, la vision est très négative et le restera durant toute l’histoire. Elle intéresse la médecine à partir du 17e siècle, l’accroissement de l’espérance de vie poussant à créer les premiers hospices, notamment dans les campagnes où les vieux sont souvent abandonnés par leurs enfants partis en ville pour travailler. Au départ, la charité publique prend le relais. De nouveaux discours apparaissent ici ou là, notamment celui de Joseph-Henri Réveillé-Parise en 1845, affirmant que la faiblesse physique des vieillards les «amène à descendre en eux-mêmes, dans la vie intérieure, calme et sereine». Les artistes s’en emparent, y compris le cinéma, comme les Suédois filmant «Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire» (2014), donnant à voir un centenaire qui s’enfuit de sa maison de retraite le jour de ses cent ans... La réalité est souvent moins drôle : «à 44 ans, je suis devenu la mère de ma mère» se désole une jeune maman. Le peintre Gérard Alary a saisi sur les toiles les «trois vies de (sa) mère» (2007). Cette exploration de la maladie l’a questionné sur la vision tragi-comique de la vie et de la mort, notamment lorsque sa mère, «femme austère» devient, grâce à la maladie, «rigolote, capable de dire des choses dingues». Alary pense qu’il faut redéfinir notre définition de l’humanité, «non pas dans le sens du monstrueux, mais plutôt de la transcendance». Mais rien n’est simple, tout le monde n’a pas la capacité de porter un regard positif sur ce qu’on voit beaucoup comme une tragédie. Annie Ernaux écrit des pages terribles dans Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997) sur la perte de soi de sa mère.
Images
Gloria Frisone explique avec Marcel Mauss que l’usage des masques dans le théâtre gréco-romain nous a façonné deux identités : une, extérieure avec notre image sociale par laquelle nous sommes reconnus par les autres et l’autre, intime, notre vraie essence individuelle. L’Alzheimer affecte les deux. La perte d’autonomie se marque surtout par la disparition de repères spatiaux. «Je me sens perdu», dit le malade qui ne «sait plus où il est». Cela commence souvent par se perdre dans la rue. La personne atteinte vit dans ce qu’elle voit autour d’elle, pas plus. Elle est désorientée et se sent mise en danger. Ne survivent que des perceptions sensorielles, des émotions, quelques relations significatives, la mémoire ancienne, les souvenirs les plus intimes.
Aloïs Alzheimer (1864-1915) a œuvré à soustraire la démence sénile de la psychiatrie, pour la confier aux neurologues. Dans les années 1970, la maladie est traitée par la médecine préventive aux Etats-Unis et en Angleterre, sans résultats probants malgré toutes les médications qui ont été essayées. Le premier Plan Alzheimer est signé en 2001 par le ministre Kouchner, suivi d’autres programmes. Les professionnels sont «contre la société [qui reproche] l’isolement des vieux» et veut croire à l’éternelle jeunesse. Il n’empêche. Pour Gloria Frisone, «le malade d’Alzheimer résiste à l’enfermement dans le monde de la non-existence, dans le monde des non-sujets». Ce qui veut dire qu’il faut penser les malades d’Alzheimer non plus comme des sujets en pleine disparition d’eux-mêmes, ou pire comme des morts vivants, «mais malgré leur déficit cognitif comme étant les mêmes personnes». Cela est dit.
----
Sur notre blog
Pour nous suivre sur Facebook : https://facebook.com/geographiesenmouvement/



