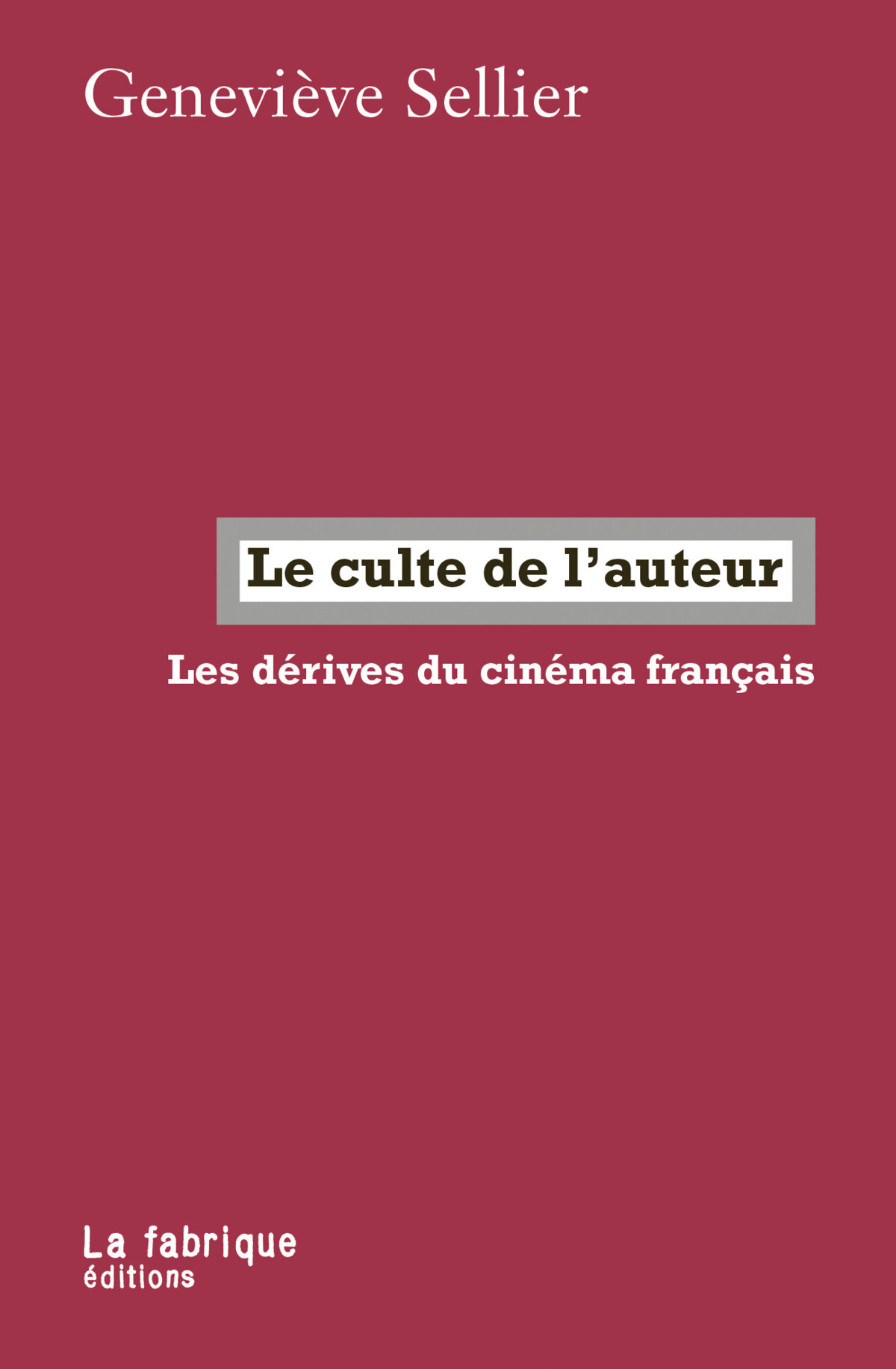
Agrandissement : Illustration 1

«Le livre est très mauvais.» C’est le verdict du podcast Sortie de secours du 5 octobre dernier. Il résume la teneur de la dispute autour de l’essai Le culte de l’auteur – dont Mediapart a proposé une synthèse. La formule ne manque pas d’une certaine ironie, tant la suite de l’émission n’en finit pas de revenir au même reproche: dans son livre, Geneviève Sellier se discréditerait – et son propos avec – par des formules à l’emporte-pièce.
C’est celui qui dit qui est
Explication des critiques de Sortie de secours: l’autrice ferait état, 250 pages durant, de sa «bêtise» et/ou de son «ignorance». Prétendant «réfléchir au cinéma», elle ferait en réalité l’étalage de son manque de travail – théorique, d’analyse, de recherche. Conclusion sans appel: ce qui anime l’essai de Geneviève Sellier, c’est le «seum». Jalouse, elle ne supporte pas la jouissance des autres – celle des cinéastes, mais aussi celle d’actrices satisfaites de la sexualisation de leur corps à l’écran.
Ce n’est pas rien, au nom la rigueur intellectuelle, de passer par pertes et profits plusieurs décennies de production intellectuelle d’une universitaire reconnue dans son champ, le tout en moins de vingt-cinq minutes de «débat». Ce n’est pas rien de commencer une phrase par «Moi, mon idée, c’est que…» pour réfuter les analyses d’une autre chercheuse, Michelle Coquillat, sur l’émergence de la figure du génie artistique détaché des contingences sociales à l’époque romantique, au 19e siècle, figure porteuse d’une misogynie structurelle.
Ce n’est pas rien de reprocher quelques formules choc à un essai au ton volontairement polémique, quand la critique, des Cahiers du cinéma à Canal+ en passant par France Inter, est depuis longtemps le lieu par excellence de la petite formule qui fait mouche, de l’association d’idées hasardeuse mais qui en met plein la vue, de l’argument d’autorité, de la répartie satisfaite, de la mise en scène de soi en spectateur éclairé…
…et de la mauvaise foi. On croit rêver quand Samir Ardjoum, menant une interview de Geneviève Sellier digne d’un interrogatoire, qualifie les premiers films de Godard – Á bout de souffle, Une femme est une femme… – de «féministes». Lunaire. Comme s’il était impossible de saluer l’apport formel d’un Godard, d’un Truffaut ou d’un Hitchcock sans s’interdire d’admettre aussi le caractère masculino-centré de leur cinéma et la tendance de celui-ci à reproduire et valider les schémas patriarcaux de son époque. Comme s’il était impossible de déceler, même chez le Godard militant de la deuxième moitié des années 1960 et du début des années 1970, un aveuglement – alors banal jusqu’à l’extrême gauche et dans les milieux libertaires – quant aux enjeux de la domination masculine.
Crise de légitimité
Le culte de l’auteur se contente, pour l’essentiel, de défendre une thèse raisonnable: la sacralisation de la figure de l’auteur et de son projet esthétique a servi – sciemment ou non, peu importe – d’alibi à des contenus réactionnaires, tant à propos des rapports de genres que de classes et de races. Thèse corollaire: les violences sexuelles gangrénant le cinéma français, objet d’un récent et salutaire intérêt médiatique, appellent une analyse à l’aune de ce cadre idéologique de l’auteur-artiste intouchable.
Il s’agit donc de questionner les présupposés d’un cinéma perçu et se percevant avec satisfaction comme loin des productions dites «grand public» et de leurs stéréotypes sociaux. Et de rappeler au passage que la bourgeoisie intellectuelle, comme son cinéma et les autres objets culturels qu’elle produit et consomme, n’est pas immunisée, ça se saurait, contre le racisme, la misogynie et la fausse conscience.
Rien de monstrueux. Mais alors, comment expliquer la violence du tir de barrage de la critique professionnelle contre l’essai de Geneviève Sellier? À un premier niveau, on devine une bonne dose de corporatisme, mêlée à un instinct collectif de survie. C’est une profession qu’on assassine en s’en prenant à «l’auteur», son outil de travail-objet transitionnel, tout en attaquant ses idoles anciennes et nouvelles, de Truffaut à Desplechin en passant par Rohmer. Une profession prompte à surréagir car fragilisée par l’agonie lente mais sûre de la presse écrite et la démocratisation de la critique amateure, celle-ci venant battre en brèche la légitimité des gardiens du temple du beau et du laid. D’autant que la comparaison avec telle chaîne YouTube ou tel blog est loin de toujours tourner à l’avantage des professionnels, dont le statut dépend de l’adoubement par leurs pairs. Bref, le roi est nu et il le sait.
L’esthétique contre les sciences sociales?
On peut aussi voir dans ce psychodrame un énième épisode du dialogue de sourds entre critique (cinéma) et sciences sociales, dont le chercheur Mathias Kusnierz a documenté un épisode exemplaire il y a une décennie. Si l’on en croit celles et ceux qui, par leur position dans le champ médiatique, ont la possibilité de s’exprimer publiquement sur le sujet, les deux bords, irréconciliables, évoluent dans des mondes parallèles.
Dans l’un règnent l’esthétique au sens kantien, l’intertextualité, le panthéon des grandes œuvres, la gratuité du geste de l’artiste et la beauté pure d’un montage alterné ou d’un fondu enchaîné. On s’extasie devant la virtuosité, on repère des références, on invoque Bazin et Daney et, pour faire bonne figure, on glisse une citation de Deleuze ici ou là. Et on évite – sauf pour le stigmatiser dans le cinéma dit «populaire» – de trop parler du contenu, de ce que le film exprime sur le monde, question trop triviale.
Dans l’autre monde, celui des sociologues, historiens, anthropologues ou géographes, on écrase les œuvres, on les réduit à des objets d’enquête parmi d’autres. On passe les films au crible de causalités sociopolitiques, le cas échéant pour en faire les révélateurs d’une société – ses lapsus, disait l’historien Marc Ferro. Le tout contaminé, via les Cultural Studies et leur descendance – Gender Studies, Visual Studies, Postcolonial Studies –, par le puritanisme nord-américain: ne comprenant rien à la beauté, on la juge à l’aune de la morale. C’est un monde d’universitaires coincés dans leurs champs ultraspécialisés, qui n’aiment pas le cinéma, ne jouissent pas devant l’écran, mais décèlent dans les images et les histoires qu’elles racontent des stéréotypes et la reproduction, consciente ou non, de mécanismes de domination.
Alors, sacrilège parmi d’autres, on voit Rocky non plus comme le récit intimiste et sensible d’un héros de la working class, mais comme un pamphlet au service de l’idéologie reaganienne, symptôme du racisme et du sexisme ordinaires de l’Amérique de la fin des années 1970. Ou bien on voit dans À bout de souffle la reproduction d’une figure de femme réduite à un objet de désir masculin et à l’incarnation d’une fatalité susceptible de s’abattre sur le héros, un homme, bien sûr – voir les travaux de Geneviève Sellier sur la Nouvelle Vague.
Mais, et c’est où l’on voulait en venir, le problème n’est pas la caricature du travail universitaire, surtout révélatrice de l’ignorance de celles et ceux qui le dénigrent de magazine en studio de radio. Le problème tient à cette opposition-même, conceptuellement fragile et pas toujours clairement assumée, entre approche «esthétique» et analyse «scientifique», entre étude de la forme (artistique) et travail sur le contenu (social, politique, etc.). Une telle catégorisation tend à recouvrir celle, non moins fragile, entre d’un côté la critique et la philosophie, avec leur capacité supposée à totaliser et, de l’autre, les sciences sociales, prétendument condamnées à un savoir parcellaire.
Elle rappelle, dans son principe, le faux débat que décrivait le sociologue nord-américain Charles Wright Mills, dressant le portrait des sciences sociales au milieu du 20e siècle: d’un côté, les adeptes de la «théorie grandiose» élaborent des cathédrales théoriques résumant les grands enjeux de la société, mais se soucient trop rarement de recueillir des données rigoureuses; de l’autre, les défenseurs de «l’empirisme abstrait» multiplient les enquêtes statistiques ultrapointues sur le modèle des sciences dures mais n’arrivent jamais à des généralités théoriques. En conclusion, Wright Mills renvoyait tout le monde dos à dos, l’air de dire que l’important est ailleurs: dans l’indépendance de la recherche, dans la volonté d’étendre le champ des connaissances, dans l’ouverture à la diversité des méthodes et dans l’effort d’objectivité et de rigueur permettant un dialogue scientifique constructif.
Opposer esthétique et science relève du même type de débat stérile, occultant la richesse des approches de part et d’autre – entre influences croisées des Cultural Studies, de la psychanalyse, des marxismes plus ou moins orthodoxes, du positivisme, du post-structuralisme, etc. Dans les faits, nombre d’enquêtes passionnantes, rarement d’ailleurs les plus médiatisées, se souciant peu du découpage artificiel entre esthétique et contenu, s’emparent des films dans toute leur complexité.
À titre d’exemple, et pour rester dans le domaine du genre, la chercheuse italo-britannique Stella Bruzzi a théorisé, nombreuses analyses à l’appui, l’existence d’un «cinéma d’hommes» définissable par son style et pas seulement par des histoires et des personnages. Le rythme, l’articulation entre musique et mouvement, ou encore l’usage des ralentis génèrent une expérience spectatorielle particulière, visant à générer une identification forte du public avec des personnages masculins en action. On parle bien ici d’une esthétique, indissociable du contenu: la reproduction de la masculinité hégémonique dans Top Gun ou Mission impossible se joue dans la mise en scène autant que dans l’intrigue et les dialogues.
Critique de la critique pas critique
Opposer contenant et contenu, forme et fond, c’est aller contre la Nouvelle Vague elle-même, dont les théoriciens n’ont cessé de répéter: le fond, c’est la forme. Ce qui ne veut pas dire que la forme se suffit à elle-même mais que ce qu’on raconte et la manière dont on le raconte font système – c’est le sens du fameux texte de Jacques Rivette sur Kapo, inaugurant un débat encore vivace sur la manière de (ne pas) filmer la Shoah.
C’est aussi aller à contre-courant des avant-gardes artistiques du 20e siècle. Dada, les surréalistes ou les situationnistes voyaient dans l’art un outil de transformation du monde, dans leurs innovations formelles un moyen de subvertir les structures de la société bourgeoise. À rebours des défenseurs de l’art pour l’art, les avant-gardes concevaient leur propre disparition au profit de nouvelles formes de vie.
C’est, enfin, défendre une vision réductrice de l’esthétique, conçue comme une réalité autonome, hors du monde. C’est adopter une posture de renoncement, dans un monde vidé de ses espérances révolutionnaires. François Cusset a documenté ce glissement de la culture, au tournant des années 1980, vers une fonction de «refuge coupé du monde extérieur». On peut, ajoute l’historien des idées, «s’y esbaudir, ou au contraire y déprimer, en tout cas y survivre au désastre». Et pourquoi pas s’en accommoder sans trop de regrets, pour celles et ceux n’ayant pas connu de première main l’agitation politique des années 1960 et 1970. L’esthétique devient le lieu d’où nous parlent des artistes et des critiques cherchant à échapper à une réalité sociale qu’ils et elles n’espèrent plus changer – tout en acceptant d’être rémunérés par Bolloré, car il faut bien vivre.
Renoncement, accommodement, cynisme… L’opposition ne se joue pas entre la critique et la science. Elle se joue entre celles et ceux qui, de part et d’autre de cette séparation artificielle, s’accordent pour produire un art et un savoir neutres et sans conséquences; et celles et ceux qui, au contraire, conçoivent le savoir et l’art comme des supports de contestation du statu quo et des systèmes de domination dont il est porteur.
Dans cette optique, le cinéma doit avoir la capacité de changer notre regard sur le monde et, pourquoi pas, de nous aider à penser son changement radical. Pourquoi ne pas exiger que le beau soit aussi engagé, et qu’il soit beau aussi parce qu’il est engagé?
----------
Geneviève Sellier, Le Culte de l’auteur. Les dérives du cinéma français, La Fabrique, 2024.
----------
À lire
Stella Bruzzi, Men’s Cinema. Masculinity and Mise en Scène in Hollywood, Edinburgh University Press, 2013.
François Cusset, La droitisation du monde, Textuel, 2016.
Mathias Kusnierz, «La haine du renouvellement théorique: enquête sur la querelle théorique de la critique cinéphile et de l’Université française», Mise au point n°8, 2016.
Geneviève Sellier, La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier, CNRS éditions, 2005 (réédition en 2025 chez Amsterdam).
Charles Wright Mills, L’imagination sociologique, La Découverte, 2006 (1959).
----------
Sur le blog
«Saint Tom Cruise, priez pour nous» (Manouk Borzakian)
«La géographie c’est de droite?» (Manouk Borzakian)
«James Bond, Woke un autre jour» (Nashidil Riouaï et Manouk Borzakian)
«Rocky, les gants de boxe de la droite américaine» (Manouk Borzakian)
----------
Pour nous suivre sur Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/



