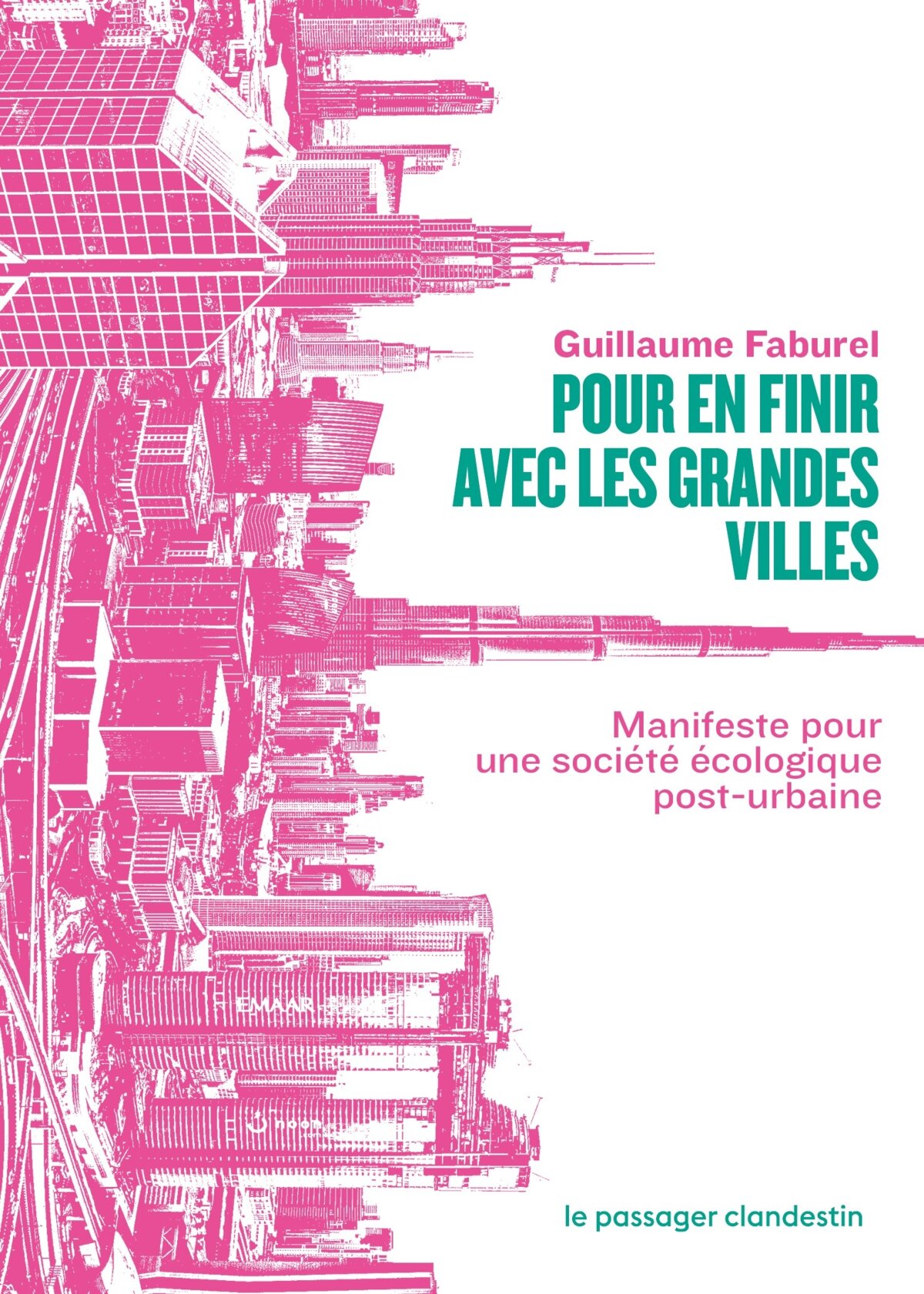
Agrandissement : Illustration 1
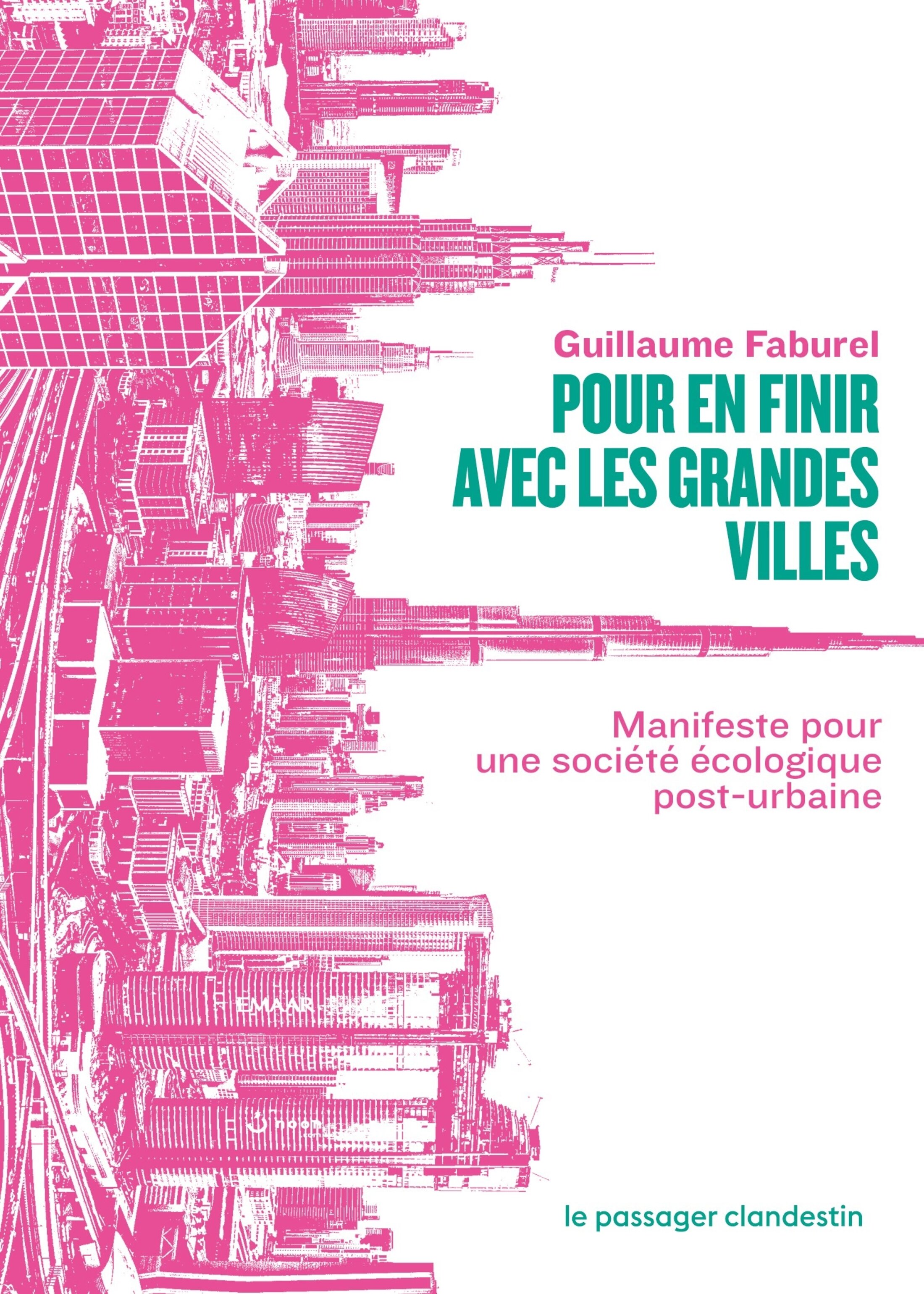
Géographies en mouvement – Les titres de vos deux derniers ouvrages (Pour en finir avec les grandes villes, 2020, et Les Métropoles barbares, 2019) sont pour le moins explicites. Que reprochez-vous donc aux grandes villes ?
Guillaume Faburel – Il y a évidemment les maux sociologiques qui commencent à être assez connus tels que la gentrification et la ségrégation, mais surtout l’éviction des plus pauvres. Mais, il existe trois autres types de problèmes moins renseignés et étroitement reliés.
Premièrement, les grandes villes artificialisent de plus en plus les espaces de vie et plus encore l’entièreté des territoires pour les alimenter (ce qui est désastreux du seul point de vue écologique).
Ce qui provoque, et c’est le deuxième problème, une aseptisation de nos existences et de nos expériences urbaines qui sont de plus en plus mal vécues. Sentiments d’accélération sans fin et de stimulations incessantes, sensations d’asphyxie et de saturation, au point d’un rejet anthropologique croissant de certains styles de vie urbains.
Enfin, pour qu’on tienne tous ensemble au même endroit avec les effets écologiques et anthropologiques mentionnés, on doit finalement être dépossédé de notre capacité directe d’action. On délègue notre puissance à des forces politiques et institutionnelles. Ce qui nous fait perdre notre capacité à façonner notre habiter. Au-delà d’un environnementalisme gestionnaire ou d’une écologie punitive, les villes nous font perdre notre autonomie écologique. Par leurs peuplement et densité, les métropoles gouvernent de plus en plus nos corps et augmentent leurs biopouvoirs, nous dépossédant de notre propre puissance. Les démocraties urbaines n’ont donc rien de réellement démocratiques. La métropolisation du monde est un problème fondamentalement politique.
GEM – Vous ne trouvez donc aucune grâce aux villes ?
GF – Je ne suis pas contre les villes, je suis contre la fascination pour la démesure, l’excès de grandeur ainsi que le mythe d’opulence et d’abondance qui se joue derrière et qui est en train de détruire la planète. C’est donc une question de taille. Il faut urgemment un débat sur la taille limite d’une ville.
Cette taille limite dépend évidemment des milieux, des écosystèmes, des ressources disponibles. Mais, dans nos contrés, on arrive à un chiffre maximum situé autour de 30 000 habitants. En deçà de ce chiffre, on maintient une diversité des habiters écologiques (petites villes, hameaux, bourgs, villages, villes moyennes), avec décence et humilité, à la fois dans les interdépendances humaines et dans les liens organiques avec le Vivant.
On peut également envisager un plancher aux alentours de 2 000/3 000 habitants si l’on veut commencer à réunir les savoir-faire requis et à nourrir les échanges nécessaires pour faire autonomie. On a ici une fourchette qui me semble comme relevant du souhaitable au regard des défis qui s’annoncent, et quoiqu’il en soit souhaitée par la grande majorité des populations occidentales. D’où certainement le fait que la majorité des Villes en transition s’inscrivent dedans.
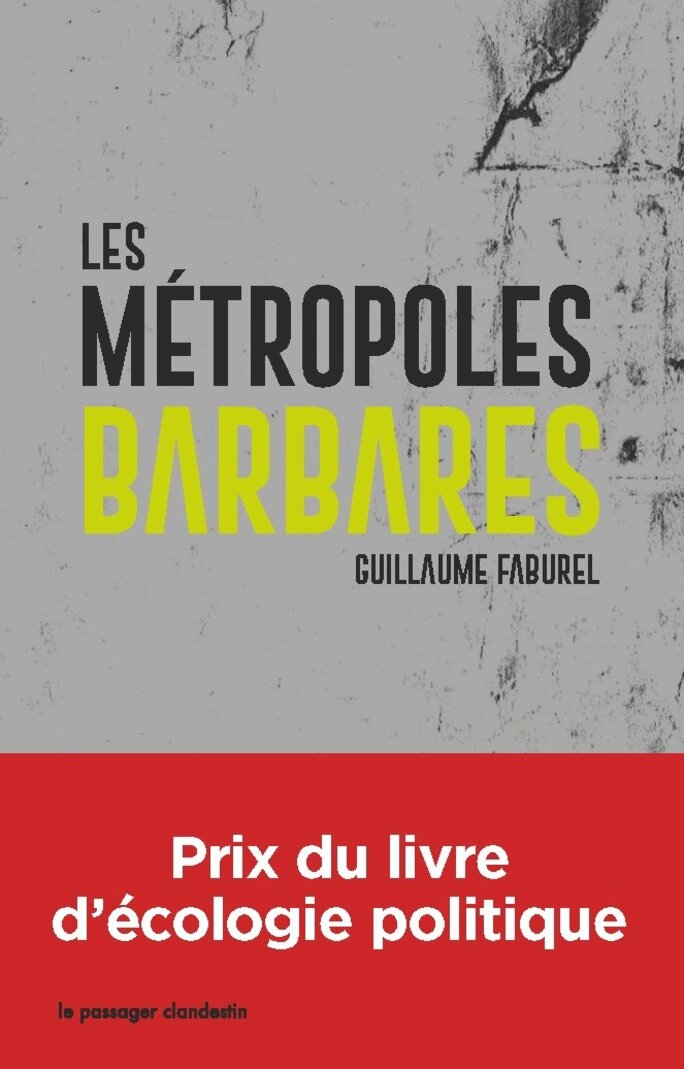
Agrandissement : Illustration 2
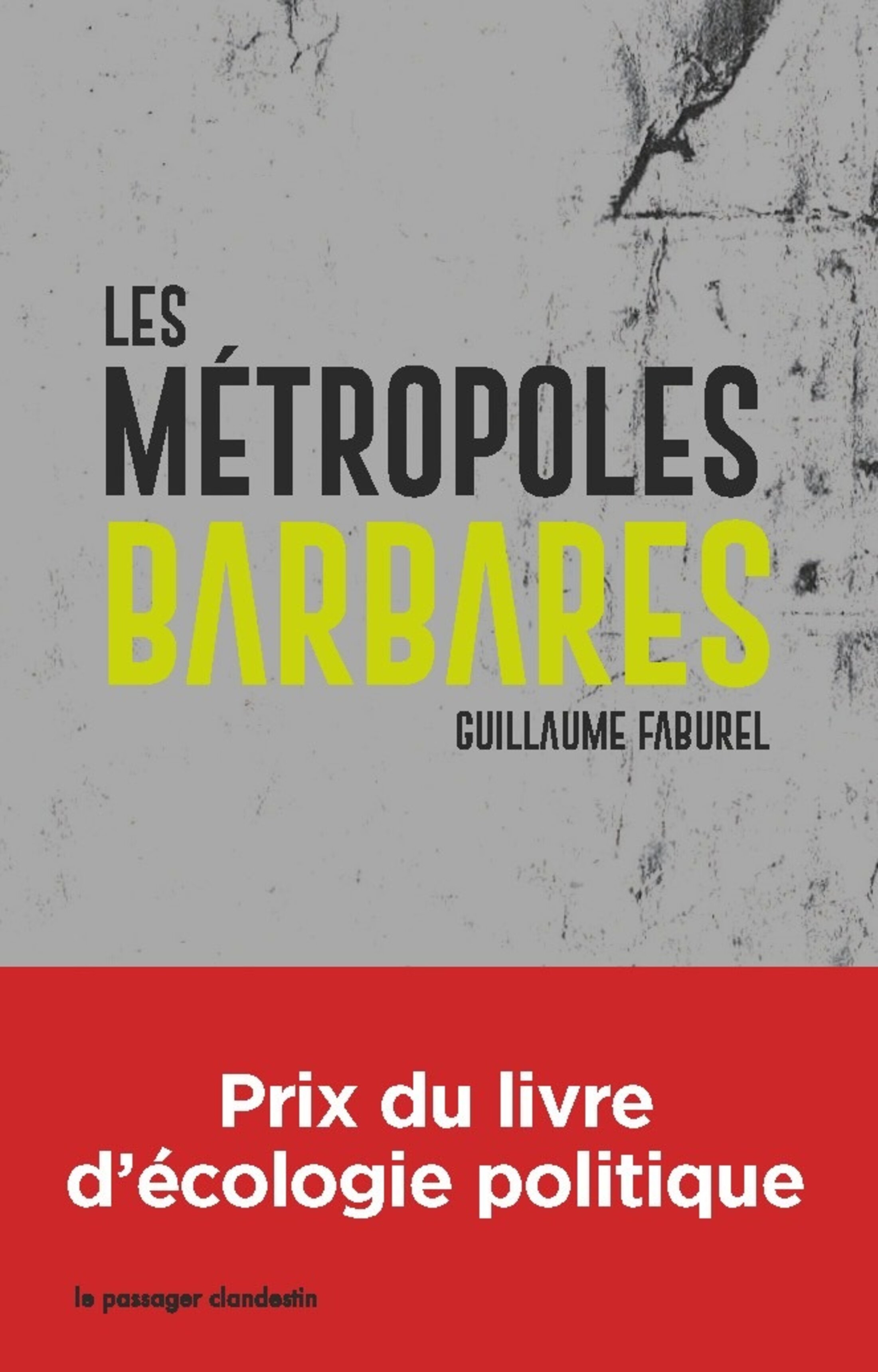
GEM – Quelles solutions envisageriez-vous pour un finir avec les grandes villes ?
GF – À la fin du livre je renvoie à sept orientations qui pourraient faire référence aux sept péchés capitaux du capitalisme mondialisé. Nous n’allons pas toutes les parcourir ici mais je voudrais insister sur quelques-unes.
La première est la nécessité de penser à un rééquilibrage général et populationnel à l’échelle nationale. C’est non seulement tout à fait possible mais surtout à moindre pression écologique. Bien entendu, s’il est question de quitter les villes avec SUV, 5G, piscine chauffée et climatisation, on ne fera que généraliser le problème. Conjointement à ce déplacement, il doit donc y avoir conscientisation des enjeux écologiques consistant à aller dans des espaces plus ouverts au sein d’une nature redécouverte, en abaissant son niveau de besoin et en adoptant des modes de vie plus vertueux.
Aujourd’hui, sans être des Amish, il y aurait par exemple moyen de faire autonomie alimentaire avec entre 700 et 1000 m2/personne, moyennant une agriculture paysanne, éventuellement un petit élevage d’appoint et familial. On monte à 2000 m2 si l’on adjoint espaces de stockage, d’habitations ainsi que quelques services publics de proximité. En multipliant ce chiffre par le nombre d’habitants en France, on arrive à maximum un quart de la superficie nationale, ce qui est bien inférieur au taux d’artificialisation des sols actuel, une fois intégrés tous les espaces de l’agriculture industrielle, de l’extractivisme généralisé et toutes les grandes infrastructures nécessaires aux flux toujours plus lointains. Il y a donc ici un espace du possible.
Un deuxième élément est de mettre enfin en question le genre urbain, et plus encore aujourd’hui métropolitain. C’est avant tout un combat culturel. Ce combat ne pourra être gagné que si l’on réempaysanne nos propres cultures. C’est-à-dire qu’on rende les bras que la ville a spoliés aux campagnes pour les déléguer à des puissances industrielles, mécaniques et chimiques. Dans ce combat, nos éducations jouent un rôle fondamental. Cela passe par revaloriser tous les savoirs artisanaux, agro-pastoraux, permacoles et par la réhabilitation des travaux manuels par rapport à l’intellectualisation narcissique à l’œuvre, ce qui conjointement au rééquilibrage évoqué, va contribuer à forger une véritable autonomie.
Le rééquilibrage devra également s’accompagner d’une réquisition de logements et des commerces vacants (dont 60% sont actuellement dans les zones périphériques), ce qui contribuera à résoudre la crise du logement de façon plus efficace que notre tendance à toujours plus construire et entasser des gens dans des espaces de plus en plus bétonnés.
Troisièmement, nous avons lancé des États Généraux de la société écologique post-urbaine, dans le but principal de tisser des liens entre une trentaine d’organisations sur cette question. L’objectif est de faire évoluer nos imaginaires et d’être créatifs sur les bases d’une telle société et les problèmes que l’on pourrait rencontrer. Nous voulons en faire à la fois une critique radicale et une perspective très pratique : viser le rééquilibrage déjà évoqué.
GEM – Est-ce qu’il n’y a pas, dans votre discours, une idéalisation des campagnes ?
GF – Cette idéalisation, qui existe, retourne l’œuvre historique d’éloignement et de disqualification de ces espaces. On a disqualifié les campagnes au profit de l’urbanité, mais c’est en partant des lunettes fabriquées de l’urbain que l’on fantasme les campagnes. En réalité, les campagnes sont à la fois pour nombre des espaces déjà colonisés par la marchandise métropolitaine et, pour d’autres, des milieux qui peuvent être austères, rugueux, compliqués.
En fait, il faut commencer par changer de telles lunettes qui nous font penser les campagnes comme quelque chose d’idyllique parce que très largement inconnu (mythe pastoral, romantisme du XIXe siècle), ou alors historiquement propagé par les classes bourgeoises. Dépassons le clivage romantisation-disqualification parce que les campagnes sont en fait la dernière possibilité de refaire corps avec le Vivant en établissant des habiters à taille humaine et en luttant contre la bétonisation et l’artificialisation des sols.
GEM – L’actualité (notamment suite au confinement) semble confirmer vos propos. Certains n’hésitent pas à parler d’exode urbain (même si c’est sans doute exagéré). N’assisterions-nous pas à une sorte de gentrification des campagnes depuis plusieurs années ? Ce phénomène ne risque-il pas de s’aggraver si l’on suit vos propos ?
GF – Cela revient à la discussion précédente. Qu’est-ce qu’on embarque en soi ? Qu’est-ce qu’on apprend à désapprendre pour réapprendre ? Et là, il y a toutes les médiations fétichisées du Capital qui se jouent derrière. Les régimes de propriété, le rapport aux institutions, les formes d’éducation, etc. Donc il faut engager un cheminement d’ordre politique, c’est-à-dire une réflexion vive sur le fait qu’autonomie ne veut pas dire indépendance et encore moins autarcie. Qu’il va falloir refaire communauté et donc instaurer des règles de vie. Dans le cas contraire, on va reproduire autre part ce que l’on cherche à quitter.
La solution est donc d’initier maintenant urgemment ce débat-là afin que chacun se sente acteur. Et il se trouve que dans les campagnes, avec leurs nouvelles ruralités, c’est là qu’on peut le plus rapidement se sentir écologiquement agissant. Soyons donc acteurs jusqu’à se poser la question de ces relations fétichisées (droit de propriété, accès au foncier, surenchère des loyers…). Il s’agit là d’un rapport mutant au politique.
On considère souvent les éco-lieux comme réunissant des classes bourgeoises cherchant à bâtir des petites communautés déconnectées (et il y en a). Mais il y a aussi de plus en plus au sein de ces initiatives le questionnement des médiations évoquées. Des gens qui disent que pour bâtir des communs, il faut de fait partager la propriété, envisager des éducations alternatives antiautoritaires. Il y a également des coopératives intégrales qui reconsidèrent l’ordre salarial et notre rapport au travail. Ceci n’est rien de moins qu’un véritable projet d’autonomie politique. Tout ceci sans même parler des reprises de fermes, des communautés intentionnelles ou encore des reprises dites illégales de locaux vacants.
Reprendre en main sa vie, c’est aussi reprendre des règles que l’on a déléguées trop longtemps et dont on souhaiterait se ressaisir pour mettre en place d’autres formes de vie, fondées sur d’autres régimes d’entraide et de solidarité. En résumé, habiter, coopérer et autogérer sont les trois communs à se réapproprier. Et ceci passe à mon sens par sortir des grands espaces urbains dans lesquels on a délégué la puissance aux institutions.
GEM – Qu’en est-il du choc culturel entre ce qu’on nomme souvent les néo-ruraux et les habitants que l’on considérerait comme autochtones. N’y a-t-il pas un risque de voir ces derniers se sentir dépossédés de leur mode de vie ?
GF – Je pense que le problème existe mais il ne faut pas le surestimer. Au regard des remontées de terrain et des enquêtes menées, on remarque qu’environ dans les deux tiers des cas, la cohabitation réussit. On assiste dans le tiers restant en effet à un choc des cultures. Et un rapport de forces souvent autour des droits de propriété foncière. Pour schématiser, les nouveaux arrivants sont pleins de bonne volonté et sont très actifs au sein de modèles alternatifs lorsque les anciens disent : « notre mode de vie est à peu près uniquement ce qu’il nous reste, ne venez pas trop empiéter ou alors, adaptez-vous ».
On pourrait donc mettre en miroir une pensée réactionnaire et identitaire attachée à la propriété de la terre, à la ruralité, et un progressisme métropolitain caractéristique de néo-ruraux fraîchement convertis à l’écologie. Mais si l’assise culturelle est fondamentalement différente, un point les réunit : les deux ne veulent plus entendre parler des métropoles. De là, je crois qu’il y a les conditions pour l’émergence d’un front politique. Je fais le pari que si la rencontre se passe dans le respect et l’humilité, la fréquence des contacts peut rapprocher des manières de pensées qui pourraient se transformer en force. Les questions agricoles amènent d’ailleurs de plus en plus de convergences.
Quand vous avez des jeunes écolos désobéissants qui vont s’opposer à une ferme usine, c’est l’agriculture industrielle qui se joue derrière. Or, cette agriculture industrielle est responsable d’un appauvrissement des terres devenu problématique dans certaines régions. Cela permettrait d’envisager un front commun sur la base du grand enjeu qui n’est rien d’autre que celui du Vivant. Et ça marche à de nombreux endroits. Lorsqu’à d’autres on voit de nouveaux arrivants s’impliquer localement, à l’occasion des élections notamment.
GEM – On voit que l’arrivée de citadins dans des zones rurales provoque souvent un renchérissement des prix de l’immobilier. Ne faudrait-il pas un contrôle des loyers pour parvenir à la situation que tu défends ?
GF – Si, mais il faut territorialiser cette mesure. Ces contrôles doivent d’abord s’imposer dans des lieux qui sont en passe d’être en tension immobilière dans les prochaines années. En France, cela concerne surtout les villes moyennes et petites. Si des métropoles comme Lyon ou Paris évoquent ce plafonnement, cela va se traduire par quoi ? Toujours plus concentrer, pour toujours plus habiter. Il faut donc plafonner d’abord les zones de tensions annoncées.
J’ajouterais que ce plafonnement des loyers doit être accompagné d’autres mesures, et en particulier la réquisition les logements vacants que j’évoquais précédemment. Roubaix propose des logements à 1€. Dans de toutes petites villes de la Marne, il y a des foires locales au logement à la fois pour faire connaître le patrimoine immobilier et pour mettre en liens quelques intérêts. On a là de nombreuses initiatives. Ça n’est pas qu’un plafonnement des loyers mais une offre digne de logements pour les plus désireux et nécessiteux et à des endroits où ils pourraient bâtir une forme écologique de vie, propre aux classes populaires. Classes populaires qui, non pas seulement pour des raisons économiques mais aussi culturelles, ont souvent un rapport à l’écologie qu’il nous faut toutes et tous adopter (recyclage et bricolage, solidarités alimentaires et petite balade de plein air).
GEM – Avec la montée en puissance des métropoles, celles-ci sont souvent considérées comme l’endroit d’où émergera un avenir plus écologique, notamment via les politiques municipales. Que peux-tu répondre à ça ?
D’abord qu’on n’en attendait pas moins d’elles, du moins dans les discours. C’est leur vivabilité et donc leur attractivité qui sont posées. Elles doivent rendre désirable ce qui a commencé à ne plus être désiré. Et elles cherchent des solutions aux problèmes qu’elles ont elles-mêmes en partie posés. Mais, quand le remède est lui-même le poison, c’est un Pharmakon.
Dans ce registre des discours justement, le périurbain serait le problème premier et densifier les centres serait la martingale. Sauf que ce sont deux faces d’un même visage, celui des dynamiques de concentration des populations dans les grandes aires urbaines, et que, par exemple, les bilans carbone sont assez voisins entre centres et périphéries urbanisées. Les cœurs métropolitains perdent des points principalement en raison des pertes énergétiques liées à la vétusté des bâtiments (entre 30 et 40% de pertes énergétiques), ou encore du fait des mobilités extra-quotidiennes, et, de l’autre côté, s’enfermer dans des boucles de mobilité au sein d’un périurbain n’est pas non plus ce qu’il y a de plus vertueux écologiquement.
En fait, arrêtons de considérer que la solution serait dans le regroupement et la densité. De quelle écologie parlons-nous ? Celle d’accroitre les chaines dont nous nous sommes rendus dépendants pour tenir et vivre ensemble par toutes les techniques qui gouvernent nos vies, de la mécanique au numérique. La réalité est que, franchi une certaine taille de population, on ne peut tout simplement plus faire autonomie sans aller coloniser l’entièreté des espaces périphériques. C’est bien là où nous en sommes aujourd’hui. Le débat autour des cantines bio au sein de certaines grandes villes par exemple. On le fait venir d’où ? Si on veut de l’autonomie alimentaire, il faut à l’échelle d’une ville remettre en pleine terre 50 % du foncier pour la production alimentaire vivrière et restituer en plus aux écosystèmes au moins 15 % des terres urbanisées pour juste permettre de stopper le déclin de la biodiversité. Voilà la condition d’inversion rapide du forçage urbain généralisé de tous les écosystèmes.
Les villes ne peuvent donc pas être la solution puisqu’elles sont le problème, du moins si l’on admet que seule une écologie par l’autonomie pourrait dignement abaisser le niveau de pression exercé par nos vies hyper-urbaines. On parle d’agriculture urbaine mais, pour une ville comme Paris, ça ne peut représenter, dans le meilleur des cas, que 7% de la consommation alimentaire. On parle d’ilots de fraicheur qui ne peuvent concerner par la renaturation que quelques micro-espaces. Tout ça n’est que de la gesticulation. Et comment pourrait-il en être autrement ? Les équipes métropolitaines ne vont pas se suicider en disant que ce qu’elles font ne sert que peu et que l’élection qu’elles ont gagnée devrait plutôt viser à freiner l’attractivité économique des métropoles. Pourtant, c’est bien vers une décroissance qu’il nous faut maintenant tendre. Démanteler ces mégastructures pour restaurer une juste mesure.
L’écologie métropolitaine n’est qu’un environnementalisme gestionnaire qui doit être remplacé par une écologie populaire de l’autonomie relocalisée. Dans ce registre, je parie beaucoup plus sur les forces citoyennes et les initiatives hors des grandes métropoles pour retrouver décence et humilité, et peut-être tourner la page du genre métropolitain. C’est urgent.
---
Guillaume Faburel, Pour en finir avec les grandes villes. Manifeste pour une écologie post-urbaine, Le Passager clandestin, 2020.
- Les Métropoles barbares, Le Passager clandestin, 2019.
---
Sur le blog :
« Les campagnes, décors pour citadins ? » (Renaud Duterme)
---
Sur la bonne échelle des villes, Thierry Paquot a publié "Mesure et démesure des villes"
Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/geographiesenmouvement



