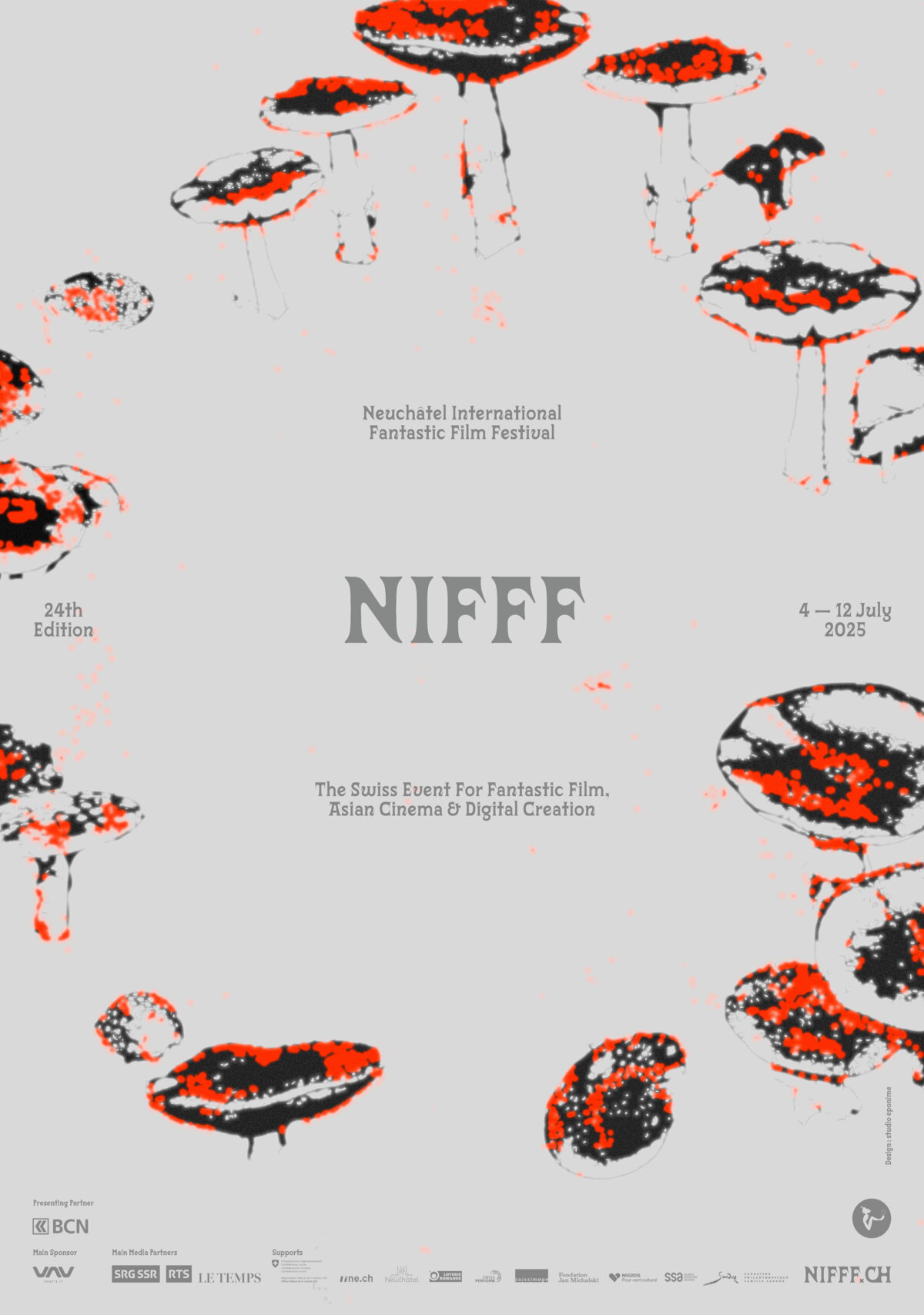
Agrandissement : Illustration 1
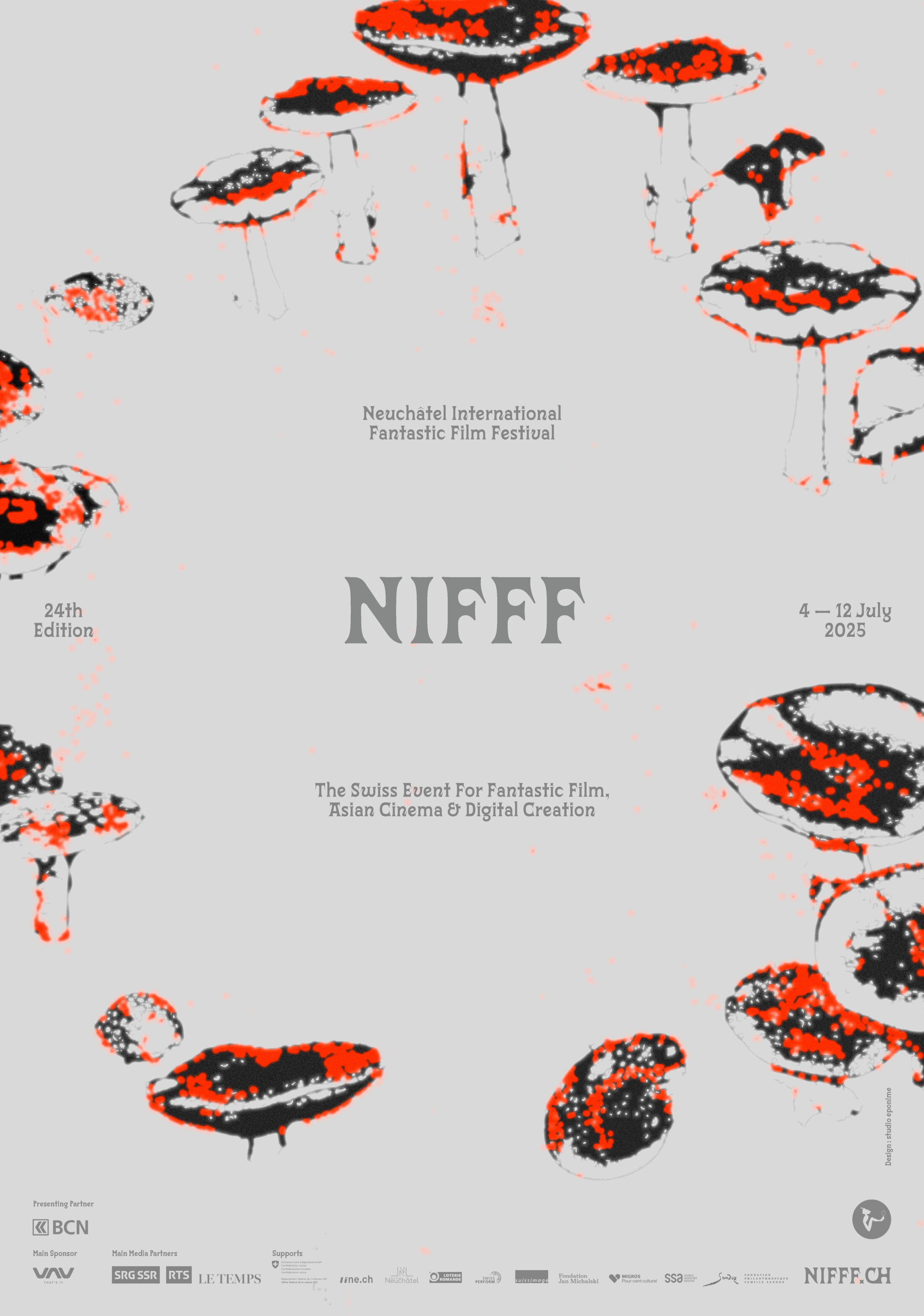
Alors que se prolonge une interminable fête dans la ferme du Polonais Henryk, fier de marier son fils aîné Tomek à une Française, quatre convives s’éclipsent: l’adolescente Nawojka et la mystérieuse Sandra se sont laissé embarquer par le boucher du village et le vétérinaire du coin dans une partie de chasse à la biche nocturne. Que ma volonté soit faite, de Julia Kowalski (compétition internationale), s’apprête à basculer avec cette scène qui ne peut que mal se finir. Fusil à lunette, rangée de phares au-dessus de l’habitacle du pick-up, alcoolémie déraisonnablement élevée, les amateurs de films de genre ne manqueront pas de penser à l’insoutenable séquence de chasse au kangourou du non moins insoutenable Réveil dans la terreur, réalisé par Ted Kotcheff en 1971. Dans le désert australien, la boucherie nocturne marquait une étape-clé de la plongée dans l’horreur d’un instituteur, coincé pour l’été dans une petite ville du désert australien gangrenée par la masculinité toxique.

Agrandissement : Illustration 2

Pas de désert ni de kangourous dans le film de Kowalski, mais les franges rurales de l’espace français, avec des maisons abandonnées, de la boue et la peur diffuse des maladies – ou des sorts – qui déciment le bétail. À la ferme, tout en rêvant de devenir vétérinaire, Nawojka aide son père et ses deux frères aînés et, surtout, remplace à la cuisine sa mère disparue dans des conditions troubles – brûlée pour satanisme, laisse supposer l’ouverture du film. En se raccordant à la figure aujourd’hui récurrente de la sorcière, Kowalski mobilise le fantastique pour raconter la soumission des femmes et, surtout, la répression de leur sexualité, perçue comme une déviance et/ou une menace en dehors du cadre marital. Sous la pression de son père, Nawojka vit son désir naissant comme une monstruosité, mais c’est aussi la source des pouvoirs qu’elle semble avoir hérités de sa mère.
La campagne vendéenne, ce Far West
Distance matérielle et symbolique aux centres urbains, poids écrasant de la communauté villageoise et de son travail assidu de contrôle social, à quoi s’ajoute la superstition importée de Pologne par Henryk: tout dit la marge où peut s’épanouir le fantastique, aux limites de nos certitudes. En retour, le fantastique raconte les refoulés collectifs, les pesanteurs sociales et culturelles et les obstacles à l’émancipation dans des espaces dont le relatif isolement préserve les zones d’ombres. Avec son passé incertain et ses règlements de compte à l’abri de la loi, la ferme de Que ma volonté soit faite n’est pas loin d’évoquer le Far West et son rapport balbutiant à l’état de droit, mis en scène par des générations de westerns.
Le western, c’est la référence la plus évidente d’Eddington, d’Ari Aster, programmé dans la section «Third Kind» et déjà en compétition à Cannes au printemps. Les déserts de l’Ouest – ici du Nouveau Mexique –, sont le lieu mythique de la construction glorieuse de l’Amérique, avec la petite ville pionnière comme métaphore et métonymie d’une nation en devenir, théâtre de la lutte hobbesienne du droit contre le chaos – celui de la nature sauvage, la Wilderness, mais aussi celui des fines gâchettes faisant régner la loi du plus fort loin des métropoles de l’Est avec leurs usines et leurs tribunaux. Lieu de leur difficile gestation, nous dit Aster dans son quatrième long-métrage, les déserts sont aujourd’hui celui de l’implosion de la nation états-unienne.

Agrandissement : Illustration 3

Eddington, c’est la «small town» (fictionnelle) typique des marges: quelques rues orthogonales au milieu du semi-désert, un pub, un supermarché et un commissariat, de l’habitat dispersé plus ou moins cossu autour, la frontière mexicaine à quelques kilomètres et – mauvaise conscience matérialisée dans le territoire – une réserve indienne en guise de voisinage immédiat. La ville ronronnait sous la protection bienveillante de Joe Cross, son shérif un-peu-facho-mais-pas-méchant, jusqu’à ce que l’année 2020 marque la soudaine intrusion de l’ailleurs: le Covid pousse le maire démocrate Ted Garcia, en pleine campagne pour sa réélection, à prendre des mesures strictes sur le port du masque et la distanciation sociale, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle projette la construction d’un centre de données gourmand en eau et en énergie et, pour ne rien arranger, le meurtre de George Floyd provoque l’indignation de le jeunesse locale. Sans compter les écrans par lesquels arrivent des bribes d’informations plus ou moins déformées, mais aussi divers délires complotistes sur les origines du virus ou sur les pédophiles tirant les ficelles de la politique mondiale – délires auxquels Louise, la femme de Joe, prête une oreille un peu trop attentive. De patelin tranquille, Eddington se change en microcosme chargé des enjeux politiques du pays, les positions se durcissent, la campagne de réélection tourne au pugilat après que Joe Cross décide sur un coup de tête de se présenter contre le maire sortant. Et le tout tourne à la farce sordide.
À la fin, c’est la marchandise qui gagne
Aster porte une idée forte: peu importe le degré de violence et d’horreur – et le réalisateur de Midsommar ne nous épargne pas –, la marchandise finit toujours par gagner. Les différents acteurs sociaux sont agis par un système politico-économique qu’ils dérangent tout au plus en surface. Ici, le centre de données, enjeu délaissé durant l’essentiel du film, ressurgit pour questionner des luttes éparses – avoir honte de son privilège blanc, considérer le port du masque comme une entrave aux libertés fondamentales – sur leur capacité à contester la société marchande dans ses mécanismes profonds. Mais le cinéaste se décrédibilise en renvoyant tout le monde dos à dos et en réduisant l’engagement politique à de médiocres ambitions personnelles ou à des traumatismes mal digérés – voire en faisant débarquer, aux deux tiers du film, un mystérieux groupe de (faux ?) militants d’extrême-gauche armés jusqu’aux dents et entraînés comme un commando de Marines.
Faute d’opposer quelque chose à ce qu’il décrit sans vraiment le dénoncer, Eddington est fermé sur lui-même. Se posant comme le grand film politique de l’ère trumpienne, mais sans colonne vertébrale idéologique, il se retrouve quelque part entre la misanthropie complaisante de Ruben Östlund dans Sans filtre et la fascination vide pour la violence d’Alex Garland dans Civil War, sans parvenir à décider ce qu’il cherche à dire. On finit par se demander si Aster nous parle de l’incapacité de l’Amérique à se penser une histoire en dehors des filets de la raison marchande, ou s’il ne fait pas plutôt l’étalage de sa propre inconsistance. La marge désertique devient un cul-de-sac politique, sans la moindre ouverture, sans rien ni personne à opposer à la fuite en avant du techno-capitalisme.
Kiyoshi Kurosawa non plus ne sait qu’opposer à l’invasion de nos vies par la logique marchande. Mais il se distingue par sa modestie et sa clarté. En 2001, le réalisateur japonais évoquait déjà, dans Kaïro, l’infinie solitude où menaçaient de nous plonger les écrans avec l’avènement d’internet. 25 ans plus tard, les écrans de Cloud (section «Third Kind») servent à vendre, vendre et encore vendre, vendre d’importe quoi pourvu qu’on en tire le moindre bénéfice. La vente en ligne, c’est pour le jeune Riôsuke la promesse d’une vie meilleure, loin de l’usine textile où il répète quotidiennement les mêmes gestes à l’infini. Les affaires marchent, l’apprenti revendeur finit par démissionner, s’installe dans une maison de la lointaine banlieue de Tokyo et croit pouvoir savourer sereinement sa réussite.

Agrandissement : Illustration 4

Revendre de la contrefaçon, réaliser des marges délirantes sur le dos de fournisseurs aux abois, ne rien voir d’autre qu’un réel peuplé d’investissements, de marges et de bénéfices… Riôsuke se moule dans un monde saturé par la concurrence, la compétition de tous contre tous. Il incarne la doxa libérale dans sa version la plus radicale, que le philosophe Dany-Robert Dufour avait résumé il y a quelques années en une maxime: «Baise ton prochain». Et à force, le jeune entrepreneur tokyoïte, cousin extrême-oriental de l’ambitieuse Angie de It’s a Free World…, de Ken Loach, finit par se faire des ennemis mortels. Obsédé par ses chiffres de vente, oublieux de la réalité matérielle hors du hangar où il stocke ses marchandises en transit, Riôsuke va subir un retour brutal du refoulé sous la forme d’une coalition de clients et fournisseurs (très) en colère: même dans le cyberespace, l’économie a des conséquences bien réelles sur la vie des gens.
Perdus dans le cyberespace
La deuxième partie de Cloud bascule dans le film de traque et dans un déchaînement de violence en proportion inverse de la fausse indolence de son protagoniste. Puis le film finit par flirter avec le fantastique à travers un personnage d’assistant mystérieux, sorte d’ange-gardien démoniaque. Mais la véritable horreur se niche dans l’angoissante banalité de la première moitié de l’intrigue et dans l’impitoyable froideur des plans de Kurosawa: loin de devenir acteur de sa vie en fuyant l’usine, Ryôsuke se fait l’esclave volontaire – et enthousiaste – d’un système qui, s’il lui donne d’indiscutables gratifications matérielles, n’est pas moins aliénant que le travail à la chaîne. Désespérément seul, rivé à son écran, occupé presque en continu à guetter les bonnes affaires et à attendre que clignote la mention «Sold» sur les icones des produits qu’il a mis en vente, son monde se réduit à des marchandises n’ayant aucune autre raison d’être que la nécessité absolue de se vendre. Une manière pour Kurosawa de dire que le fétichisme n’est pas un vain mot.
De Tokyo à Baltimore, les déroutants Exit 8 (compétition asiatique) et Obex (compétition internationale) nous invitent à réfléchir à notre aliénation par les écrans depuis une tout autre perspective. Le premier est l’adaptation sur grand écran d’un jeu vidéo d’exploration en vue subjective sorti en 2023. Le joueur, perdu dans le métro, cherche à atteindre la sortie 8. Il doit pour cela parcourir en boucle le même tronçon de couloir à la recherche de possibles anomalies dans le décor – une poignée de porte au mauvais endroit, du sang coulant d’une bouche d’aération, etc. Si l’on détecte une anomalie, il faut opérer un demi-tour, sinon il faut continuer tout droit, chaque boucle correcte permettant de progresser d’un niveau, jusqu’au huitième.

Agrandissement : Illustration 5

Le deuxième long-métrage de Genki Kawamura aurait pu se contenter de reprendre à la lettre l’argument du jeu vidéo. La tension monte et on se prend au jeu à mesure que le personnage principal prend conscience d’être coincé dans ce qui a tout d’un cauchemar éveillé et que s’accumulent les obstacles, mais aussi les rencontres inattendues. Mais le réalisateur japonais et de ses deux coscénaristes ont eu l’intelligence d’ajouter un contexte à ce dispositif: les méandres du métro deviennent ceux de l’esprit d’un personnage confronté à une décision décisive, devenir père ou non. L’expérience du jeu devient alors paradoxalement une injonction à se replonger dans le réel et à prendre ses responsabilités.
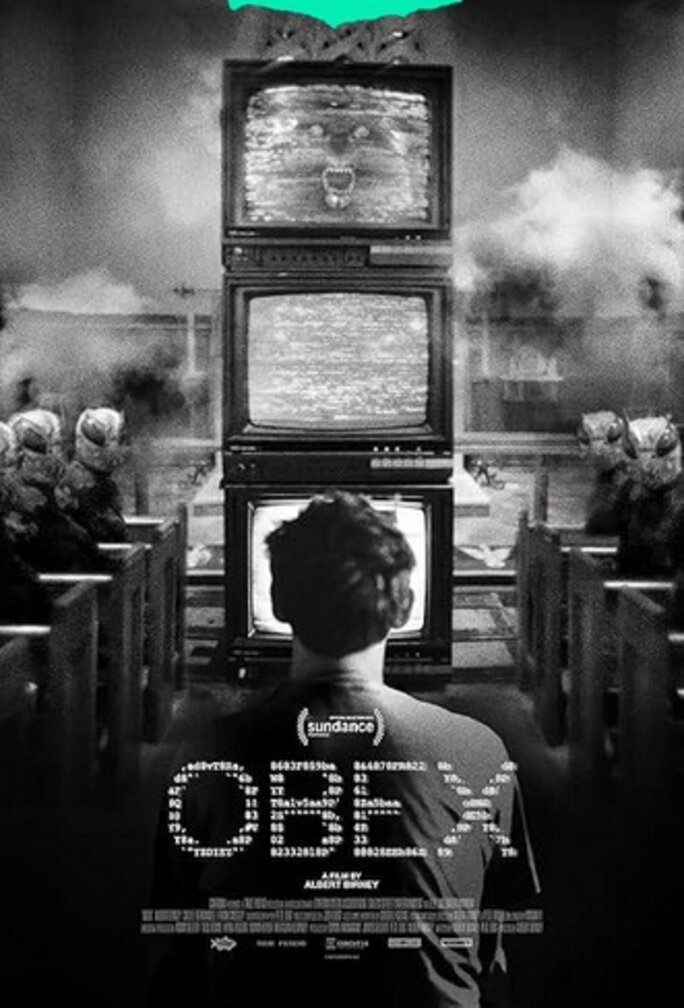
L’argument d’Obex, d’Albert Birney, est proche. Le réalisateur-coscénariste-acteur y campe Conor, personnage solitaire, reclus chez lui avec sa chienne Sandy et ses innombrables écrans, dont plusieurs télévisions pour regarder des films d’horreur et un Mac sur lequel il travaille toute la journée. Nous sommes à Baltimore en 1987 et un nouveau jeu vidéo censément immersif, Obex, vient de sortir. Après une première tentative de jouer décevante, Sandy disparait et Conor doit se plonger dans le jeu pour de bon pour la retrouver, brouillant les limites entre jeu vidéo, rêves, souvenirs familiaux aux airs de séance de psychanalyse et invasion très réelle de Baltimore par des cigales périodiques. Albert Birney nous emmène dans un monde rétro et poétique et rappelle lui aussi qu’on peut se perdre dans le cyberespace et qu’il vaut la peine de s’en extraire pour, par exemple, promener son chien sur la plage.
À la recherche d’une transcendance
Beaucoup de films présentés au NIFFF témoignent, consciemment ou non, d’un même symptôme: notre monde manque de transcendance – religieuse ou politique. Même les marges, souvent mises en scène dans le cinéma fantastique comme des interfaces vers un au-delà, sonnent désormais creux – si l’on exclut la poupée possédée de Dollhouse, du Japonais Shinobu Yaguchi (compétition asiatique), et les moines bouddhistes capables de s’abstraire des contraintes de l’espace-temps en soufflant dans une conque, dans le délirant Transcending Dimensions, du Japonais Toshiaki Toyoda (section «Ultra Movies»).

Agrandissement : Illustration 7

Reste le voyage halluciné proposé par Oliver Laxe, Sirât (section «Third Kind»), Prix du jury à Cannes. Un père et son jeune fils perdus dans une rave dans le désert marocain à la recherche de leur fille/sœur fugueuse, des teufeurs fuyant le monde dans la musique et la défonce, des formations rocheuses rappelant l’incommensurabilité des temps géologiques, de la techno expérimentale jaillissant d’un «mur» d’enceintes adossé aux falaises calcaires, le tout agrémenté de lointaines nouvelles d’une guerre mondiale imminente… dans Sirât, du nom d’un pont séparant le paradis et l’enfer dans la tradition islamique, le réalisateur franco-espagnol nous convie très au-delà des marges. Dans un monde où l’on ne manquera pas de remarquer l’absence totale d’écrans, une succession de traversées et de franchissements mène les personnages toujours plus loin dans un retour à l’organique à la fois voulu et subi, comme un rappel impitoyable de l’absurdité de la condition humaine. Un film-trip qu’il serait presque criminel de voir ailleurs que sur grand écran.
----------
À voir
Cloud, réalisé par Kiyoshi Kurosawa, en salles depuis le 4 juin.
Dollhouse, réalisé par Shinobu Yaguchi, pas de sortie prévue.
Eddington, réalisé par Ari Aster, en salles le 16 juillet.
Exit 8, réalisé par Genki Kawamura, en salles le 3 septembre.
Obex, réalisé par Albert Birney, en salles début 2026.
Que ma volonté soit faite, réalisé par Julia Kowalski, en salles le 19 novembre.
Sirât, réalisé par Oliver Laxe, en salles le 10 septembre.
Transcending Dimensions, réalisé par Toshiaki Toyoda, pas de sortie prévue.
----------
À lire
Dany-Robert Dufour, Baise ton prochain. Une histoire souterraine du capitalisme, Actes Sud, 2019.
----------
Sur le blog
«John Ford, une géographie épique» (Manouk Borzakian)
«‘28 ans plus tard’, l’apocalypse à la papa» (Manouk Borzakian)
----------
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/
Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social



