
Dans une New York rebaptisée New Rome, l’argent règne, des élites politico-économiques dépravées font l’étalage de leur médiocrité satisfaite, les images et le spectacle saturent les espaces publics et privés… Bref, le déclin guette, sans parler d’un satellite soviétique appelé «Carthage» (vous l’avez?) sur le point de s’écraser sur Terre.
Au milieu de ce chaos, l’architecte César Catilina, jeune, beau, riche et veuf, supervise l’urbanisation de la ville. Sa découverte d’un matériau révolutionnaire, le Megalon, lui a valu le prix Nobel et, last but not least, il possède le don de stopper le temps – tout s’arrête sauf lui, il en profite pour aller se promener sur les poutres suspendues des bâtiments en construction.
César est un chic type voulant le meilleur pour sa ville. Mais ses projets visionnaires affrontent des résistances: son amante star de télévision, Wow Platinum, ne pense qu’à se regarder elle-même à l’écran; son vieil oncle banquier et obsédé sexuel, un certain Crassus, sombre dans la sénilité; le maire Cicéron s’arc-boute sur une pratique court-termiste et clientéliste de la politique; cerise sur le gâteau, Clodio Pulcher, cousin jaloux de César, attise la colère du peuple contre les élites. Autant d’obstacles sur le chemin d’un urbaniste plein de bonne volonté, qui ne demande qu’à raser quelques quartiers populaires pour bâtir la ville du futur.
L’auteur, argument marketing
Autoportrait d’un créateur idéaliste confronté aux puissances de l’argent et au pragmatisme politique, peinture sans concessions d’un imaginaire collectif appauvri par le cirque médiatique et fossilisé dans des enjeux superficiels, mobilisation de l’espace urbain comme lieu et outil d’une transformation radicale de la société… Les premières minutes du film de Coppola passeraient presque pour un manifeste situationniste: comment sortir de l’urbanisme par l’urbanisme?
Et puis il y a l’aura entourant l’œuvre: projet maintes fois repoussé depuis 40 ans, dettes personnelles à hauteur de plus de 100 millions de dollars, cinéaste octogénaire, réalisateur de plus de 20 longs-métrages, double-palmé d’or à Cannes et n’ayant rien à prouver. C’est le désintéressement poussé à l’extrême, l’art pour l’art dans toute sa splendeur, la quintessence de la liberté esthétique.
Avec une telle machine narrative accompagnant le film et lui servant de principal argument marketing, tout travail critique est verrouillé d’avance, l’œuvre est inattaquable. Ne peut rester que le spectacle de la vieille opposition entre deux familles de critiques. Le vulgus, insensible à l’originalité, hermétique à l’innovation formelle, amateur d’histoires linéaires formatées pour Netflix, dénonce un film incompréhensible, prétentieux et intello. La cinéphilie autoproclamée, connaisseuse et subtile, savoure quant à elle l’audace et l’inventivité d’un auteur sanctifié, s’amuse des citations de Shakespeare et des références à l’histoire romaine, se pâme devant la liberté et la persévérance du réalisateur et célèbre son insatiable «envie de cinéma».

Agrandissement : Illustration 2
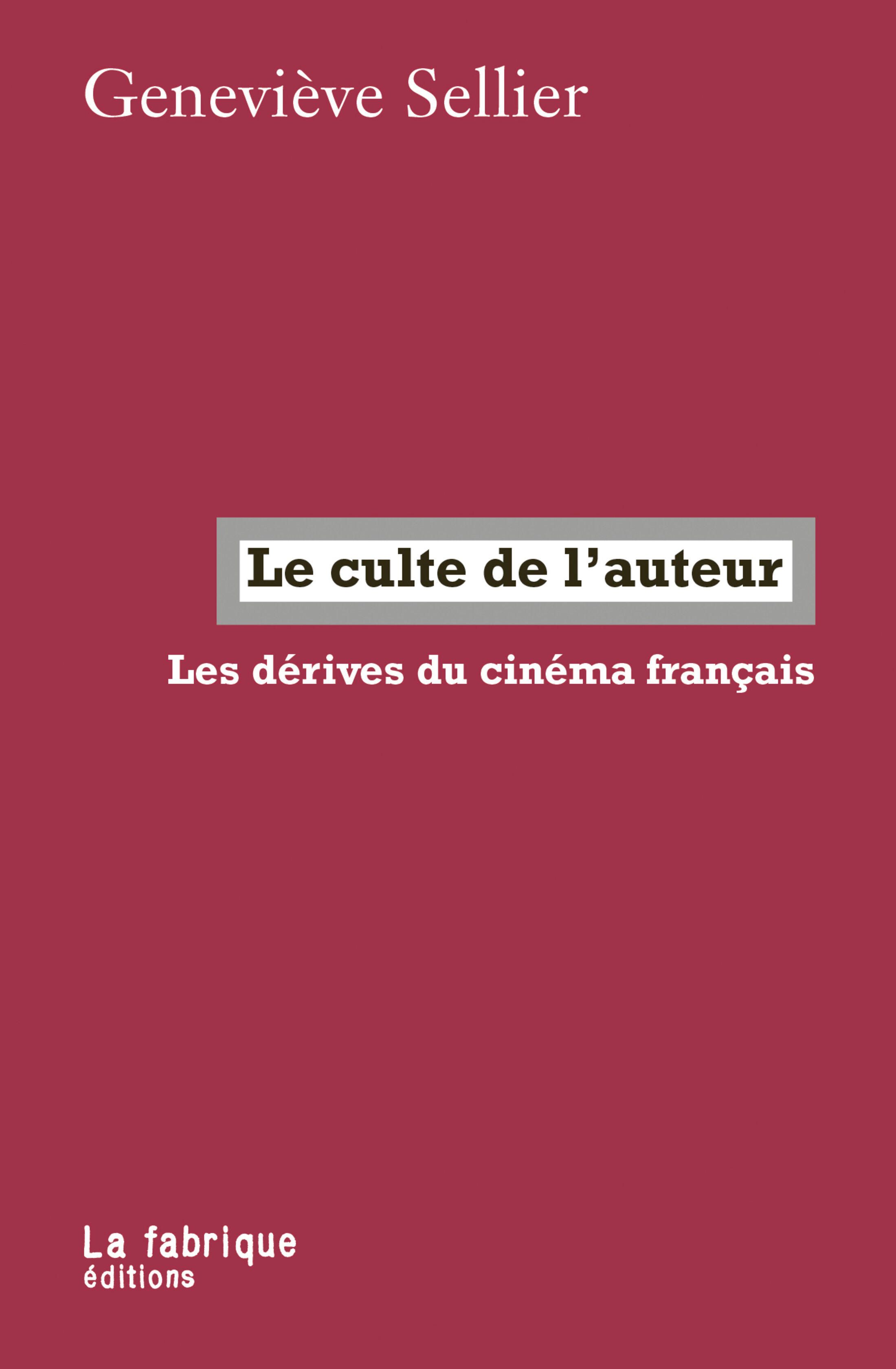
Ironie du calendrier, Megalopolis arrive dans les salles quand Geneviève Sellier publie Le culte de l’auteur. L’ouvrage opère une salutaire déconstruction de la figure de l’«auteur», mythe hérité de la Nouvelle Vague, muant le réalisateur de films en une figure isolée, d’autant plus incomprise que géniale – ou bien l’inverse – et travaillant avec abnégation à la création d’œuvres personnelles, porteuses d’un regard unique sur le monde contemporain. Une figure en complet décalage, rappelle Sellier, avec la réalité du terrain: un film, de l’écriture à la distribution en passant par le tournage et le montage, résulte d’un travail collectif, par la force des choses.
Les péripéties du tournage d’Apocalypse Now avaient déjà consacré Coppola en «auteur» ambitieux, visionnaire et d’une volonté à l’épreuve des pires vicissitudes. L’autoportrait du cinéaste en architecte-urbaniste vient enfoncer le clou, mais ne manque pas d’ironie involontaire. Car s’il existe une autre figure d’auteur (génial) en complète contradiction avec la réalité matérielle, c’est bien celle de l’architecte star. Des individus surmédiatisés laissent leur nom à des constructions tape-à-l’œil commandées par de riches industriels, alors que le moindre bâtiment nécessite la participation d’une armée d’ingénieurs, dessinateurs et autres spécialistes.
Sans oublier d’innombrables exécutants, dont on aimerait rappeler à Coppola que la construction d’un gratte-ciel, comme la réalisation d’un film, ne peut pas se passer. Les scènes où César déambule sur les poutres métalliques en suspension dans le ciel rappellent évidemment la célèbre photographie d’ouvriers du bâtiment pique-niquant sur les hauteurs de Manhattan. À ceci près que les ouvriers, justement, ont disparu du tableau. Beau lapsus de la part d’un «auteur» en plein refoulement de la réalité sociale dans laquelle s’ancre, qu’il le veuille ou non, son «œuvre». Et pour qui le peuple semble se résumer à une masse naïve et manipulable, qu’il faut convaincre avec des discours bien sentis, faute de pouvoir l’ignorer tout à fait.
Défilé de potiches
Geneviève Sellier ne manque pas de noter la fibre sociale déficiente des «auteurs». Mais elle documente surtout la pléthore de films reproduisant, avec la bénédiction de la critique «cultivée», les pires mécanismes de domination de genre. Des générations de cinéastes se suivent et se ressemblent, assujettissant les femmes au regard et au désir d’un créateur masculin, les réduisant à une altérité fascinante et/ou repoussante et leur déniant une véritable conscience – dans la lignée de la Nouvelle Vague, que la chercheuse avait déjà qualifiée de «cinéma au masculin singulier», et plus largement dans la tradition romantique du génie (forcément) masculin.
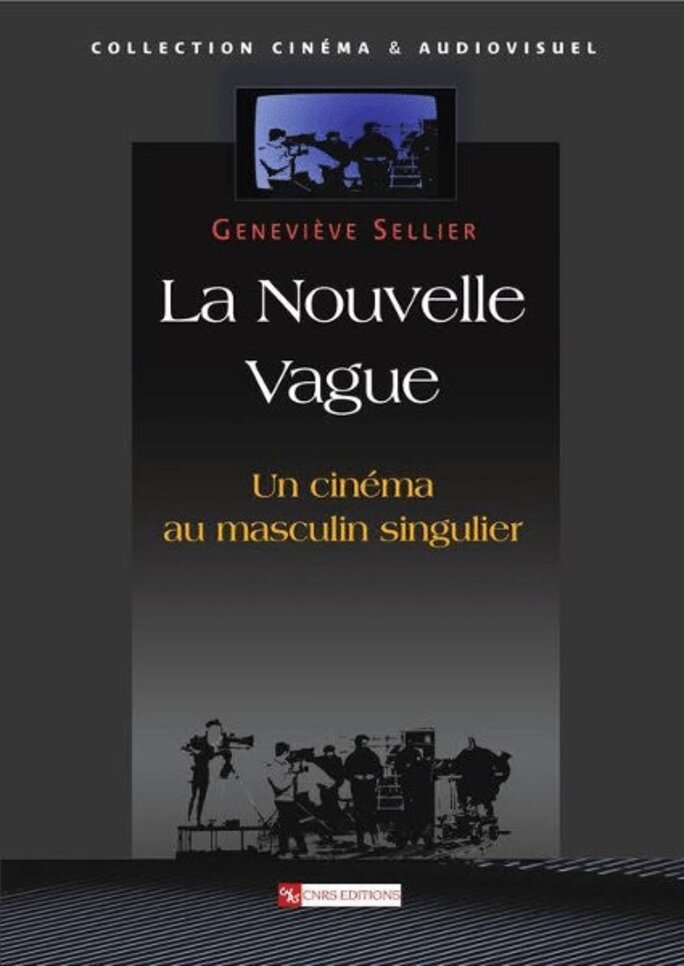
Agrandissement : Illustration 3

César, alter-égo de Coppola, est un homme évoluant dans un monde d’hommes, tout juste perturbé par quelques figures féminines stéréotypiques, à commencer par une mère toxique et envahissante, une amante superficielle, hypersexualisée et jalouse, et une femme suicidée désormais source intarissable de culpabilité. Un autre personnage féminin sert de pivot au scénario de Megalopolis: Julia, fille du maire Cicéron et, surtout, seul être connu échappant aux interruptions du temps de César, devient l’amante de l’architecte. Elle endosse alors les rôles de principale admiratrice, de soutien indéfectible quand survient une terrible crise d’inspiration – après une très vilaine cuite, César semble avoir perdu son pouvoir – et même de conseillère avisée à l’occasion.
Vous pensiez en avoir fini avec le schéma éculé du créateur-génial-mais-qui-ne-serait-rien-sans-une-femme-à-ses-côtés? Voici César et sa Julia. Objet de désir, amie, confidente, muse, mère de son enfant – l’annonce de sa grossesse appartient aux moments les plus gênants de l’histoire du cinéma –, elle n’a aucune raison d’être en dehors de son rôle d’appendice, de complément de l’artiste, de catalyseur de son accomplissement à lui. Pour celles et ceux qui n’ont pas bien saisi, le film se termine sur une dédicace de Coppola à sa femme.

Agrandissement : Illustration 4

À l’enfer d’un monde postmoderne privé de profondeur et de repères moraux, Coppola ne trouve rien à opposer, comme source de stabilité et de sens, à part le modèle de la famille nucléaire – quand Le Parrain, tout en faisant aussi de la famille une référence incontournable, proposait une réflexion autrement ambiguë sur le sujet.
Misère de l’imaginaire urbain
Durant une bonne partie du film, on peut continuer à rêver que tout cela soit le prix à payer pour un grand film utopiste, porteur d’une vision nouvelle de la ville et des pouvoirs de l’urbanisme. Et que, derrière son élitisme rance et son sexisme banal, se dessine une attaque en règle contre le «consensus spatial», un courageux coup de pied dans la fourmilière du modèle métropolitain accompagnant le capitalisme tardif.
Mais non. Le discours de Coppola sur la ville se résume à quelques phrases creuses sur la symbiose entre nature et technique, et réduit l’artiste-architecte à un inventeur génial, partisan du solutionnisme technique. Quant aux rares images de la ville du futur, elles se résument à un décor de petites bulles volantes et de tapis roulants/coulants multicolores, quelque part entre Star Wars, Avatar, Wall-E et une publicité pour des glaces ou du parfum. En somme, c’est l’autre lapsus du film, l’horizon indépassable de la famille nucléaire patriarcale accouche – et comment aurait-il pu en être autrement – d’un imaginaire creux, vaguement glamour. L’idéologie ferme la voie de l’utopie.
Les grands discours critiques chantant le courage et l’inventivité formelle du réalisateur, en ignorant de toutes leurs forces son propos, relèvent, in fine, de l’aveu: Megalopolis se réduit à un contenant clinquant, à un emballage chic masquant la nullité abyssale du contenu. Difficile d’être plus raccord avec l’époque.
----------
À lire
Geneviève Sellier, Le Culte de l’auteur. Les dérives du cinéma français, La Fabrique, 2024.
Geneviève Sellier, La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier, CNRS éditions, 2005.
----------
Sur le blog
«Paris envers et contre tout» (Manouk Borzakian)
«Fredric Jameson, penseur de notre impuissance politique» (Manouk Borzakian)
«Au cinéma avec Mark Fisher (1/2)» (Manouk Borzakian)
«Guillaume Faburel: "Il faut en finir avec le modèle métropolitain"» (Renaud Duterme)
----------
Pour nous suivre sur Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/



