
Cette période estivale avec des journées plus longues, nous donne l’occasion de nous interroger sur la possible disparition de la nuit. Formule certes provocatrice, l’alternance entre périodes de forte et de faible luminosité étant indissociable de notre planète, mais pertinente pour comprendre la menace pesant sur le concept de nuit, tant du point de vue environnemental que social, économique et même physiologique.
Aux origines, l’éclairage public
Si la disparition de la nuit devait être datée, ses débuts remonteraient probablement à l’époque industrielle, avec la mécanisation des processus industriels mais surtout suite à l’émergence de l’éclairage public. Initié au XVIIIe siècle à base d’huile de baleine, il équipera Londres dans les années 1820 avant de se généraliser dans les grandes villes tout au long du XIXe siècle[1]. C’est son électrification qui va le faire décoller, en le rendant plus stable, plus sûr et moins nauséabond que les anciennes techniques basées sur la combustion de gaz[2].
Cette révolution va permettre d’atteindre deux objectifs : réduire les anciennes inquiétudes liées au danger de l’obscurité nocturne (et donc un accroissement du contrôle social)[3] et élargir le temps de l’activité économique, augmentant la profitabilité de nombreuses activités[4].
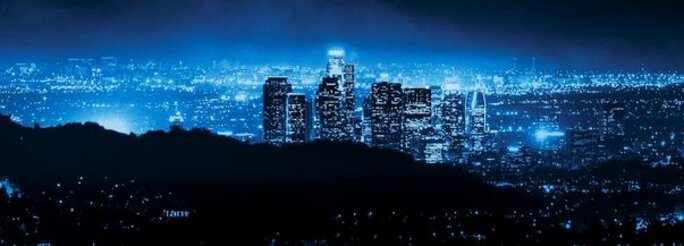
Agrandissement : Illustration 2

Depuis lors, l’éclairage public n’aura de cesse de s’étendre. D’abord sous l’effet d’évolutions technologiques le rendant plus performant. Ensuite avec l’avènement de la civilisation automobile, laquelle va le rendre indispensable afin de « mettre en évidence les obstacles pour permettre à la vitesse automobile de s’exprimer »[5]. Enfin mis au service d’un marketing territorial, les skylines vues de nuit constituant à la fois un indice de dynamisme économique (encore aujourd’hui, les vues aériennes sont utilisées pour illustrer les inégalités entre régions) mais aussi un facteur d’attractivité auprès d’entreprises, d’étudiants, de diplômés et de touristes étrangers[6].
H24
L’éclairage public ne va être qu’un des premier maillons d’une chaîne visant à réduire autant que possible les temps de repos de l’économie capitaliste naissante. Dès ses débuts, un des avantages perçus de l’éclairage public fut d’éviter l’interruption nocturne de grands chantiers[7]. La mécanisation des chaines de fabrication, en sus de la diminution du coût de la main d’œuvre, va évidemment permettre de produire 24 heures sur 24 à l’aide de machines ne connaissant pas la fatigue.
Depuis lors, tout est fait pour garantir une permanence dans la circulation et l’accumulation du capital, réduisant (voire effaçant) la frontière entre le jour et la nuit. Travail de nuit (dont la reconnaissance est de plus en plus remise en cause) ; constance des trafics aérien, routier et maritime ; alternances entre les places boursières selon les fuseaux horaires ; chaînes d’informations et films disponibles en continu ; magasins ouverts à toutes heures du jour et de la nuit ; réseaux sociaux et commerce en ligne permettant à chacun de commenter et d’acheter n’importe quoi n’importe quand. À l’instar des casinos, à l’intérieur desquels tout indice du temps qui passe est supprimé, nos existences semblent devoir se réduire à des machines à dopamine fonctionnant 24 heures sur 24 et alimentant la machine économique sans temps morts.
Sinon la nuit, le sommeil, la flânerie, l’ennuie, voire la réflexion, dérangent le capitalisme. Quand on dort, on ne produit pas. On ne consomme pas. Réduisons donc ce temps au minimum en occupant à outrance le commun des mortels. Soit en le faisant travailler, soit en le divertissant. À l’instar de Las Vegas, métaphore spatiale de la société de consommation et du spectacle, où « il faut occuper, 24 heures sur 24, le client avec des attractions visuelles et sonores plus sensationnelles les unes que les autres, et ne pas lui laisser le temps de comprendre ce qui lui arrive »[8]. Au point que le temps transformé par l’industrie devient lui-même une marchandise consommable[9].
Paradoxalement, cette disparition de la nuit réduit également les espaces de liberté et d’absence de contraintes sociales que cette dernière permettait traditionnellement : fermeture des gares, rétrécissement des horaires d’ouverture des bars, interdictions de rassemblements après une certaine heure, augmentation des dispositifs de sécurité nocturnes ; autant de tendances visant à rendre les nuits uniquement destinées à des usages de production et de consommation suffisamment encadrés pour faire tourner la machine économique sans remettre en cause l’ordre social.
En bref, autrefois, « au milieu d’institutions disciplinaires (lieu de travail, lieu familial, école, églises) existaient des espaces et des moments non régulés, peu surveillés et qui échappaient donc à nombre de contraintes sociales (la nuit en faisant partie). Or, les sociétés modernes se caractérisant par la disparition des interstices, des espaces et des temps ouverts, les mécanismes de commandement et les effets de normalisation se sont mis à pénétrer presque partout et tout le temps »[10].
À quoi sert le sommeil ?
Dans cette mainmise de l’économie sur le temps, le sommeil va également subir d’importants bouleversements. Un des premiers effets de la généralisation de l’éclairage public va être la possibilité pour les gens de rester éveillés plus longtemps, ce qui serait à l’origine de la période unique de sommeil à laquelle nous sommes habitués (auparavant et dans de nombreuses sociétés, le sommeil s’organisait autour de deux périodes). Dans son enquête sur la transformation du sommeil, l’historien Roger Ekirch résume : « autrefois liés aux cycles naturels, le temps devient une marchandise toujours plus précieuse, dont l’usage pouvait être régulé grâce à la précision et à l’accessibilité croissance des montres et des horloges. Pour un nombre toujours plus important de personnes, le sommeil représentait au mieux un impératif biologique, au pire un mal nécessaire qu’il était préférable de contenir en une seule période »[11].
Cette réduction de la nuit et les conséquences sur nos rythmes physiologiques n’en sont qu’à leur début, faisant émerger un certain paradoxe illustratif de nombreux autres aspects de nos vies quotidiennes.
D’un côté, une amélioration des conditions matérielles qui va permettre une hausse de la qualité du sommeil grâce à de nombreux facteurs nous paraissant normaux aujourd’hui : hausse du confort des literies, meilleure isolation des bâtiments (contre le froid, le chaud, le bruit), accès à des antidouleurs, développement de l’hygiène publique et privée (moins d’humidité, protection contre les animaux nuisibles) et sécurisation des habitations (logements hermétiques, préservation de l’intimité, protection contre les incendies, etc.)[12].
Mais d’un autre, au-delà du fait qu’encore aujourd’hui, des centaines de millions de personnes à travers le monde ne bénéficient pas de ces conditions indispensables à une nuit paisible sans crainte ni désagréments nocturnes, l’on remarque une diminution de la qualité du sommeil même chez les personnes ayant accès à tout ce qui peut permettre un sommeil de qualité. Ici encore, de nombreux facteurs socio-économiques sont en cause, à l’instar de la généralisation des écrans (et leur fameuse lumière bleue), de l’accélération de nos modes de vie (tellement de loisirs et de distraction à notre disposition que l’on ne veut pas perdre du temps), du stress et de la pression au travail et dans la vie quotidienne, ou encore d’une hausse de la pollution sonore inhérente à nos sociétés de plus en dynamiques (sirènes, vols de nuit, trafic automobile, etc.).
Résultat : une baisse, et de la qualité, et de la quantité, de sommeil, mesurée notamment par la fréquence des insomnies et le recourt croissant à des solutions médicamenteuses. À noter que si la consommation de somnifères augmente, celle de produits permettant de ne pas dormir (amphétamines, cocaïne, boissons énergisantes, etc.) est également en hausse, non seulement dans les milieux festifs (HORECA, boîtes de nuit) mais aussi étudiants (surtout en période d’examens) et professionnels (les marins pêcheurs figureraient parmi les principaux consommateurs de cocaïne). En parallèle des délires transhumanistes, pourquoi ne pas imaginer une existence sans dormir (des recherches ayant déjà été menées dans ce sens dans le domaine militaire) ?
Les conséquences sanitaires sont importantes et équivaudraient à plusieurs années de vie perdues, ce que l’on constate chez les professions et les populations les plus impactées, à savoir les travailleurs de nuit mais aussi les habitants de zones moins calmes et/ou en manque d’obscurité. Comme le rappelle le géographe Samuel Challéat, « l’alternance naturelle du jour et de la nuit est le premier repère biologique interne (…). Sa perturbation génère donc stress, diminution de la qualité du sommeil, fatigue, irritabilité, troubles de l’appétit, et pourrait même favoriser certains cancers »[13].
Pollution lumineuse
Le sommeil des êtres humains n’est pas le seul élément perturbé par l’excès d’éclairage artificiel, la faune et la flore subissant également les conséquences de cette disparition de la nuit. C’est particulièrement vrai pour les 28% des vertébrés et 64% des invertébrés exclusivement ou partiellement nocturnes[14]. Samuel Challéat liste les conséquences de cette pollution visuelle : « les biologistes et écologues signalent des espèces animales attirées ou repoussées par les sources lumineuses avec pour résultat, dans chacun des deux cas, une érosion de la biodiversité des milieux artificiellement éclairés par surmortalité ou désertion de niches écologiques autour des luminaires. À des échelles plus larges, plusieurs espèces se trouvent désorientées lors de leurs déplacements ou de leurs migrations. La multiplication des points lumineux peut donner naissance à de véritables barrières qui, à l’instar de nos routes ou de nos murs, fragmentent les habitats naturels. Des perturbations sont également relevées dans les comportements des individus de nombreuses espèces en matière de communication, de reproduction ou de prédation. Enfin, des effets directs et indirects sont observés sur la flore : dérèglement des cycles de croissance et des périodes de floraison, ou encore baisse du nombre de visites d’insectes pollinisateurs nocturnes et donc, in fine, baisse du succès reproducteur des plantes »[15].
À côté des biologistes, les astronomes constituent l’autre fer de lance pour la défense de l’obscurité naturelle. Et les raisons dépassent souvent la défense de bonnes conditions d’observation, incluant également le rôle de la nuit étoilée dans notre rapport à l’environnement. Modestie et sensibilisation face à la nature, respect et connexion face aux équilibres naturels, confrontation avec l’obscurité et acceptation de la peur du noir[16], autant de choses que permet un accès à une voie lactée préservée et qui remet notre espèce à notre (minuscule) place. Tout l’inverse des skylines toujours plus vastes symbolisant un mode de vie hors sol.
La nuit, une ressource comme un autre ?
À l’instar des autres nuisances écologiques, la pollution lumineuse pose donc la question de l’accès à une ressource environnementale, en l’occurrence l’obscurité et un ciel étoilé.
Ce faisant et conformément à la logique capitaliste valorisant monétairement ce qu’il détruit, la nuit devient également un objet de profit. À l’instar de certaines régions favorables à l’observation des étoiles (déserts d’Arizona et d’Atacama par exemple), la protection du ciel devient un argument en faveur de retombées économiques qu’engendre un astrotourisme de plus en plus populaire[17].
Dans un autre registre, si le sommeil à proprement parler constitue une perte sèche pour l’accumulation capitaliste, ce qui le permet est au cœur d’une économie florissante, notamment à travers l’hébergement ou le lucratif marché des somnifères déjà évoqués.
Dès lors, l’enjeu est d’ores et déjà de préserver la nuit non seulement de ce qui la détruit, mais également de sa marchandisation, ce qui nécessite de la considérer comme faisant partie d’un patrimoine commun dont personne ne devrait être exclu.
Ce qui implique de questionner et combattre les inégalités inhérentes à la nuit : revalorisation du travail de nuit ; prise en compte de la dimension sexiste (insécurité, temps dans les transports en commun à horaires décalés, impacts des politiques d’économie d’énergie sur les parcours des femmes, etc.) et sociale (usage de la nuit très différent selon les revenus et les classes sociales) de la nuit. Et ce de façon à combiner une amélioration des conditions matérielles d’une majorité (ce qui passe notamment par une hausse de l’électrification de nombreuses régions qui en sont encore dépourvues) avec la préservation de l’obscurité.
À cet égard, la nuit est une énième illustration du traditionnel dilemme entre enjeux économiques et écologiques, lequel ne pourra être résolu qu’en mettant en balance l’utilité sociale de nos productions et nos consommations avec leurs impacts écologiques. En ce qui concerne notre sujet, plusieurs mesures peuvent être facilement adoptées sous condition de volonté politique : interdiction d’enseignes publicitaires lumineuses, lampadaires n’éclairant pas le ciel, sélection des endroits et des moments véritablement utiles à éclairer, baisse de l’intensité lumineuse des éclairages, constitution d’aire protégées de la pollution lumineuse et création de corridors écologiques, etc.
Sans oublier la prise en compte de l’obscurité dans les externalités environnementales inhérentes à toute activité. Surtout portés par les astronomes, de nombreux projets de développement industriel à proximité de zones où la voute céleste est préservée sont d’ores et déjà combattus au nom de la défense du ciel étoilé (notamment en Atacama).
Après tout, que ferions-nous sans la nuit ?
----------
[1] Roger Ekirch, La grande transformation du sommeil, Paris, Éditions Amsterdam, p. 122.
[2] Gérard Dubey, Alain Gras, La servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, Paris, Seuil, 2021, pp. 39-40.
[3] Samuel Challéat, Sauver la nuit. Comment l’obscurité disparaît, ce qua sa disparition fait au vivant et comment la reconquérir, Paris, Premier Parallèle, 2024, p. 116.
[4] Jonathan Cry, 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil, Paris, La Découverte, 2016, p. 26.
[5] Samuel Challéat, op. cit., p. 113.
[6] Ibid., p. 120.
[7] Gérard Dubey, Alain Gras, op. cit., p. 43.
[8] Bruce Bégout, Zeropolis, Paris, Éditions Allia, 2018, p. 26.
[9] Guy Debord, La société du Spectacle, Paris, Gallimard, 1992, p. 151.
[10] Jonathan Cry, op. cit., p. 83
[11] Roger Ekrich, op. cit., p 117.
[12] Roger Ekrich, op. cit., p 150.
[13] Samuel Challéat, op. cit., p. 21.
[14] Ibid., p. 72.
[15] Ibid., pp. 20-21.
[16] Ibid., pp. 49-50.
[17] Ibid., p. 186.
----------
Sur le blog
«Vertiges d’une géographie du ciel» (Gilles Fumey)
----------
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/
Bluesky: https://bsky.app/profile/geoenmouvement.bsky.social



