
Notre monde est-il un théâtre? Il faut poser la question si nous pensons que les images dont nous avons besoin pour le comprendre (cartes, peintures, photos, films, etc.) ainsi que des machines (horloges), des maquettes colorées (globes), des microcosmes de savants ne viennent pas de nulle part. Ils sont issus de spectacles qui ont été mis en forme à partir du 17e siècle par les peintres du paysage, puis des figures de la nature comme les végétaux, les animaux qui furent l’objet de collections, d’images, de machineries sur scène dans les théâtres mises au point par des amateurs de technique. Frédérique Aït-Touati attire notre attention sur le rôle des théâtres italiens dans la fabrique de nos imaginaires. Réinventer nos modes de vie pour comprendre ce qui nous a mené à la dévastation actuelle du monde, un impératif qui passe par cette prise de conscience que nous devons quitter les images que nous manipulons du monde depuis le 17e siècle.
Parce que la Terre tremble et brûle, il faut l’envisager autrement qu’un décor. Une idée chère à Isabelle Stengers depuis longtemps, reprise par Bruno Latour. Ce qui induit une rupture avec la modernité, non seulement scientifique, mais «esthétique» pour Frédérique Aït-Touati. L’historienne montre que le théâtre italien apporte une grande nouveauté par rapport à ce que les Gréco-Romains ont inventé depuis Épidaure: les Italiens ferment la salle et la nature s’en trouve cloîtrée comme dans une boite où les prouesses des ingénieurs vont créer des «infinis» plus vrais que leurs modèles. On artificialise le monde par une mise en scène la nature: les nuages se déplacent, les tempêtes mugissent... Ces performances sont obtenues grâce au savoir technique de Nicola Sabbatini (1574-1654) capable de faire surgir la Lune et provoquer des séismes avec des poulies, des cordes... Pensons au bien nommé Théâtre du Globe, fondé à Londres par Shakespeare en 1599, qui est dans cette filiation.
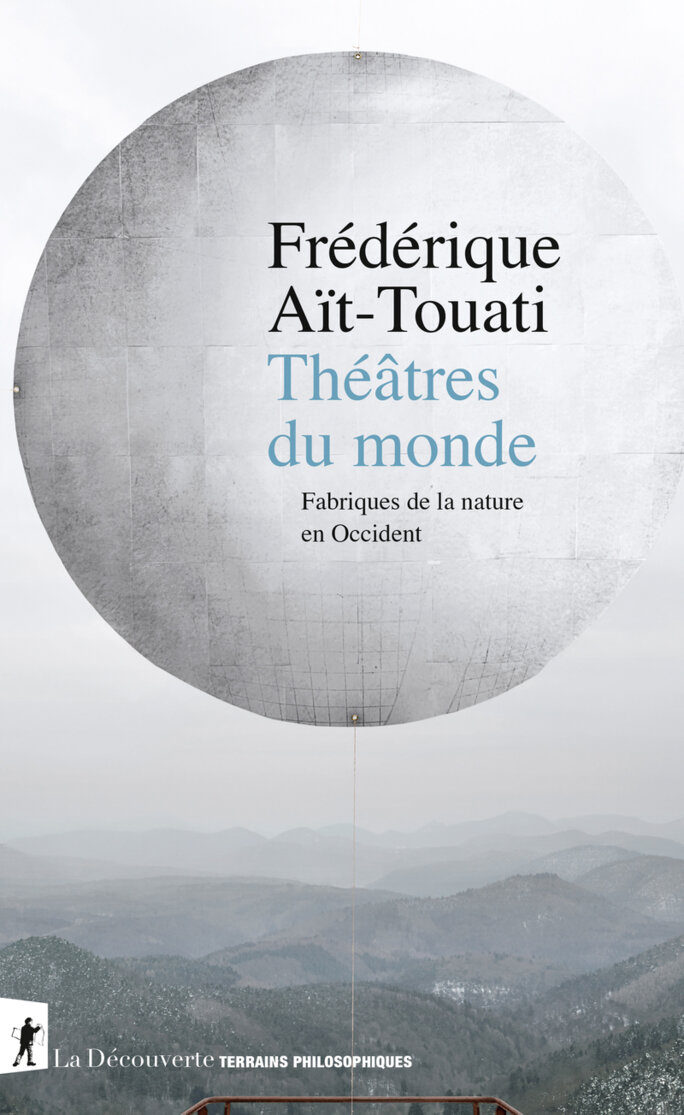
Agrandissement : Illustration 2
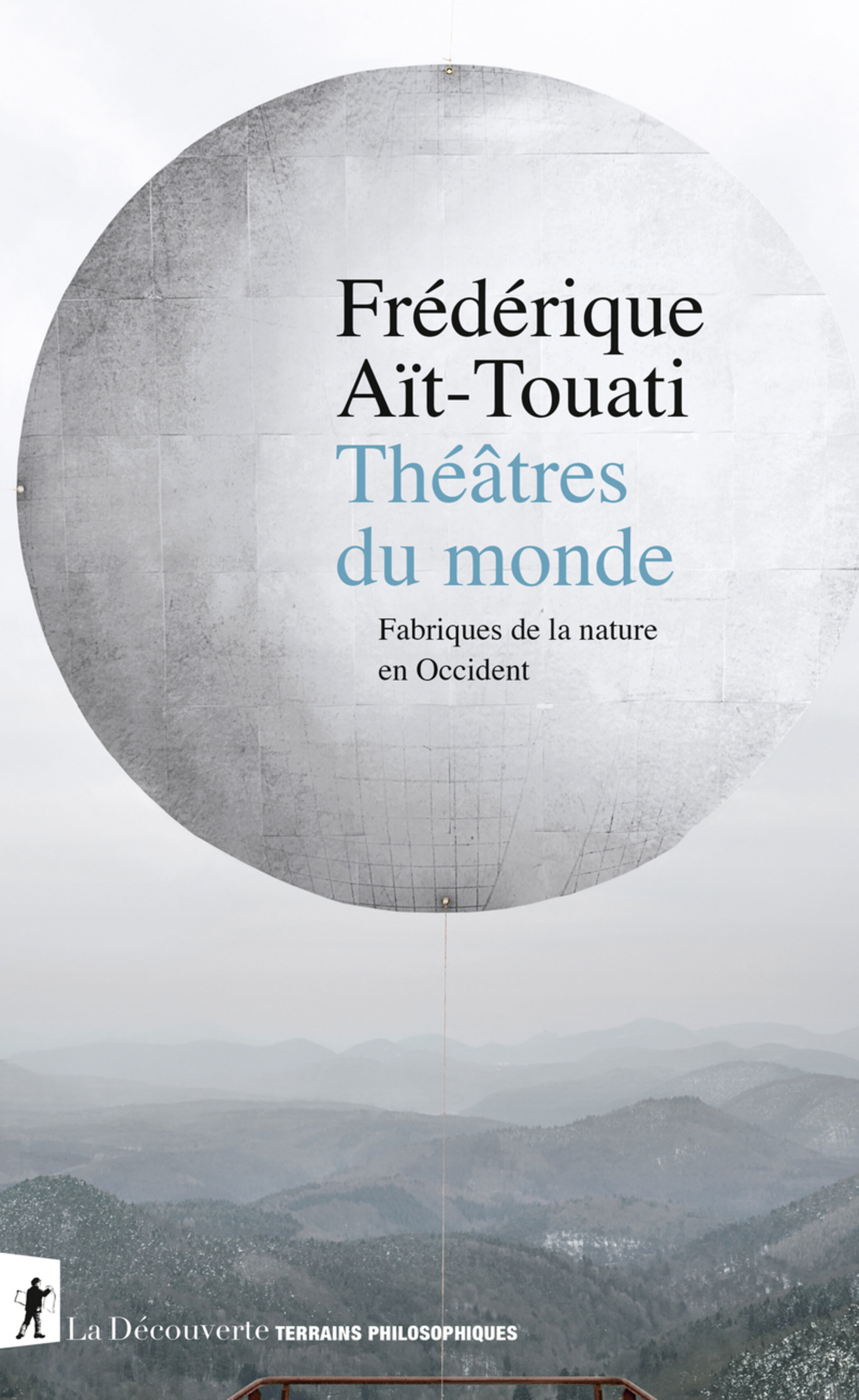
De fait, la nature devient pensée comme une gigantesque machinerie décrite par Descartes, Bacon, Leibniz, Fontenelle pour qui les éléments constituent bien un «théâtre». Oui, le théâtre invente et diffuse des esthétiques du monde. Frédérique Aït-Touati le met en rapport avec l’invention du laboratoire où s’imagine et s’écrit la science. Elle relit Descartes qui écrit une nouvelle cosmogonie, faite de machines, animaux compris. La matière est séparée de la vie. Ce qu’on appelle la nature que nous avons manipulée dès cette époque jusqu’à la crise climatique actuelle, c’est le produit d’une physique qui va s’incarner dans la Cité par l’absolutisme royal et ses outils comme les cabinets d’histoire naturelle, l’Observatoire, les académies, le Jardin des plantes et le parc du château de Versailles. Progressivement, naît un récit d’ouverture au monde qui prend la forme de l’expansion coloniale.
Lorsque j’ai soutenu une thèse de doctorat sur le paysage en 1983, les frontières entre biotique (le végétal et l’animal) et abiotique (le minéral) étaient très étanches, ces catégories ne se mêlaient pas. Le géographe Georges Bertrand, concepteur du géosystème, avait osé lancer au cours du débat: «Le paysage est un processus physico-chimique, point barre.» Quarante ans ont passé, tout a changé. Les humains sont plus que jamais en connexion avec les non humains, la géochimie nous a familiarisés avec des symbioses invisibles à l’œil nu (les fameux cycles du carbone, de l’azote, etc.), le Covid a rappelé à notre monde hyper-technicien le rôle des virus...
Pour marquer cette transformation, Frédérique Aït-Touati a pu mettre en scène le Bal de la Terre avec Bruno Latour, dans lequel danseurs et spectateurs sont un même ensemble vivant. Les décors ont disparu au profit des récits. Puis vint le Théâtre des négociations aux Amandiers à Nanterre en 2015, peu avant la COP 21 de Paris. Le public a pu découvrir le «parlement des choses» et rassembler dans les négociations en cours, aussi bien les États que les animaux et les fleuves. Du coup, le théâtre devient un laboratoire philosophique, voire politique. Les entités de la nature peuvent donc être assemblées pour discuter de leurs propriétés politiques, juridiques...
Pour Frédérique Aït-Touati, les théâtres – mais on pourrait ajouter certaines fêtes populaires – deviennent des lieux d’élaboration de pensée collective du monde. Comment comprendre les campagnes françaises, déboussolées par les mutations qu’elles subissent ? Les villes et les métropoles par les ségrégations qui s’y exercent ? Comment reconfigurer nos sociétés sans qu’elles soient écrasées par les technologies ? Comment penser la planète Terre lorsque l'art est toujours un geste affirmant que le monde est un objet extérieur, posé là, représentable, bricolable, à la merci de nos instincts, de nos folies qui mènent à la destruction ?
----------
Frédérique Aït-Touati, Théâtres du monde, La Découverte, 2024.
----------
Sur le blog
Les arbres peuvent-ils plaider ?
Le Doubs traînera-t-il l’État et les politiques au tribunal ?
L’été, des glaciers fondent, des militants se recueillent
----------
Pour nous suivre sur Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/



