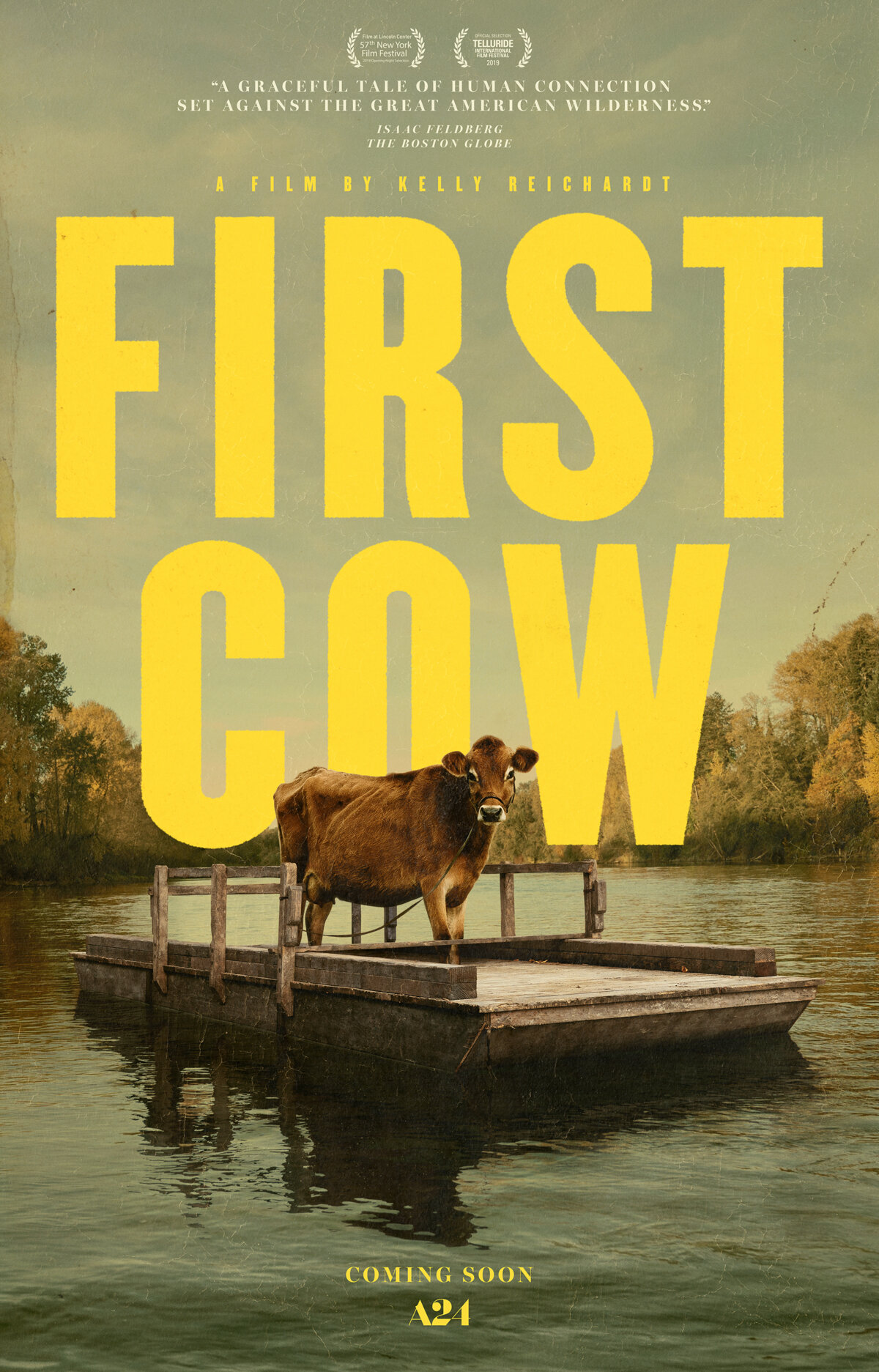
Agrandissement : Illustration 1
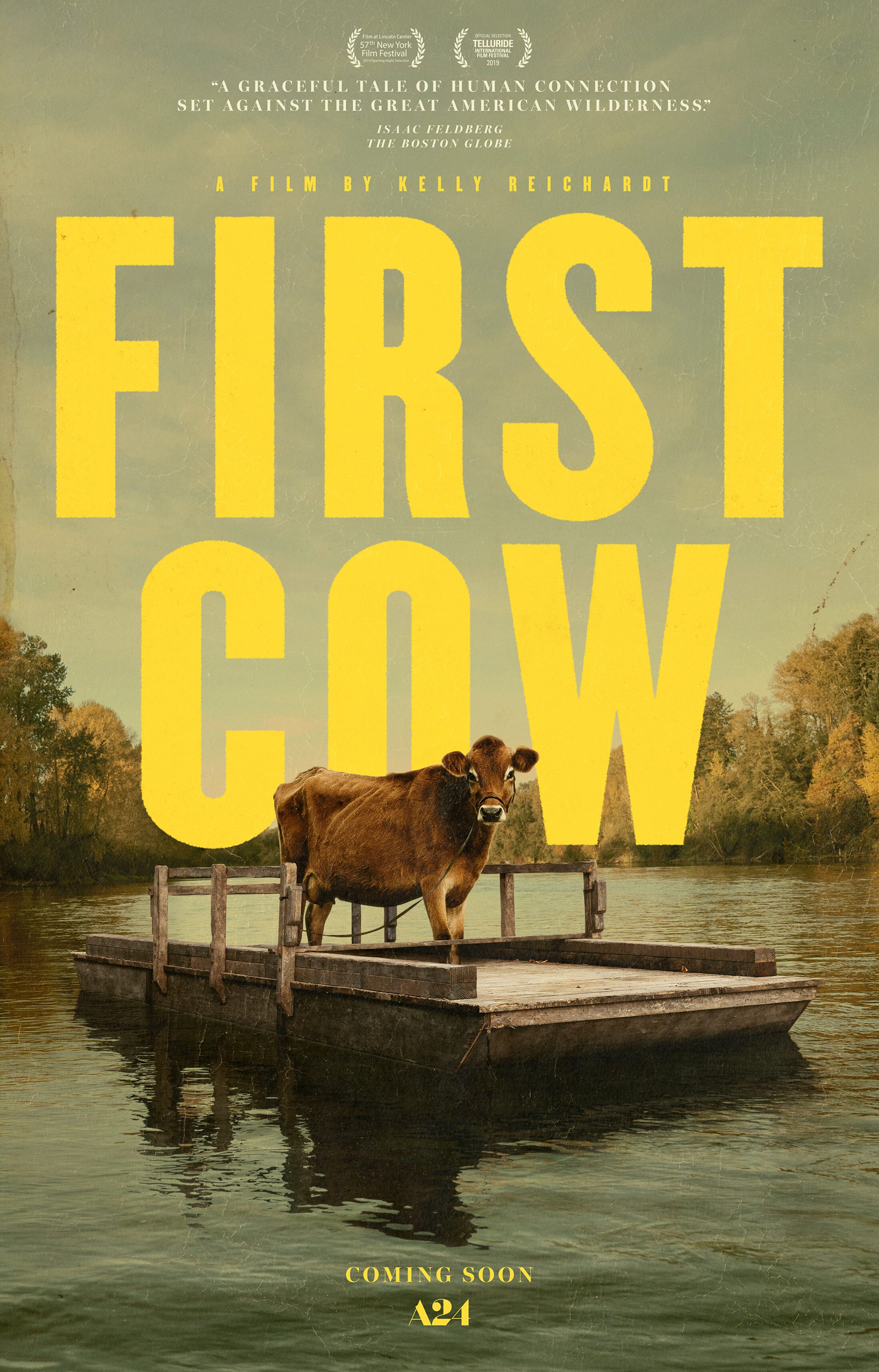
Une vache, un cuisinier naïf surnommé Cookie (John Magaro) et un ancien marin chinois, King-Lu (Orion Lee), qui a « vu les pyramides ». On est dans le premier tiers du 19e siècle. Un improbable trio se forme quelque part dans ce qui deviendra en 1859 l’État de l’Oregon, où les trappeurs tentent de faire fortune grâce au commerce de la peau de castor.

Agrandissement : Illustration 2

La vache, seule de son espèce dans ces territoires du nord-ouest à peine conquis, a perdu mâle et veau durant son périple jusque chez le riche négociant anglais qui l’a achetée. Cookie, lui, doux comme un agneau et pas fichu d’attraper du gibier, se demande pourquoi il a quitté son Maryland natal. Mais il cuisine de délicieux biscuits au beurre et au miel, pourvu que la vache lui donne un peu de lait quand son propriétaire officiel dort. Quant à King-Lu, il a le sens des affaires et croit en sa bonne étoile : les biscuits, dans ces rudes contrées où l’on se contente souvent de viande d’écureuil, doivent garantir la fortune des deux compères.
Ramener le western sur terre
En compagnie de ces personnages à la fragilité peu adaptée aux rigueurs de l’Ouest, Kelly Reichardt revisite le western. Déjà dans La dernière Piste (2010), elle dynamitait le genre en adoptant, au sein d’un groupe de pionniers perdus dans les prairies du Midwest, le point de vue des femmes. Chercher du bois, faire partir un feu avant l’aube, préparer du café au petit matin : loin des épopées viriles de John Ford ou Howard Hawkes, Reichardt ramenait le mythe sur terre et, au passage, dressait la liste des activités de reproduction sans lesquelles il n’y aurait pas eu de conquête de l’Ouest. Sorti quelques mois après l’élection de Barack Obama, le film offrait aussi un bilan sévère de huit ans de présidence Bush junior : menées en bateau par un bonimenteur qui leur avait fait miroiter un raccourci, bientôt à cours d’eau potable, les trois familles de pionniers finissaient par mettre leur destin entre les mains d’un Indien capturé en route.
Près de dix ans plus tard, Reichardt reprend le format carré et évite toute envolée lyrique. Sans pour autant oublier la beauté des paysages forestiers du nord-ouest des États-Unis, ni mettre de côté l’enjeu de l’appropriation de l’espace. Mais plutôt que de les traiter sur le mode d’une geste glorieuse, le film fait des modalités d’interaction entre l’humanité et son milieu, que les géographes appellent l’habiter, une question philosophique et politique : entre mille manières possibles d’habiter le monde, les individus et les groupes doivent faire des choix lourds de sens.

Agrandissement : Illustration 3

Avec le personnage de Cookie, sans doute le plus proche d’elle, la réalisatrice célèbre la sobriété : passer le balai et mettre quelques fleurs sauvages dans un vase pour égayer une cabane de trappeur, cueillir des champignons et des noisettes, pêcher, cuisiner. Et traire, patiemment. Cookie est près de la terre, sa relation avec le milieu se nourrit de modestie et de simplicité volontaire, sur le mode de la communion, mais sans verser dans l’animisme ou la glorification naïve de « Gaïa ».
La mise en marchandise de l’Ouest
À l’opposé, le négociant anglais joué par Toby Jones incarne la logique comptable et marchande en train de conquérir le Far West. King-Lu commet une sérieuse erreur de jugement lorsqu’il affirme que « l’histoire n’est pas encore arrivée ici » : elle est bien là, en la personne des propriétaires terriens et de l’armée à leur service. Il n’y a déjà plus de place pour les aventuriers comme lui, convaincus que les plus volontaires ou les plus chanceux feront fortune. Encore moins pour les adeptes de l’idéal jeffersonien d’une nation de petits fermiers. La wilderness est progressivement quadrillée par les propriétés des riches colons et même la vache finira dans un enclos cadenassé.
Quant aux Indiens Nez-Percés, désormais ouvriers ou domestiques, ils se demandent, incrédules, pourquoi les Blancs ne mangent pas la queue des castors – le meilleur, paraît-il. C’est que les ressources de l’Ouest sont devenues des marchandises prises dans les réseaux du capitalisme mondialisé : les rongeurs se font massacrer tant que leur peau possède une valeur, c’est-à-dire tant que la mode parisienne est au chapeau en fourrure de castor. Puis ce sera autre chose.
Tout comme la vache fraîchement arrivée se réduit, pour son propriétaire, à un investissement. Quand Cookie tisse, au fil des séances nocturnes de traite, une relation complice avec le bovin, le négociant ne voit dans sa nouvelle acquisition qu’un outil de production, du capital fixe dont on peut mesurer la rentabilité. Même le clafoutis qu’il commande à Cookie n’est qu’un moyen de briller et d’humilier un rival. Vaches, castors, terres, êtres humains, pâtisseries, tout se mesure, tout se compte pour sa mentalité d’épicier.
Péché originel
À la fin du 19e siècle, le pourfendeur de la modernité Villiers de L’Isle-Adam imaginait, dans un de ses « contes cruels », une invention permettant de transformer le ciel, ces « voûtes azurées qui ne servent à rien », en panneaux publicitaires géants. À l’heure où Elon Musk transforme les « espaces stériles » du ciel en puits de milliards, First Cow parle de notre monde et résume son propos en un raccord : alors que King-Lu rêve de fortune et se demande à voix haute combien pourraient rapporter les biscuits de Cookie, celui-ci lève les yeux vers les étoiles : un ciel nocturne n’a pas de prix, des biscuits non plus si on les prépare pour le plaisir.
Le film raconte l’histoire d’un péché originel, celui de l’avènement de la valeur – et de l’argent qui la mesure. Dès que les biscuits de Cookie acquièrent une valeur, du moment où le cuisinier les confectionne pour les échanger sur un marché, ils basculent dans la logique marchande, celle-là même qui régit notre rapport au milieu et aux autres.
---
---
Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/geographiesenmouvement



