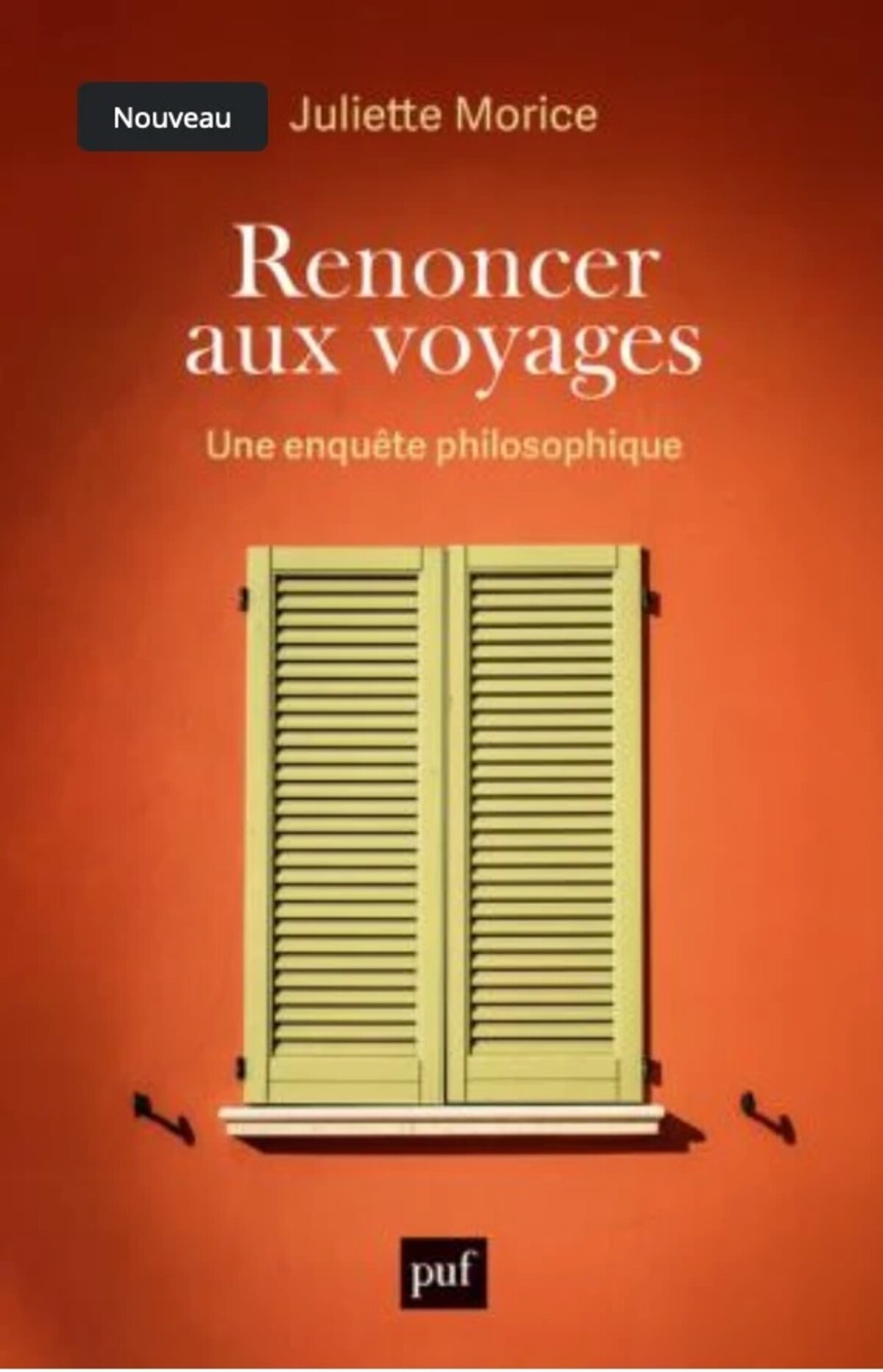
Agrandissement : Illustration 1
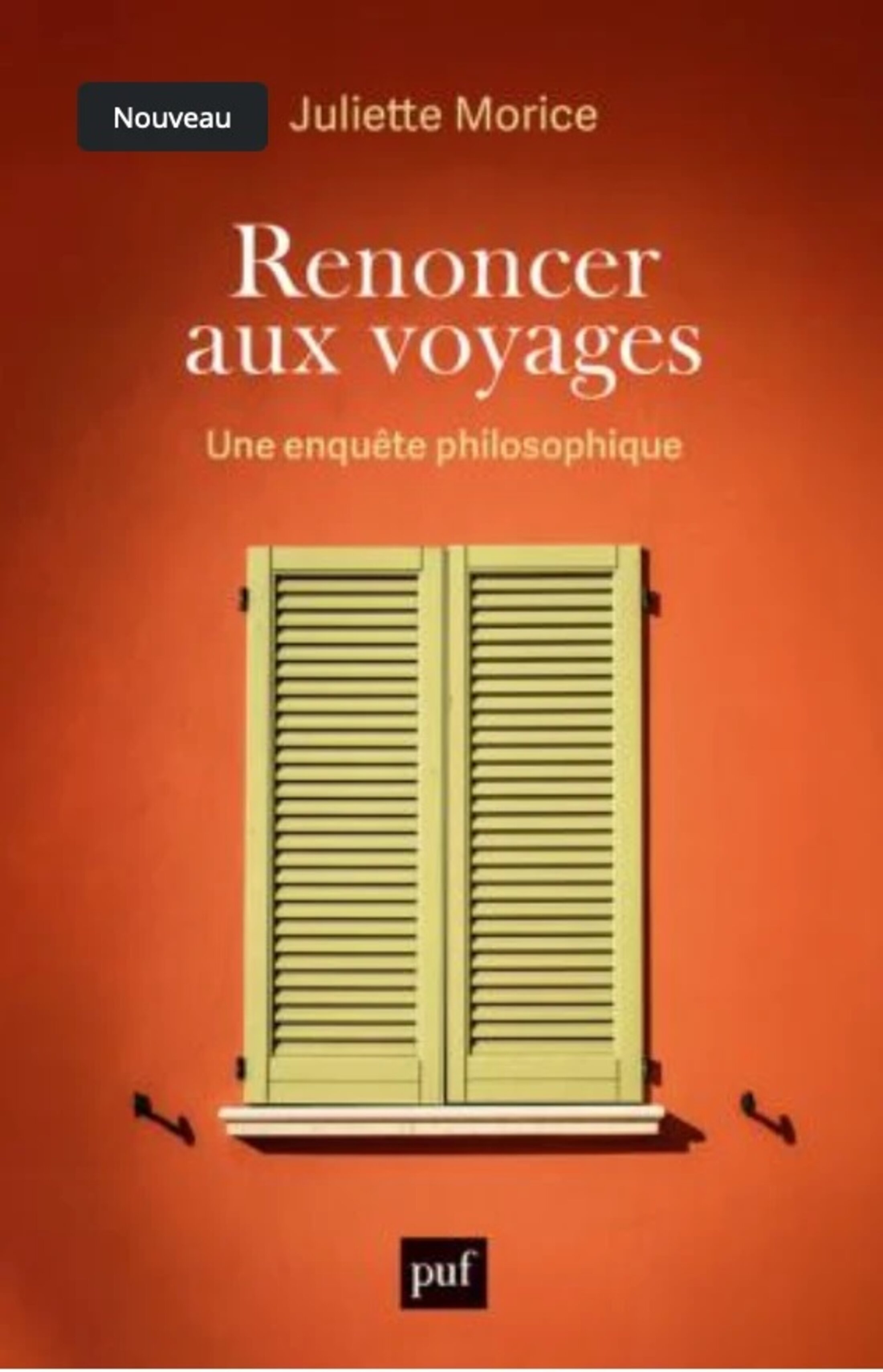
Rien de nouveau sous le soleil, selon Juliette Morice qui vient de signer Renoncer aux voyages. Une enquête philosophique (PUF). Du reste, qu’est-ce que voyager? Mettre une distance géographique entre l’ordinaire et ce qui y déroge? S’absenter de chez soi pendant plusieurs jours? Qu’en serait-il des «vrais» voyages, ceux qu’on estimerait «réussis» parce qu’aurait «surgi l’imprévu» ou, inversement, parce que tout se serait passé comme on l’entendait? Même le génial Diderot s’emmêlait les idées lorsqu’il écrit à Sophie Volland que le voyage est une «sotte chose» mais qu’au final, cela «fait [du] bien».
Passée la sidération du Covid (2020-2021) qui a limité temporairement les déplacements[1] et initie un nouveau chapitre sur l’utilité du tourisme, la réouverture en trombe des aéroports et les fanfaronnades de l’Office mondial du tourisme (2 milliards, soit un humain sur quatre pendant une séquence annuelle) renvoie-t-elle à de nouvelles questions? Pas sûr, car les Grecs, tel Sénèque, si l’on veut, tout comme un Montaigne, un Baudelaire ou un Emerson, tous donnent le sentiment qu’on n’a pas cessé de tergiverser sur l’utilité des voyages dont l’expérience est «fondamentalement contradictoire». Avec toujours cette conviction que les voyages aujourd’hui ne sont plus ce qu’ils étaient, que le dépaysement est plus difficile aujourd’hui, que les générations nouvelles ne savent plus voyager, acceptant d’être «transportées» dans des conditions de grand confort. Le voyage serait-il mort?
À quoi bon parcourir la France si la grande vitesse ferroviaire empêche de lire les paysages? Si les avions gomment l’espace-temps d’un point A à un point B? Si l’exploration est impossible faute de terres inconnues comme Rousseau ou Kipling le déploraient déjà à leur époque? À quoi bon les voyages si persiste l’impossibilité de la rencontre avec les habitants d’un lieu, comme on le regrettait déjà à l’époque moderne?
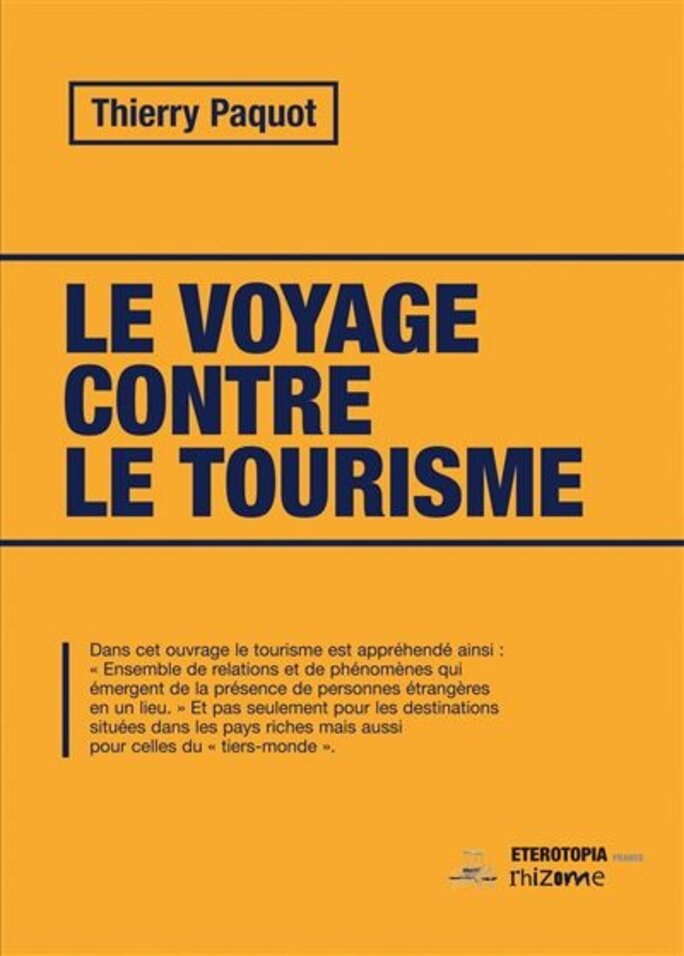
On dira que le tourisme, bien que «pratique contrainte» pour Thierry Paquot, à la différence du voyage, pourrait mieux servir ce désir de l’autre. Mais est-ce si sûr, Jean-Didier Urbain[2] récuse l’idée que le voyageur s’opposerait au touriste, le premier n’étant pas plus clairvoyant que le second. Après tout, le tourisme comme occupation élitiste née au XVIIIe siècle répond à des questions posées par les jeunes aristocrates anglais sur les sources de leur culture. Plus généralement, ne cèdent à cet appel de l’ailleurs que ceux qui ont un certain capital culturel. Aujourd’hui, ce sont des entreprises qui favorisent le lien entre ceux qui veulent bouger et ceux qui ne le veulent (ou ne le peuvent) pas, vers des lieux jugés «à voir» par les premiers guides de l’époque moderne[3]. L’Unesco se fourvoie avec sa liste de «hauts lieux» en imaginant stimuler une «mémoire collective», voire éduquer à l’attention, la conservation. Éduquer comment, lorsque tout se ressemble, des hôtels aux gares (aériennes et terrestres), des quartiers historiques aux fronts de mer, des festivals aux méga-événements (JO, expositions universelles)? Éduquer à quoi, lorsque la crise environnementale coûte déjà près d’un dixième des gaz à effet de serre et inviterait plutôt à rompre avec le tourisme de masse et ses sous-produits sexuel, médical, équitable... Éduquer comment avec l’accroissement du nombre des baby boomers retraités et sollicités par les vendeurs de rêve touristique qui prétendraient, enfin, rattraper un illusoire retard perdu durant leur vie active?

Agrandissement : Illustration 3

Prenons un lieu emblématique de cette hypnose des lieux qui a mené des centaines d’alpinistes à tenter de gravir le toit du monde: l’Everest. Vous êtes Européens, avec une agence spécialisée? ça vous en coûtera en 2024 environ 100 000 euros. Vous confiez votre lubie à une agence népalaise, comme c’est le cas pour la grande majorité des grimpeurs? Comptez 40 000 euros. Vous aurez souvent des cordes déjà installées par des sherpas, vos équipements sont de plus en plus légers, comparés à ceux d’Alexandre de Humboldt sur le toit du monde d’alors, le Chimborazo en Équateur, en juin 1802 où à près de 6 000 mètres d’altitude, le naturaliste est habillé "en petites bottes, en simple habit, sans gants" et sans oxygène, bien sûr. Résultat: aujourd’hui, les pentes himalayennes voient une file indienne de grimpeurs à la queue leu leu, avec des enfants de 13 ans, des retraités qui en ont soixante de plus, des double-amputés fiers d’avoir atteint le sommet. En échappant à une mauvaise météo qui peut vous envoyer à la mort, comme les 18 amateurs ayant péri en 2023. Un triste record qui, loin de décourager les plus intrépides, stimulerait l’envie de se confronter à la montagne, comme les chercheurs le pensent en analysant un bond des visites en 1997, l’année qui suivait la parution de Tragédie à l’Everest de Jon Krakauer. Le journaliste étatsunien Will Cockrell aime, d’ailleurs, à citer les très bons grimpeurs que sont les sherpas. L’un d’entre eux témoigne d’une rencontre illusoire à propos des touristes qu’il guide: «Pourquoi viennent-ils ici chercher des choses qu’ils n’y ont pas perdues?»[4]
-----------
[1] Isabelle Frochot, Véronique Mondou et Philippe Violier, « Post-Covid hypermobile tourist practices facing environmental challenges», Mondes du Tourisme [En ligne], 2024.
[2] Jean-Didier Urbain, L’Idiot du voyage, Payot, 2002 (1re édition 1991).
[3] À titre d’exemple, ce touriste qui se vante d’avoir pris l’avion à Londres un jeudi soir et être au bureau le lundi matin après avoir gravi le mont Blanc dans le week end.
[4] Everest Inc.: The Renegades and Rogues Who Built an Industry at the Top of the World, Gallery Books, 2024.
---------------
Sur Médiapart
Les adversaires du surtourisme bousculent l'été espagnol
Sur notre blog
L'oisiveté des riches en croisière
Grimper et courir sur des sommets
Sauve qui peut ! Revoilà les touristes
"Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose..."
Sept personnages en quête de touristes (Dreamaway)
Sri Lanka : Le tourisme est-il dangereux ?
----------------------
Voyager local si vous habitez le Grand Paris
Conférence de Thierry Paquot à Chamonix à l’École de ski et d’alpinisme en février 2023.
Le voyage contre le tourisme (3e éd.), Thierry Paquot, Eterotopia, coll. Rhizome, 2024
Pour nous suivre sur Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/



