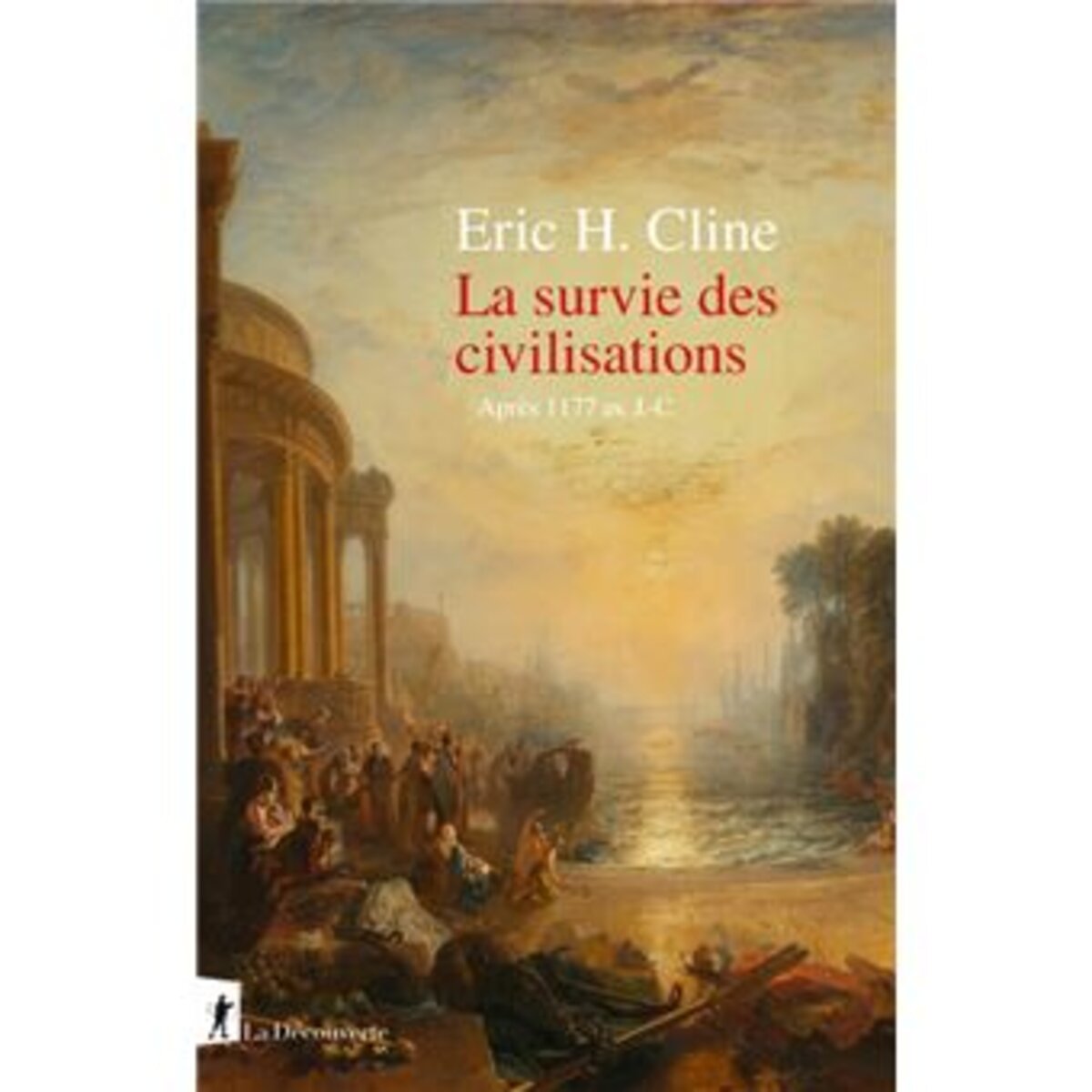
Comment préparer l’avenir de notre civilisation menacée par le changement climatique ? Peut-on le faire en étudiant ce qu’on a appelé les «siècles obscurs» (12e-7e siècle av. notre ère) qui sont très loin de notre présent ? Eric H. Cline veut le croire en examinant ce qui s’est passé autour de la Méditerranée «après 1177 av. J.-C.», sous-titre de son nouveau livre La survie des civilisations désormais traduit à La Découverte. L’historien étatsunien de l’université George Washington confronte des centaines de documents. Dans une enveloppe territoriale de l’Italie à l’Afghanistan actuels, comprenant des peuples fortement reliés entre eux, Cline rassemble le destin des Mycéniens, Minoens, Hittites, Cananéens, Chypriotes, Assyriens, Égyptiens et Babyloniens. Par la diplomatie et le commerce, ils forment pour lui un ensemble qui pourrait donner du sens à notre présent. Pourquoi ? Parce qu’un krach démographique a touché la Grèce autour du 12e siècle avant notre ère : le pays perd 40% de sa population en deux cents ans. L’Europe méditerranéenne n’en est-elle pas loin ? Cette perte est-elle liée à une épidémie ? Des migrations ? Possible, d’autant que le processus de déclin est, selon notre historien, identique en Anatolie (actuelle Turquie), en Mésopotamie et dans l’actuelle Palestine où rois et marchands échangeaient activement.
Que se passe-t-il après la catastrophe ?
Cline a retenu la date de 1177 av. J.-C. qui correspond à celle d’une attaque violente contre l’Égypte de la part de ses voisins insulaires et qu’il considère comme un effondrement. Dans l’Égypte pharaonique, une sécheresse s’installe pendant près de deux siècles, «un réchauffement climatique comme on le connait aujourd’hui ?» se demande Cline. L’assèchement du climat touche aussi l’Assyrie et la Mésopotamie.
Cline est persuadé que, dans le changement du climat avec la sécheresse, les famines, les maladies, les invasions, les réfugiés, les séismes, tout est lié. Mais certains peuples vont bien s’adapter, d’autres non. Dans les siècles de changement climatique à l’époque, les Phéniciens et les Chypriotes survivent mieux car ils diffusent le fer qu’ils maîtrisent bien et l’écriture alphabétique. Ils savent garder et développer un réseau de routes, s’approvisionner et assurer les réserves. A Babylone et dans l’empire assyrien, les grands fleuves que sont le Tigre et l’Euphrate, moins touchés par la sécheresse ont pu permettre d’éviter des catastrophes politiques. Ce n’est pas le cas en Anatolie où le plateau des Hittites connaît une vraie décadence, liée peut-être aux conflits familiaux à la tête du pays. Pour les Mycéniens, Cline hésite à impliquer le poids excessif exercé par les dirigeants sur les classes inférieures. Et l’Égypte ? Après l’assassinat de Ramsès III qui pourtant avait résisté aux attaques des Peuples de la mer, on suppose que les disettes et les famines ont provoqué des contestations de l’esclavage par le peuple lui-même. Cline voit des oppositions de fonctionnaires et de prêtres contre les pharaons eux-mêmes, conduisant à une confusion politique gravissime.
Cette époque que l’on appelle «archaïque» qui se recompose grâce au commerce maritime phénicien qui diffuse une langue à l’origine des alphabets grecs et latins, se réorganise constamment comme le montrent les cités grecques et des petits États nés de la chute des royaumes mycéniens et minoens. Elle donne l’occasion d’une réflexion comparative de grande ampleur en écho à nos anxiétés contemporaines. La chute des empires peut être un marronnier, mais leur faiblesse face aux changements climatiques un champ nouveau ouvert par le géographe Jared Diamond il y a vingt ans. La résilience des pays se fait en fonction de leur taille, des politiques mises en œuvre, des relations avec les voisins. Pas de facteur unique mais la capacité d'une société à se projeter au-delà des événements.
-------------
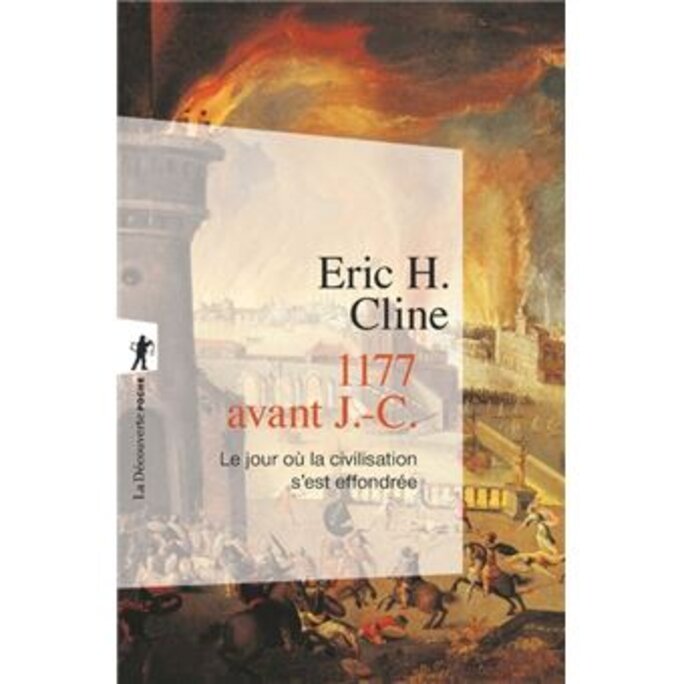
Pour mémoire, le précédent ouvrage de Eric H. Cline
Cline mettait en récit la fin de l'âge du bronze sous la forme d'un drame en quatre actes. Il faisait revivre sous nos yeux ces sociétés connectées qui possédaient une langue commune, échangeaient des biens (grains, or, étain et cuivre, etc.), alors que les artistes circulaient d'un royaume à l'autre. Les archives découvertes témoignaient de mariages royaux, d'alliances, de guerres et d'embargos. Une " mondialisation " avant l'heure, confrontée notamment à des aléas climatiques qui pourraient avoir causé sa perte...
----------
Sur le blog
«Regard spatial sur la collapsologie» (Renaud Duterme)
«Comment les nations font face aux crises?» (Gilles Fumey)
----------
Nous suivre sur Facebook: https://facebook.com/geographiesenmouvement/



