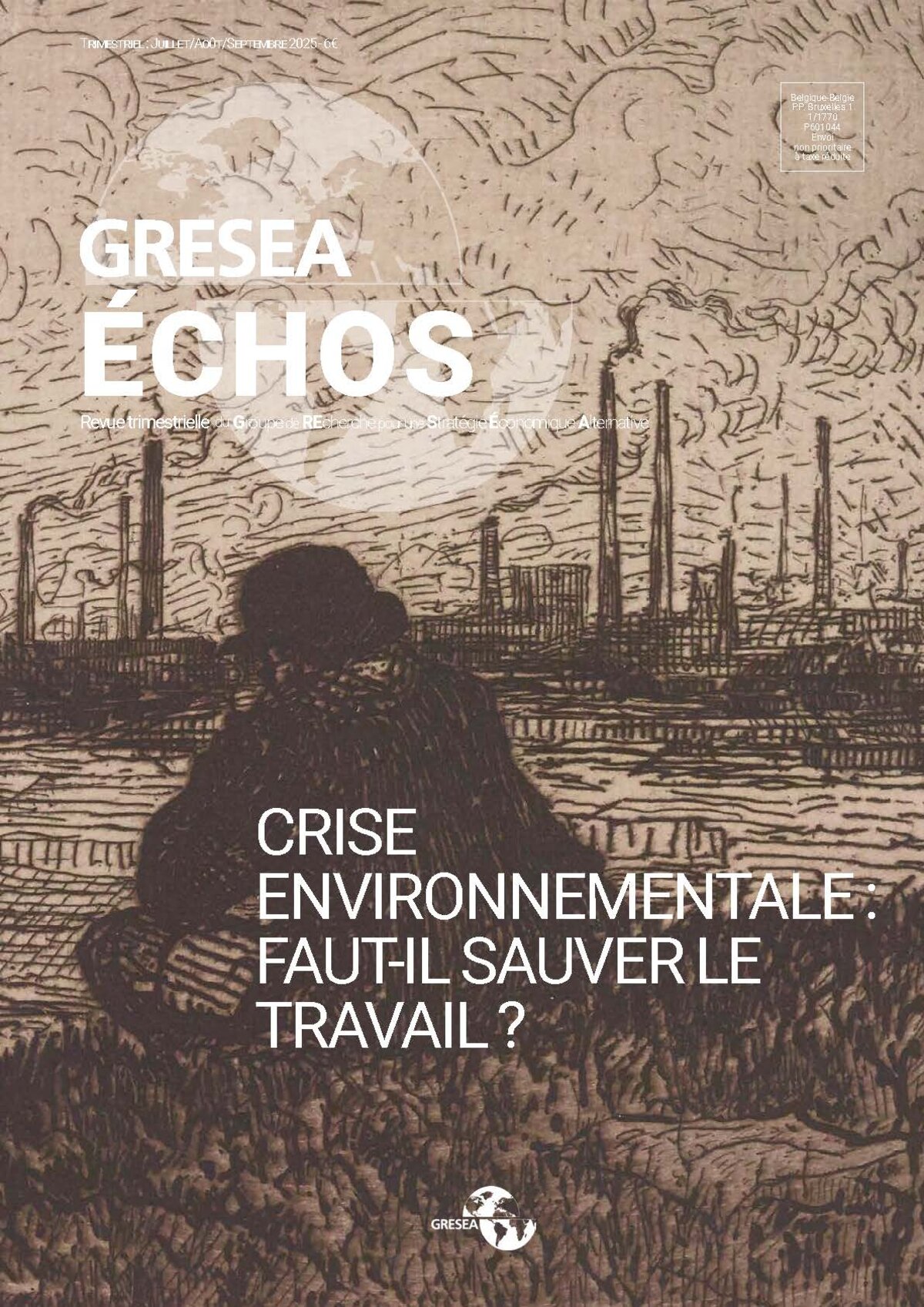
Agrandissement : Illustration 1
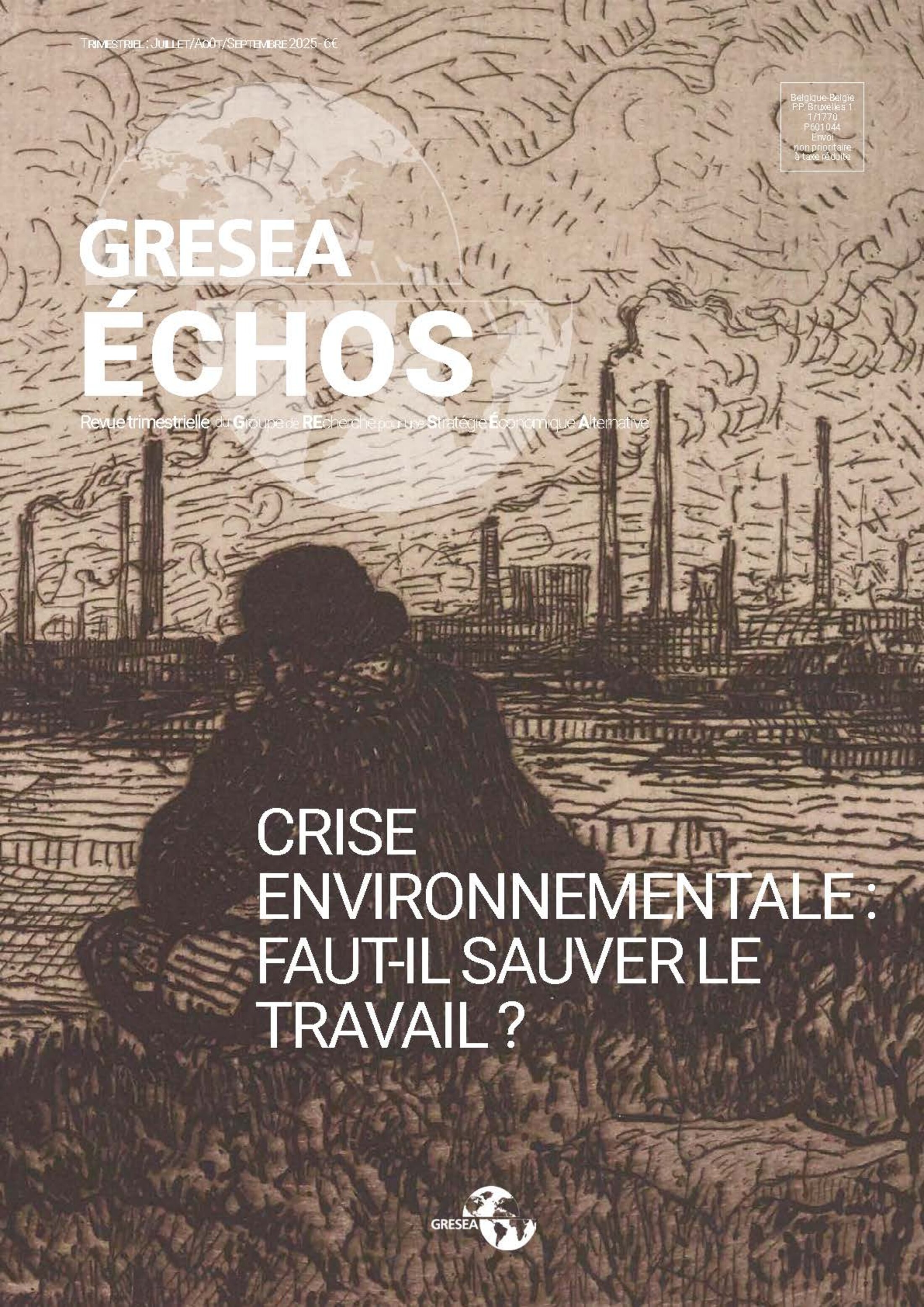
Édito: Romain Gelin
Le travail contre l'écologie ?
L’objectif fixé dans l’Accord de Paris en 2015 – rester sous le seuil de 1,5°C d’augmentation des températures globales par rapport à l’ère préindustrielle – n’est d’ores et déjà plus atteignable. Au rythme d’émission actuel, ce seuil sera dépassé dans les 5 ans. C’est ce que nous apprenait une étude parue en juin 2025 [1]. Dix ans après la COP21, le constat est sans appel : les promesses climatiques ne seront pas tenues.
Dans le même temps, les gouvernements successifs surfent sur le « travailler plus ». En Belgique, le gouvernement Arizona, issu du scrutin de 2024, a autorisé le travail de nuit alors qu’il n’était auparavant permis que dans certains secteurs d’activité et augmenté les quotas d’heures supplémentaires. Comme décidé en 2014, l’âge légal de départ à la pension est passé à 66 ans en 2025 et sera de 67 ans en 2030. En France, l’âge de départ à la retraite est récemment passé à 64 ans. Quant à l’espérance de vie en bonne santé, en 2022, elle était de 63,7 ans en Belgique et de 64,4 ans en France (données Eurostat). Le Premier ministre français a récemment proposé de supprimer deux jours fériés et de « monétiser » une semaine de congés payés (que l’employeur pourrait « racheter » au travailleur).
L’humanité souffre d’un excès de production et de consommation, mais nos dirigeants nous expliquent qu’il faudrait travailler plus et plus longtemps, c’est-à-dire produire et donc consommer dans des proportions croissantes. Le mur se rapproche, mais nous accélérons. Ici, notre réflexion ira à contre-pied des propositions gouvernementales puisqu’il s’agit de s’interroger sur la centralité du travail dans nos sociétés. Autrement dit, nous demander si le travail, en tant que valeur sociale centrale et facteur de production de valeur économique, est une opportunité ou un obstacle pour résoudre la crise environnementale.
Pour ce faire, nous avons choisi d’en passer par l’histoire. Dans la première (et la plus longue) partie de cette étude, nous tenterons de comprendre la manière dont le travail a été perçu par nos ancêtres. Le travail a-t-il toujours été central dans les sociétés du passé ? Si tel n’a pas été le cas, comment en est-on arrivé à la situation actuelle ? Et quelles critiques ont pu être formulées à l’égard de la centralité du travail au cours des deux derniers siècles ?
Si le terme de « travail » est intuitivement compris de tous, il en existe pourtant plusieurs définitions. Le Robert définit le travail comme l’ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Une autre définition, plus étroite, liée aux sciences économiques ne considère comme du travail que l’activité rémunérée et formelle – excluant toutes les formes de travail domestique, d’entretien, de reproduction ainsi que tout le travail informel. Pour d’autres auteurs, le travail inclut le travail domestique et informel. Nous verrons que ces définitions contemporaines ne font pas grand sens pour une large partie de l’histoire, au moins jusqu’à la Renaissance. Le travail n’est pas une catégorie naturelle et transhistorique. Il relève d’une convention sociale en évolution permanente. À chaque période étudiée, nous essayerons de donner des éléments de contexte pour mieux cerner la manière de percevoir le travail – productif ou non – dans les différentes sociétés.
Notons d’emblée que le tableau proposé sera largement eurocentré, du fait des sources à disposition, et du défi colossal que constituerait la rédaction d’une histoire mondiale du travail et du temps de travail. L’objectif, sans prétendre à la moindre exhaustivité, étant de discuter de la manière dont les sociétés du passé ont pu se positionner face au travail et de prendre un peu de recul par rapport à la centralité sociale du travail promue par le banc patronal et la droite du spectre politique, mais aussi par une grande partie de la gauche politique et syndicale.
Dans une seconde partie, nous nous intéresserons au temps consacré au travail au cours de l’histoire, en reprenant les mêmes repères géographiques et temporels que dans la première partie. L’idée sous-jacente étant ici de se demander si les durées de travail actuelles – 7 à 8h de travail par jour, 5 jours par semaine avec 4 ou 5 semaines de congés payés par an – ont été la norme dans le passé ou si, au contraire, nos ancêtres travaillaient beaucoup plus ou beaucoup moins.
Enfin, en guise de conclusion, nous tenterons de synthétiser les éléments parcourus dans les premières parties, pour interroger la « valeur travail » et le temps de travail à l’aune de la crise écologique. La réduction collective du temps de travail est-elle de nature à réduire l’empreinte environnementale de nos sociétés ? Dans quelles conditions ? Plus généralement, le « culte du travail » peut -il nous aider à formuler une voie de sortie à la crise écologique ou constitue-t-il un obstacle ?
La dimension polyphonique de la catégorie travail rend difficile l’exercice présenté dans cette nouvelle livraison du Gresea Échos. Dans une correspondance avec le philosophe Jean-Marie Vincent, André Gorz expliquait : « Je sais bien que la "loi de la valeur" et la "théorie de la valeur travail" sont des domaines particulièrement compliqués, controversés, difficiles, et que tout non-spécialiste qui s’y aventure est immanquablement pris sous les feux croisés de marxologues en désaccord entre eux. Je prends néanmoins le risque (…) » [2] C’est un peu dans le même état d’esprit et dans la même perspective que nous nous sommes confrontés au travail sur le travail.
Sommaire
Éditorial : Le travail contre l’écologie ?
Le travail : une histoire polyphonique
Le temps de travail dans l’histoire
Travail, temps et environnement
Pour commander ce numéro ou vous abonner, cliquez ici.



