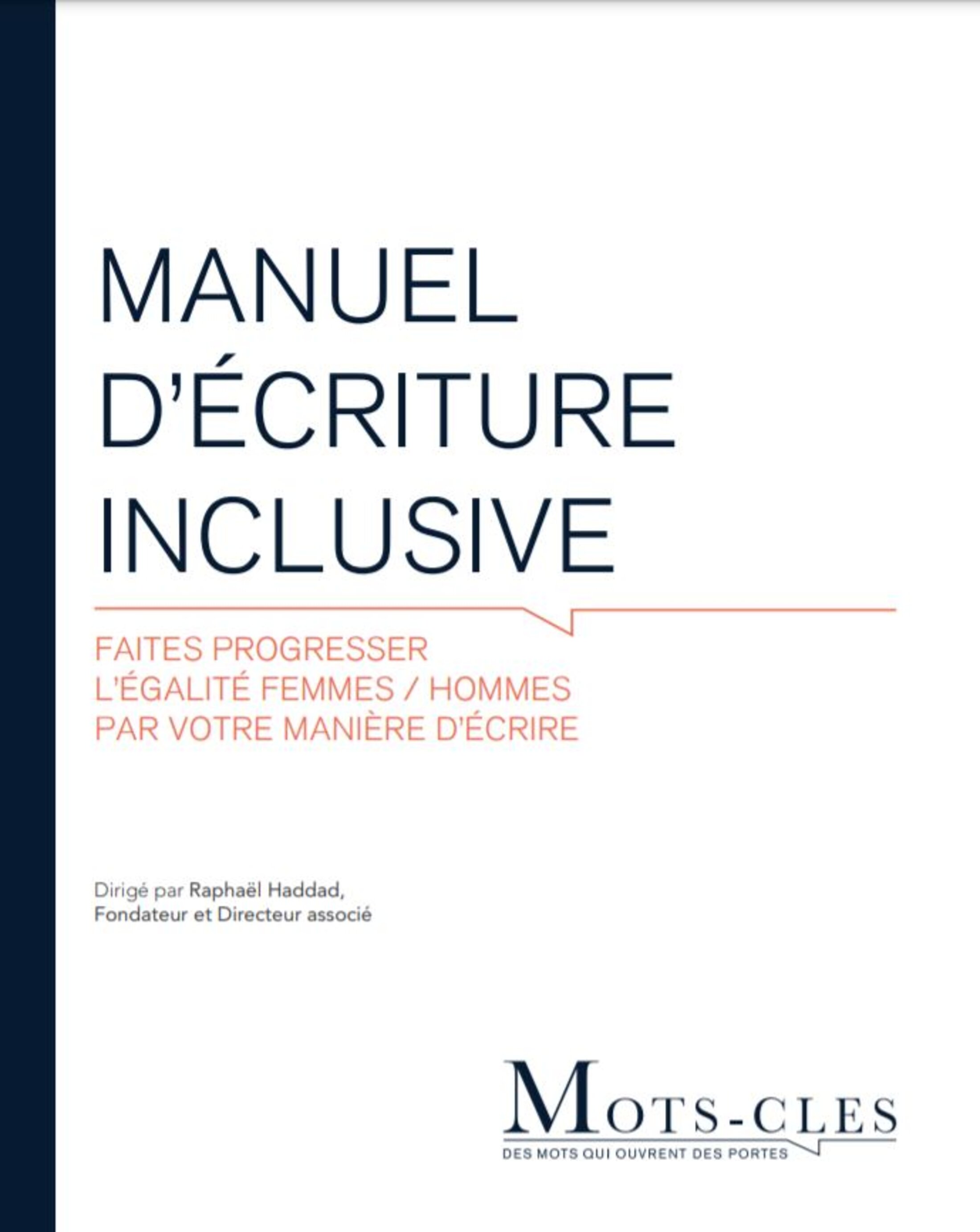Les premières fois que j’ai lu des textes utilisant l’écriture inclusive, ça m’a semblé suspect et franchement illisible. J’ai trouvé toutes les bonnes raisons pour la rejeter : inadéquation entre l’écrit et l’oral, manque de fluidité à cause de ces drôles de points médians disséminés dans les mots eux-mêmes comme des bestioles qui vous démangent, difficulté à développer à l’oral ce qui est condensé à l’écrit (« chacunˑe » se lisant « chacun et chacune » par exemple), et puis, quand même, la langue française, ce trésor-national-qui-rayonne-dans-le-monde-entier, nous n’allions pas l’abîmer, nous, les locuteurs français. Disons maintenant les locuteurˑriceˑs françaisˑeˑs. Ça ne me décoiffe plus parce que c’est passé dans l’usage. Oh, pas l’usage de toutes et tous (comme dirait le président de la république), mais le mien, celui du collectif LGBTQIA+ (oui, tout ça) aveyronnais que je fréquente depuis peu, celui de quelques lycéenˑneˑs qui sont assez grandˑeˑs pour ficher des points médians quand l’envie leur en prend, comme dans les copies (forcément) numériques que j’ai corrigées il y a quelques jours. Je concède que certaines d’entre elles comportaient des fautes de syntaxe et d’orthographe, mais il ne me revient pas de commenter sévèrement : « Tu auras le droit d’utiliser le point médian quand tu maîtriseras la subordination et le subjonctif ! », comme si l’écriture inclusive n’avait droit de cité qu’à condition que le reste soit parfait. L’usage, c’est celui des jeunes autant que celui des adultes, et ce n’est pas toujours le même. Il me semble que si les lycéenˑneˑs « violentent » (comme le dit le secrétaire perpétuel de l’académie française) la langue avec ces néo-points, c’est qu’ils y trouvent une forme de justesse dans l’expression, parce que cette nouvelle modalité inclusive correspond à la société dans laquelle ils et elles grandissent et deviennent adultes (encore une fois, je n’ai affaire qu’à des lycéenˑneˑs).
Cette semaine, mon lycée a été bloqué tous les jours car les candidatˑeˑs au baccalauréat refusent de passer les épreuves du mois de juin, préférant une évaluation dans le cadre du seul contrôle continu. Comme je proposais de travailler sur Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, que j’entamais une introduction sur la réception calamiteuse de la pièce par Nicolas Sarkozy en 2008 (il prétendait que ce n’était « pas normal de s’emmerder à la comédie française »), et que je poursuivais en évoquant la polémique sur La Princesse de Clèves, une des quatre élèves présentˑeˑs m’a fait remarquer qu’elle avait très rarement étudié des textes récents, tout aussi rarement des textes de femmes, et bon, Yourcenar, l’année dernière, c’était pas sa tasse de thé, et que, plus généralement, « à l’école, Monsieur, on a l’impression d’être en dehors du monde, est-ce que ce serait pas possible qu’on nous apprenne à comprendre la société dans laquelle on vit ? » J’ai rétorqué que, pour ce qui est de l’enseignement du théâtre cette année, l’équilibre est parfait : Molière et Mouawad. Elle a dit ok. Bon, deux hommes, ok. J’ai argumenté sur les autres disciplines : les sciences économiques et sociales qui ont une composante de sociologie, les sciences de la vies et de la terre, les sciences numériques… Ça l’a plus ou moins convaincue. De mon côté, j’ai reconnu que les programmes de français se sont patrimonialisés (tiens, mon correcteur d’orthographe ne souligne pas cet affreux participe) : programme officiel d’auteurˑriceˑs, c’est-à-dire dix auteurs et deux autrices, et pas un seul texte du XXIe siècle. La réforme du bac est claire sur ce point, en ce qui concerne la littérature : dans les classes, on étudie des classiques, on fabrique opiniâtrement la culture commune par les classiques. Ainsi, ma fille qui s’apprête à passer le bac français elle aussi étudie Les Fleurs du Mal comme je l’ai fait moi-même à son âge. Les générations d’élèves se suivent et continuent de voir les femmes à travers le regard masculin, ce male gaze (celui de Molière, de Mouawad, de Baudelaire, d’Apollinaire, de Stendhal, etc.). Et que de beautés, certes ! Et que de masculinité dans le regard, quand même. Les précieuses seront-elles ridicules jusqu’à la fin des temps pandémiques ? Pas sûr. La plupart ne le furent pas (Madame de Sévigné aurait dit : la plupart ne la furent pas, mes les académiciens ont fini par lui donner tort). La plupart des précieuses ne furent pas ridicules, mais Molière l’a emporté.
L’histoire littéraire est une construction. Notre panthéon masculin a fait quelques concession plus ou moins condescendantes à Louise Labé, Madame de Sévigné, Madame de Staël et quelques autres, mais tellement peu finalement qu’il faudra bien mettre au programme, dans les années qui viennent, des autrices injustement méconnues, puisque le programme national du « nouveau bac » impose un renouvellement périodique des œuvres. En 2024, Colette et Olympe de Gouges occuperont les deux sièges féminins (sur douze, toujours) du programme. Ce rapport de deux sur douze devrait permettre d’écouler le rayon féminin de la littérature française en une dizaine d’années, avant la prochaine réforme du bac qui desserrera peut-être l’étau en permettant aux enseignantˑeˑs de choisir les œuvres avec plus de latitude. Parions sur Marceline Desbordes-Valmore en 2025, George Sand, Marguerite Duras, Annie Ernaux, et peut-être notre siècle à partir de 2030 ou 2040. 2040, ce sera plus ou moins l’année de ma retraite : je ferais volontiers des extraits de Fille de Camille Laurens. Ce qui est touchy avec les textes contemporains, c’est que ça peut heurter, et ce n’est pas une question de point médian. Non, c’est par exemple le vocabulaire. Il y a quelques années, une mère d’élève a ainsi écrit à ma proviseure pour me dénoncer : elle avait ouvert Romance nerveuse de Camille Laurens, et, scandale, c’était ordurier. Elle tenait même à sa disposition les pages les plus choquantes du livre. Elle allait en informer l’inspecteur d’académie et demandait que je retire l’œuvre du programme de bac (à l’époque on avait le choix des œuvres, et, rassurez-vous, j’avais aussi choisi quelques classiques). Ma proviseure m’a transféré le mail sans commentaire, j’ai répondu à la mère le plus aimablement du monde et proposé que nous nous voyions pour en parler de vive voix. La rencontre s’est faite bien plus tard, à l’occasion d’une réunion parents-professeurs. Le sujet n’a pas été abordé finalement, le traumatisme était passé, nous avons parlé de projets d’orientation, de perspectives de poursuite d’études, de parcours de formation, etc., mais la petite sœur de mon élève, qui devait avoir quatre ou cinq ans, a vomi au beau milieu de l’entretien. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser que c’était le symptôme d’un gros malaise familial. En 2005, j’avais fait lire Peau d’Âne de Perrault puis Peau d’âne de Christine Angot à trois classes de première. Je me souviens qu’il y a eu, cette année-là, de belles réussites à l’oral. Si j’abordais ces textes-là par les temps hygiénistes et moralisateurs qui courent, j’ai l’impression que ce serait suspect : on me reprocherait d’être un « idéologue », c’est-à-dire un idéologue du grand méchant genre. Je reconnais que la réforme du baccalauréat nous permet de proposer aux élèves des lectures complémentaires en plus des marquisˑeˑs de la littérature. J’ai ainsi pu glisser Je suis un monstre qui vous parle de Paul B. Preciado dans une liste de textes sur l’altérité. Et, surprise, un élève a choisi d’en faire le sujet de son entretien oral. Il s’est bien défendu à l’oral blanc. Ça l’intéressait parce que c’est quelqu’un qui cherche des points de vue originaux et qui veut lui-même devenir scénariste. Il a fait des analyses pertinentes sur Montaigne et Apollinaire, mais son choix personnel de présenter le texte d’un philosophe trans a sans doute été l’occasion d’explorer d’autres voies expressives. Influence marquée du sceau de la théorie du genre ? L’idéologie, si l’on veut, est partout dans les programmes scolaires.

L’école a toujours un train ou plusieurs de retard sur l’état de la société. En 2021, c’est simple pour unˑe élève de seconde (quinze ans) de venir me voir à la fin d’un cours pour me dire : « Euh, Monsieur, est-ce que je peux vous parler ?... Alors en fait [avec un charmant accent anglais], je voulais vous demander si vous pouvez m’appeler K*… En fait je suis non-binaire, et voilà, tout le monde m’appelle K* dans la classe depuis deux mois… » Sans doute, les chienˑneˑs de garde de l’hétéronormativité penseront que cetˑte élève est victime de la « théorie du genre ». Il se trouve qu’iel utilise l’écriture inclusive dans les messages qu’iel m’envoie sur l’intranet du lycée (questions sur les cours, les horaires des classes virtuelles, envoi de copies numériques). Je prends bonne note de tout cela. Iel semble aller très bien dans ses baskets dépareillées. Iel a une vie sociale épanouie si j’en juge par ses fréquentations joyeuses dont j’ai un aperçu dans les couloirs du lycée ou la cour de récréation. Le reste ne me regarde pas. Je lui ai juste demandé si ses parents sont au courant et s’ils sont d’accord avec ce changement de prénom. Je lui ai dit, mais iel le savait déjà, que ce serait un prénom d’usage et non un prénom officiel, que l’administration du lycée ne ferait pas de modification sur son dossier scolaire. Iel le savait, et cela ne posait pas de problème. — Le pronom « iel », qui n’a pas encore fait l’objet d’une circulaire de l’éducation nationale, permet de ne pas déterminer le genre de la personne. Bien sûr, cela ne fonctionne qu’à condition d’éviter un adjectif ou un participe qui demande une détermination féminine ou masculine, ou alors il faut recourir au point médian : iel était tout à fait conscientˑe du fait que son coming out n’aurait pas d’incidence sur son état civil. Vous me direz que cela s’écrit, mais que cela ne se dit pas à voix haute. Et alors ? Vous connaissez beaucoup de personnes qui parlent comme elles écrivent ? Pardon : connaissez-vous beaucoup de personnes qui parlent comme elles écrivent ? Qui disent « je ne sais pas ce que non-binaire veut dire » plutôt que « j’sais pas c’que ça veut dire non-binaire » ? Je connais peu de personnes non-binaires adultes, mais ielles vont d’un genre grammatical à l’autre, avec une fluidité qui a de quoi déconcerter les cisgenres les plus équilibrés. Alors, pour ce qui est de l’énonciation non-binaire, faisons-en un jeu, amusons-nous avec les possibilités de la langue française, qui est bien élastique.
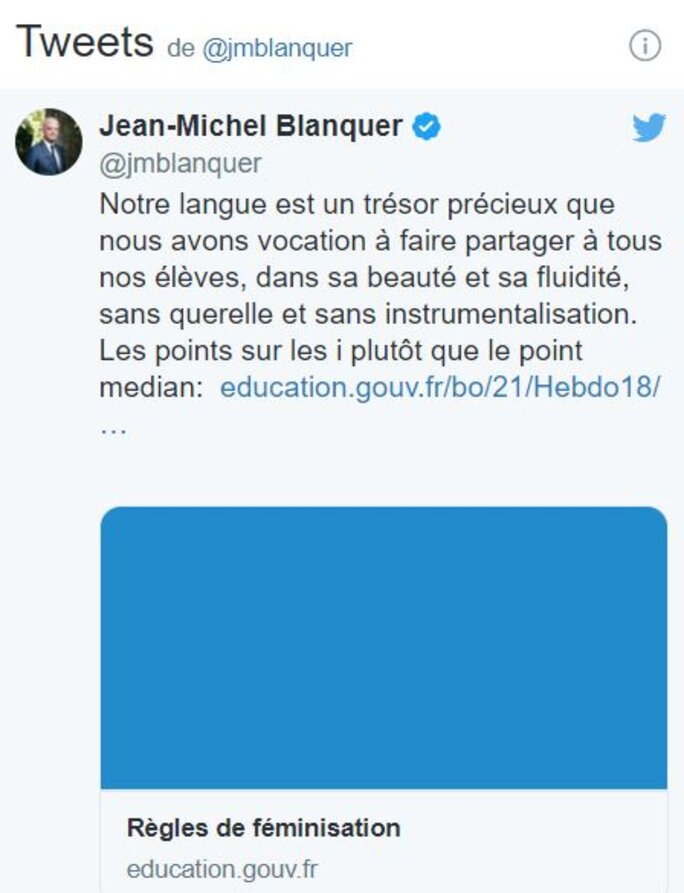
Le ministre de l’éducation nationale a voulu mettre les points sur les i plutôt que les points médians, ce qu’il affirme aujourd’hui dans un tweet qui se veut percutant. Mettre les points sur les i : c’est-à-dire mettre l’accent (on n’en sort pas, de ce complexe de la langue française) sur la correction de la langue plutôt que sur des raffinements jugés au mieux excentriques et inopportuns ; au pire symptomatiques d’une idéologie délétère poussant à l’indifférenciation des genres. Parce que le ministre, tout bescherellien qu’il soit, emploie ce vocable issu du gender américain dans la circulaire à laquelle renvoie son tweet persifleur : « Dans les actes et les usages administratifs, en vue de participer à la lutte contre les stéréotypes de genre, les dispositions de la circulaire du premier ministre du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française s’appliquent. » Je ne déroulerai pas l’argumentaire de rigueur pour contester les arguments de cette circulaire malvenue. D’autres, comme Éliane Viennot, le feront brillamment. Je ne peux pas m’empêcher cependant d’être fasciné par l’épigraphe de la circulaire. D’abord, une citation dans une circulaire, c’est une nouveauté (comme dirait Madame de Sévigné dans une lettre à sa fille : « Au reste, je mange mon petit potage de la main gauche, c’est une nouveauté. »). Mais Madame de Sévigné, qui n’était pas académicienne, avait la fâcheuse tendance à féminiser son propos, comme on l’a vu plus haut. Dans ses conférences, Éliane Viennot aime à citer cette anecdote rapportée par Gilles Ménage : « Madame de Sévigné s’informant de ma santé, je lui dis : – Madame, je suis enrhumé. – Je la suis aussi, me dit-elle. – Il me semble, Madame, que selon les règles de notre langue, il faudrait dire : je le suis. – Vous direz comme il vous plaira, ajouta-t-elle, mais pour moi je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement. » Hélène Carrère d’Encausse, qui ne semble guère en avoir, signe pourtant, avec toute la masculinité qui caractérise son idéologie linguistique, politique et sociale, l’épigraphe de la circulaire du 5 mai 2021 relative aux règles de féminisation dans les actes administratifs du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et les pratiques d’enseignement :
« Au moment où la lutte contre les discriminations sexistes implique des combats portant notamment sur les violences conjugales, les disparités salariales et les phénomènes de harcèlement, l’écriture inclusive, si elle semble participer de ce mouvement, est non seulement contre-productive pour cette cause même, mais nuisible à la pratique et à l’intelligibilité de la langue française. Une langue procède d’une combinaison séculaire de l’histoire et de la pratique, ce que Lévi-Strauss et Dumézil définissaient comme "un équilibre subtil né de l’usage". En prônant une réforme immédiate et totalisante de la graphie, les promoteurs de l’écriture inclusive violentent les rythmes d’évolution du langage selon une injonction brutale, arbitraire et non concertée, qui méconnaît l’écologie du verbe. »
Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française et Marc Lambron, directeur en exercice de l’Académie française, le 5 mai 2021.
L’usage vivra sa vie, et les jeunes des années 20 plus longtemps qu’elle et moi…
Allez, un petit effort... À moins qu’on préfère s'émouvoir avec Natacha Polony.
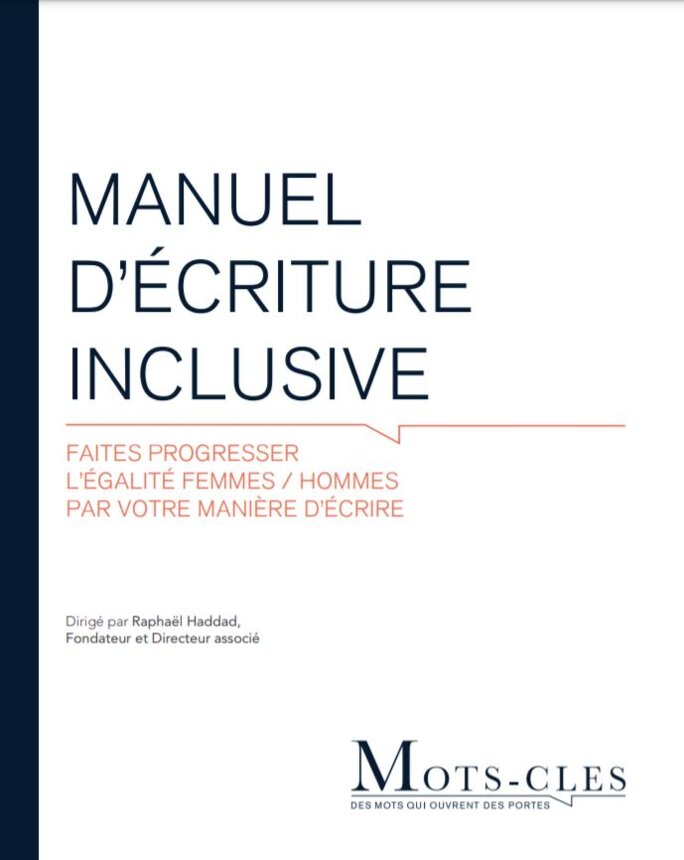
Agrandissement : Illustration 3