
Agrandissement : Illustration 1

« J’aime le murmure de la mer, mais j’aime aussi le silence[1] ». Ainsi commence et se termine « Familie » la première pièce de la « Trilogy of the private life » de Milo Rau qui se joue actuellement au théâtre national de la Colline à Paris, en alternance avec « Grief and beauty », sa dernière création et deuxième opus de la trilogie, dont le titre paradoxal tente de réconcilier la vie et la mort, l’une n’allant pas sans l’autre, à travers une dramaturgie du quotidien, affrontant tour à tour l’adieu, le deuil, la mémoire et l’oubli. Quelle place occupe la mort dans nos vies ? L’interrogation de l’auteur et metteur en scène en appelle une autre : Est-elle représentable sur la scène d’un théâtre ?
Fidèle à son manifeste en dix points édicté en 2018 lors de sa nomination à la tête du NTGent, explicitant les règles d’un « théâtre de ville du futur » comme il le nomme, qui entend rompre avec un théâtre qui peine à se renouveler. Le sien est documentaire et se veut en prise directe avec le monde. Rau l’envisage « tel un sport de combat », un théâtre au présent. Avec « Reprise, histoire(s) du théâtre (I) », pièce contemporaine du manifeste, Milo Rau posait la question du traitement par le théâtre d’un fait divers réel, le meurtre homophobe d’Ihsane Jarfi, en 2012. Éprouver la capacité du théâtre à appréhender le réel, en l’occurrence ici, à représenter l’extrême violence. L’ancien élève de Pierre Bourdieu et de Tzvetan Todorov est travaillé par la question de la violence dans la société, qu’il traite en déployant une esthétique de « reenactement » : rejouer l’histoire, l’écrire pour surtout la mettre en mouvement. « Les re-enactments de Rau ne relèvent pas de la réappropriation d’une mémoire qui viendrait nuancer voire contredire l’histoire[2] » expliquait déjà Éric Vautrin en 2013. « Il ne cherche pas non plus (du moins explicitement) à faire se percuter passé et présent, histoire et actualité, récit historique officiel écrit du point de vue des pouvoirs vainqueurs et espérances ou expériences vécues des gens du peuple (…) Il ne relève pas non plus d’une réflexion intellectuelle sur la banalité du mal à la façon d’une Hannah Arendt. ». Depuis ses débuts, Milo Rau n’a cessé de parfaire un théâtre politique.

Agrandissement : Illustration 2

Le chagrin et la beauté
La salle n’est pas encore remplie de ses spectateurs qu’une femme a déjà pris place sur l’écran géant qui surplombe la scène. Elle porte un pull rose, parait élégante, sereine. Quelques minutes plus tard, le public apprend qu’elle est décédée le 28 août dernier, au lendemain de son quatre-vingt-cinquième anniversaire, de sa propre volonté. La Belgique autorise le suicide assisté. « Grief and beauty » a été créée avec le consentement de toutes les personnes impliquées. Johanna est le point de départ de la pièce, la mort en direct comme toile de fond aux récits des comédiens, professionnels et amateurs comme toujours chez Milo Rau, ayant en commun une expérience de la douleur mais pouvant s’éprouver de manières différentes. Ainsi, Arne de Tremerie évoque la sclérose en plaques de sa mère, Staf Smans, le doyen de la distribution, raconte la mort coup sur coup de sa sœur, de sa mère et de sa fille. Quant à la princesse Isatu Hassan Bangura, née en Sierra Leone, elle aborde un autre type de douleur, celle de son exil et de ce qu’elle considère comme la perte de son « côté africain » comme elle le dit. Le paradoxe contenu dans le titre est terriblement humain : « être capable de penser l’infini, intellectuellement et émotionnellement, et pourtant être fini, être destiné à mourir[3] ». La pièce établit un lien entre les différentes formes de deuil, qu’il s’agisse de la disparition d’un proche, des espèces animales, des milieux de vie, des langages, de la mémoire et de l’existence individuelle. « Mon intention dans la Trilogie de la vie privée était d’atteindre un point zéro du dramatique, pour ainsi dire. Pour vaincre l’effet engourdissant du drame, du nombre élevé, de l’alarmisme permanent[4] » précise Rau.

Agrandissement : Illustration 3

« Que ferions-nous la dernière soirée ? »
Devant l’épais rideau qui barre la scène, deux chaises, un guéridon et sur celui-ci, une lampe qui éclaire un livre fermé. La jeune fille qui entre sur le plateau puis s’assoit sur l’une des chaises explique que ses parents lui ont demandé si, avec sa sœur cadette, elles aimeraient jouer une pièce de théâtre qui les réuniraient tous les quatre, en famille. Lou, qui a quitté la maison un an auparavant, avoue alors avoir eu des pensées suicidaires. Ainsi débute « Familie », le premier opus de la trilogie.
Au cours de l’été précédent, « J’ai commencé à penser très clairement : ‘Je ne veux plus vivre, ça n’a aucun sens’. C’était vraiment : ‘Si j’avais un pistolet maintenant, je me tirerais une balle’. Mais je n’avais pas de pistolet » confie Lou. Elle consigne ses pensées noires dans un journal intime que sa mère finit par trouver et lire. Elle a beaucoup parlé avec sa mère et sa grand-mère. En se documentant sur les suicides et les suicidés, elle découvre l’histoire de la famille Demeester. Le 27 septembre 2007, un couple et ses deux enfants étaient retrouvés pendus à la poutre de leur véranda, dans leur maison située allée des Frênes à Coulogne, petite ville en périphérie de Calais, avec pour seule explication, un mot sur lequel était écrit : « On a trop déconné. Pardon ». Lou rassemble alors tout ce qu’elle peut trouver sur cette affaire, s’interroge sur la raison de leur acte. Comment cette famille en apparence heureuse, sans souci d’argent ni de maladie a-t-elle pu commettre un tel geste, aujourd’hui encore inexpliqué ? Elle demande à Léonce, sa sœur cadette s’il est approprié de porter cette histoire sur scène. Elle lui répond que oui. Et comme ses parents voulaient à tout prix faire quelque chose avec elles, tous commencent à se documenter. « C’était une famille comme la nôtre. Derrière la maison, il y a des champs… et un peu plus loin la mer » confie Lou.

Agrandissement : Illustration 4

Le rideau se lève enfin sur la façade sur jardin d’une maison cossue, là où se trouve la salle de bain, la vaste cuisine et une chambre. Le public passera toute la durée de la représentation dans ce jardin, ne franchissant le seuil de la maison que par procuration, à la faveur du grand écran installé au-dessus de la scène et sur lequel sont retransmises les images d’une caméra filmant en direct au plus près de l’intimité de cette famille vivant sa dernière journée. Au plus près et à distance donc, à l’image de ce dernier repas qui se passe en fond de scène, dos au public, et que la caméra va révéler. Grâce à ce dispositif, ce filtre filmique qu’il place entre les spectateurs et la pièce, Milo Rau évite de se montrer trop frontal, du moins pour l’instant. Entre les deux familles, la mise en abîme est implacable, effrayante, au point de confondre réalité et fiction, d’identifier les interprètes aux victimes. Lou rappelle que la police n’a rien trouvé de suspect. Tout était rangé. C’était une soirée ordinaire mais c’était la dernière. Le récit peut enfin commencer.
Très vite, ce qui frappe ici, c’est la froideur, la rigidité de cette famille bourgeoise. Aucune effusion ou presque. Beaucoup de pudeur et de retenue sont interrompus par de rares moments venant rappeler que les membres de cette famille sont humains malgré tout. Ce sont les larmes qui coulent le long des joues de Léonce, tout juste âgée de quatorze ans, alors qu’elle continue de réviser son anglais jusqu’à l’absurde. D’abord incompréhensible, le geste devient évident. Tant que la jeune fille a le nez rivé dans son cahier d’exercice, qu’elle apprend, elle est du côté de la vie. C’est la raison pour laquelle elle ne se départit que très tard de son cahier. Elle le conserve même à table, lorsque vient l’heure du dernier souper. C’est aussi le coup de fil d’Ann, la mère, à ses parents, l’une des rares fois où elle se laisse submerger par ses émotions, même si elle essaie de les étouffer. Ann Miller, actrice de profession, joue le rôle d’une femme si parfaite, si égale, qu’elle incarne à merveille cette catégorie bourgeoise se tenant sur le fil de la bienséance alors qu’elle est au bord de l’implosion.

Agrandissement : Illustration 5

C’est cette même bourgeoisie que l’on retrouve dans le cinéma de l’autrichien Michael Haneke dont le parallèle avec son premier film, « le septième continent » (1989) apparait pertinent tant il narre une situation similaire à la pièce. L’utilisation que fait Milo Rau de la vidéo en direct, tout comme le générique de début et de fin, font le lien entre les deux. Le souvenir d'un voyage en Autriche en serait un autre, à la fois clin d'oeil à Haneke et au théâtre de Thomas Bernhard. « Le septième continent » est découpé en trois parties correspondant à trois journées distinctes piochées dans les trois dernières années d’un couple et de leur enfant jusqu’à leur suicide, sans donner de réponse à leur geste[5]. Le réalisateur laisse le soin aux spectateurs de déduire eux-mêmes les causes. Un même calme angoissant règne sur les deux œuvres. Si, chez Haneke, la famille détruit la totalité de ses possessions avant de disparaitre, chez Rau au contraire, tout est impeccablement rangé, les restes du dernier repas étant consciencieusement conservés dans des boites hermétiques déposées dans le réfrigérateur. Avant de passer à l’acte, on sort les poubelles. À la démonstration de fin de vie par la destruction chez Haneke, notamment la mort des poissons, métaphore préfigurant celle de l’enfant, correspond l’ordinaire de la vie chez Rau. Rien ne laisse présager dans leur comportement qu’ils vivent leur dernier jour.

Agrandissement : Illustration 6

Quelques incidents à peine notables viennent cependant troubler l’apparente quiétude de cette famille modèle. Deux sont le fait d'An, la mère. Elle évoque un fait divers lu dans le journal du jour : une jeune fille de quatorze ans – soit le même âge que Léonce – renversée par une voiture. « Morte sur le coup » précise Lou qui avait aussi lu l’information sur l’accident. « Elle était dans la rue et tout à coup, une voiture.... Et, smash, comme un chat. Hit and run » dit-elle encore. Filip l’interroge sur qui conduisait, An répond : « Des Nord-Africains, dit-on ». La violence mais aussi la peur contenue ici s’effacent à la phrase suivante, lorsqu’An se remémore une course de cross à l’école maternelle à laquelle participait Léonce. À la fin de la pièce, lorsqu’est venu le temps de partir, elle aura une violente altercation avec ses filles, comme si toute la violence contenue jusqu’alors sortait enfin.
Chez Milo Rau, c’est « cette obstination à retenir les détails qui est dramatique », commente encore Eric Vautrin. « C’est elle, bien davantage que les faits rapportés et pour scandaleux qu’ils soient, qui provoque une forme de stupeur, premier temps d’une réflexion, non seulement sur l’événement présenté et ses mémoires, mais davantage sur la confuse postmodernité elle-même[6] ». Ainsi la pièce ira jusqu’au bout, montrera tout. Des parents installant les cordes jusqu’à l’acte de pendaison lui-même : quatre corps inertes suspendus dans le vide. Rien ne sera épargné au spectateur. L’effroi vient ici du parallèle parfait dressé entre les deux familles, brillant et troublant à la fois, dérangeant. « Le cou des parents était brisé, mais les enfants s’étaient étouffés » confie Lou avant de s’adresser au public : « Même si on choisit de mourir, le corps s’y opposera ».

Agrandissement : Illustration 7

« La Reprise », « Five Easy Pieces[7] » et « Familie » composent une série sur les crimes contemporains. « Pour les autres pièces, j’ai travaillé avec des enfants, et avec des non-professionnels. Cette fois, je voulais que ce soit avec une famille[8] » confie le metteur en scène. S’il existe hélas de nombreux crimes de famille, ceux-ci sont souvent motivés par la passion, les féminicides notamment – une partie importante des suicides d’hommes faisant suite au décès de leur femme – ou l’argent. « Il y a là-dedans quelque chose d’existentiel, de mystique presque, qui m’a beaucoup intéressé[9] ». explique Milo Rau en évoquant l’affaire Demeester. « Cela nous a amenés à nous demander, les acteurs et moi, non seulement pourquoi ces personnes ont fait ça, mais aussi comment leur dernière soirée à eux, cette famille d’acteurs, se serait passée ».
Au-delà du fait divers, il s’agissait de représenter la banalité de la vie. Le choix de faire jouer sur scène une famille entière se justifie par l’intimité qui existe entre ses membres : « il y a des millions de petits gestes, une sorte de vérité de comportement, des relations qui n’existent que dans une vraie famille ». Tout est vrai dans ce que les acteurs racontent de leur propre vie. La réalité se mêle alors à la fiction de façon inextricable pour mieux interroger la construction de la cellule familiale aujourd’hui, miroir d’une société occidentale en crise selon Milo Rau[10]. Si des pistes sont esquissées, aucune réponse ne viendra justifier le passage à l’acte. Milo Rau met en scène une pièce matérialiste pour mieux interroger le sens de la vie. « Il n’y a peut-être pas de raison de vivre, c’est la vie à elle seule qui constitue la raison, même si parfois, ce n’est peut-être pas une raison suffisante[11] ».
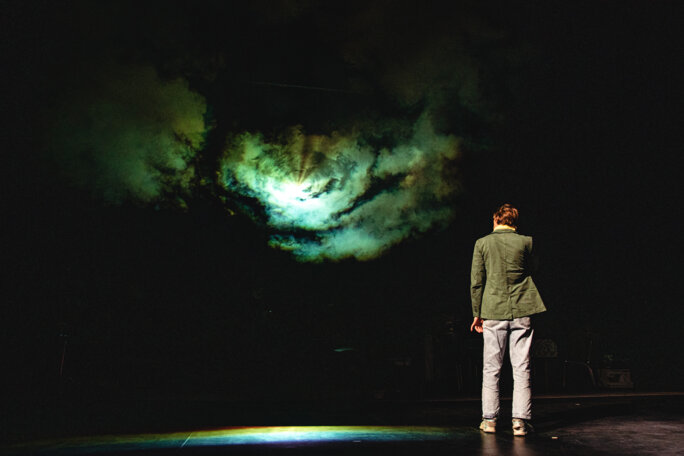
Agrandissement : Illustration 8
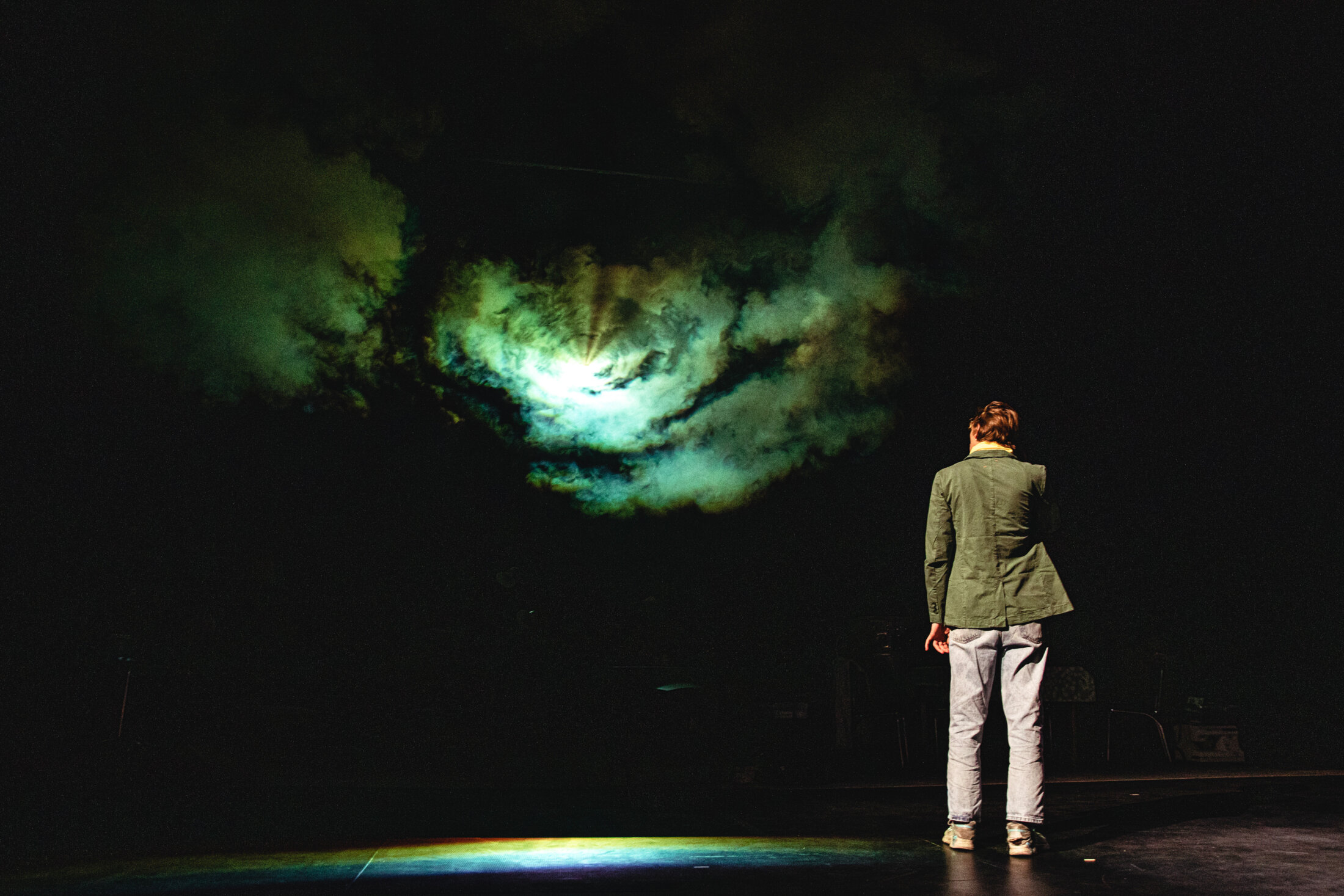
[1] La pièce étant jouée en néerlandais, il s’agit ici de la transcription française utilisée par le metteur en scène pour surtitrer les représentations lorsqu’elles sont jouées dans un théâtre francophone.
[2] Éric Vautrin, « Pouvoir et postmodernité dans le théâtre naturaliste de Milo Rau et de l’International Institute of Political Murder », Double jeu [En ligne], 10 | 2013, mis en ligne le 10 juillet 2018, consulté le 20 novembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/doublejeu/593 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/doublejeu.593
[3] Tenter de partager l’indicible. Entretien avec Milo Rau, propos recueillis par Carmen Hornbostel, reproduit dans le livret du spectacle.
[4] Ibid.
[5] Serge Toubiana, Le Septième Continent. Entretien avec Michael Haneke, 2005. https://www.youtube.com/watch?v=VaAbH9Wnelg Consulté le 7 février 2023.
[6] Éric Vautrin, op. cit.
[7] Pièce dans laquelle des enfants retraversent la vie de Marc Dutroux, interrogeant sur la limite de ce que les enfants savent, ressentent et fond, et nous plaçant devant nos propres tabous.
[8] Messe noire pour la vie. Entretien avec Milo Rau, propos recueillis par Pascaline Vallée, juin 2020, reproduit dans le livret de la pièce.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.

Agrandissement : Illustration 9

GRIEF AND BEAUTY - Spectacle en néerlandais surtitré en français et en anglais, présenté en alternance avec Familie, premier volet de la Trilogy of Private Life (Trilogie de la vie privée) • durée 1h35, texte et mise en scène Milo Rau, avec Arne de Tremerie, Anne Deyglat, Princess Isatu Hassan Bangura, Staf Smans et Johanna B. à l’écran, dramaturgie Carmen Hornbostel, collaboration à la dramaturgie et coach Peter Synaeve, caméra Moritz Von Dungern, musique live Clémence Clarysse, composition Elia Rédiger, décor Barbara Vandendriessche, lumières Dennis Diels, assistanat à la mise en scène Katelijne Laevens, production NTGent, coproduction Tandem – Scène nationale Arras-Douai, Künstlerhaus Mousonturm, Romaeuropa Festival. Grief and Beauty a été créé en septembre 2021 au NTGent.
Du 19 janvier au 5 février,
FAMILIE - Spectacle en néerlandais surtitré en français et en anglais, présenté en alternance avec Grief and Beauty, deuxième volet de la Trilogy of Private Life (Trilogie de la vie privée) • durée 1h30, équipe artistique : conception et mise en scène Milo Rau avec An Miller, Filip Peeters, Leonce Peeters, Louisa Peeters, dramaturgie Carmen Hornbostel, décors Anton Lukas, costumes Anton Lukas, Louisa Peeters, vidéo Moritz von Dungern, arrangements musicaux Saskia Venegas Aernouts, lumières Dennis Diels, production NTGent coproduction Romaeuropa Festival, Künstlerhaus Mousonturm – Francfort, Schauspiel Stuttgart, Théâtre de Liège, Scène nationale d’Albi, coréalisation Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national, Festival d’Automne à Paris. Spectacle conseillé à partir de 16 ans, sans avertissement, certaines scènes peuvent heurter les plus jeunes. Familie a été créé en janvier 2020 au NTGent.
Du 28 janvier au 19 février,
La Colline - Théâtre National
15, rue Malte Brun 75 020 Paris



