
Agrandissement : Illustration 1

Le comédien Emmanuel Matte fait le récit intime d’un fragment de vie ordinaire jusqu’à son basculement et le passage à l’acte qui s'en suit. Face au public, il raconte son métier de vigile dans un centre commercial. Il explique comment, grâce à la caméra fixe, on peut zoomer sur n’importe quoi, n’importe qui, et ainsi surveiller, punir, confondre les voleurs.
Avec l’expérience, « c’est au regard qu’on les reconnait[1] » dit-il, à ce mélange de détermination et de misère qui se lit dans leurs yeux. Pas de compassion. Il est là pour faire son métier. D’autant plus qu’il y a les primes aux interventions et qu’il aime faire plaisir à ses enfants. Avec ses deux collègues, il dispose de « la liste », un document recensant, avec leur nom et leur photographie, les personnes interdites d’établissement. « C’est pas parce qu’on est pauvre qu’on a pas le droit d’être honnêtes » lance-t-il.
Aziz et Mohammed partagent son quotidien professionnel, formant l’équipe de gardiennage du « Centre ». Aziz a cinquante-cinq ans et sera bientôt à la retraite. Chaque jour, il prend un peu de temps pour rédiger des notes en vue de la création d’un syndicat au « Centre ». Mohammed, que tous appellent Moha, sera l’un des premiers à occuper les ronds-points, à porter un gilet jaune qu’il troque lorsqu’il arrive au Centre « à l’entrée contre le blouson de service ». Il sera aussi le principal suspect dans les accusations de vols à répétition opérés dans le « Centre ». « Je suis le seul Babtou comme disent les gars ». Face à la baisse du pouvoir d’achat qui vide de ses clients ce temple de la consommation low coast, les vigiles s’ennuient.

Agrandissement : Illustration 2

« Une colère familière »
« Avant les ecchymoses sur l’avenir », faire partie du plus grand nombre était l’objectif. Il explique : les « comme moi » – ainsi nomme-t-il ceux qui appartiennent à la même classe sociale que lui –, ne prennent pas souvent la parole, ne répondent presque pas non plus. « Je n’ai jamais été quelqu’un qui dérange ». Les « comme moi » préfèrent à la colère la tempérance, restent mesurés, passent leurs vacances au bord de mer « alignés comme des tombes », trop heureux de se tenir sur le bon côté du monde. Le week-end, il se rend en famille dans le centre commercial « des bourges ». Les loisirs et le temps libre leur ont fait croire qu’ils étaient vivants. Il aime rouler. Ce temps passé dans sa bagnole est le seul qui lui appartienne vraiment. Ce matin, au rond-point, il y avait un nouvel attroupement. Comme hier, ils portaient tous leur gilet jaune. Ce n’était donc pas un accident comme il l’avait supposé. Sa « moitié », comme il l’appelle, rentre plus tard que lui de l’abattoir dans lequel elle travaille.
Aujourd’hui pourtant, elle est déjà là. Même si elle dit que tout va bien, au fond de lui, il sait que ce n’est pas le cas. Il a vu passer l’article annonçant les difficultés de l’entreprise dans le journal. Dès le lendemain, elle occupe avec d’autres l’établissement en cessation de paiement qui sera bientôt liquidé et, avec lui, l’ensemble du personnel. L’équarisseuse ne fera plus disparaitre les traces de la mort, en tout cas plus ici. L’équilibre financier de la famille était tendu, il sera précaire. La veille, il avait demandé à sa fille ce qu’elle voulait faire plus tard. « Chômeuse » avait répondu ironiquement son frère pour la chambrer.
L’avenir s’obscurcit pour devenir incertain lorsqu’il apprend le lendemain que tous les occupants de l’usine ont été arrêtés après l’assaut des forces de l’ordre et déférés devant un juge en comparution immédiate. Le pire est à venir. Aziz lui annonce que tous ont pris six mois ferme. Le vertige ne cesse d’augmenter au fur et à mesure que son univers s’écroule. Le son monte en même temps que la voix, ça scande, ça érupte, l’intensité devient brûlante : « Je pense avenir, vacances, enfants, salaires, dettes, crédits, spirale, je pense noyer les enfants, congeler leurs restes, je pense nous tirer avec le fusil de chasse, je pense suicide, meurtre, je pense avocat, argent, prison, je pense Balkany, Guéant, Sarkozy, Cahuzac, Benalla, je pense grande délinquance, je pense délinquance en col blanc, je pense Didier Lombard, Bolloré, Mulliez, Arnault, je pense patrons. Je chauffe ».
Dans un monde à l’agonie, les « comme lui » sont asphyxiés en premier. Conditionnés par la fabrique de la honte, ils ont appris à ne pas dépasser les limites de leur rang social : le narrateur n’est « pas quelqu’un qui dérange ». Il refuse toute circonstance atténuante aux précaires ayant commis une infraction. « Les comme moi n’ont pas le privilège du regard » dit-il. Le licenciement de sa femme est, pour lui, le déclencheur d’une prise de conscience des inégalités sociales, son point de bascule. Désormais rien ne sera comme avant. Il n’a plus peur. Le récit du réel prendra des allures de conte fantastique servant de métaphore au déni du narrateur. Le coupable n’est pas celui que l’on croit. La trajectoire intime conduit à une métamorphose plus kafkaïenne qu’ovidienne.

Agrandissement : Illustration 3

« Ceux qui désormais n’ont plus peur »
Accompagné sur scène par le musicien et compositeur Valentin Durup, le comédien Emmanuel Matte campe, face au public, celui qui bascule. La scénographie minimale répond au souhait de Guillaume Cayet de conserver une forme souple et mobile permettant de jouer dans tout type d’espace, qu’il s’agisse des salles de spectacles ou de lieux non théâtraux, poursuivant ainsi le travail de démocratisation du spectacle vivant entrepris avec « Neuf mouvements pour une cavale », monologue itinérant autour de Jérôme Laronze, l’un des précédents spectacles de la compagnie Le Désordre des choses qu’il crée en 2014 avec la comédienne et metteuse en scène Aurélia Lüscher.
La pièce est construite sur une alternance entre les chapitres qui découpent le récit principal racontant l’histoire intime du narrateur et de sa famille, et des mémorandums que Guillaume Cayet place immédiatement après chacun d’entre eux. À cet intime ordinaire, parfois trivial, aux hésitations finalement très humaines que contient le récit principal, répond la poétique urbaine de son pendant universel contenue dans les mémorandums, scandée par la conscience sociale du monde. Ces textes puissants galvanisent par leur rythme.
Il n’y a pas d’incertitude ici : c’est par l’affirmation qu’est dénoncée la manipulation. Les loisirs et le temps libre donnent l’illusion de se sentir vivants. De la même façon, la musique, omniprésente, cadence le spectacle, le met en tension, traduit l’urgence de la situation. Le comédien parle, slamme, rappe, autant de changements de rythmes qui donnent la mesure du désenchantement, de la détresse, de la colère. Il s’agit ici de prendre conscience des effets de la violence capitaliste.
Avec cette pièce, le dramaturge signe sa première mise en scène comme s’il y avait une nécessité absolue à porter personnellement ce texte brûlant qui fait monter sur scène ceux qui en sont traditionnellement interdits, faisant entendre le grondement de la colère sociale, l’actualité dramatique des grandes manifestations populaires qui ont occupé les ronds-points de l’Hexagone et ponctué de manifestations déclinées en actes chaque samedi de la vie politique française de novembre 2018 à novembre 2021. Cet élan est conduit par ceux que l’on nomme les « Gilets jaunes ».
À la différence des mouvements de contestation classique qui sont initiés par les organisations syndicales, celui-ci est spontané, lancé depuis Internet et les réseaux sociaux. « À la base il y a un mouvement. Un double mouvement. Social et intime. Il y a mon envie de parler de ce mouvement qui a dépassé, voire débordé une bonne partie de ce que la "gauche" pensait encore possible en matière de mouvement social[2] » explique Guillaume Cayet dans sa note d’intention. « Il y a ce mouvement des sans-parts, des sans-représentations. Peut-être aussi ce mouvement des classes moyennes et des délaissé·e·s. Ce mouvement dans lequel j’y reconnais mes voisin·ne·s, mes camarades d’école, ma famille ». De septembre 2019 à février 2020, un mouvement de contestation contre la réforme des retraites[3]est initié par les syndicats professionnels, les étudiants et lycéens.

Agrandissement : Illustration 4

Le pouvoir en place a très vite diabolisé ces mouvements pour mieux les réprimer dans le sang en s’appuyant sur les forces de l’ordre détentrices d’une violence de moins en moins légitime. Le gouvernement, relayé au-delà de ses espérances par les chaines d’information en continu où triomphe la pensée d’extrême-droite, est aussi soutenu par les classes aisées de la capitale, terrorisées à l’idée d’un déferlement de la plèbe sous leurs fenêtres. Le 17 novembre 2018, lors de la première manifestation parisienne des Gilet Jaunes, la peur panique qui s’empare de la bourgeoisie n’a d’égal que son dégoût pour le peuple qu’elle ne connait pas. Ce sont les « affreux, sales et méchants » du film éponyme[4] d’Ettore Scola contre lesquels Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, s’insurge début 2020 sur le plateau de l’émission « C’est à vous[5] » sur France 5, en voyant lors d’une manifestation une représentation de la tête du Président au bout d’une pique. Cette image est « pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable (…) Ce n’est pas admissible » éructe-t-il la voix chargée de mépris, poursuivant : « derrière le symbole, il y a la pulsion ». Il fulmine enfin : « Rien n’excuse ce degré de violence, non pas physique encore mais verbal. Rien ». Des violences policières exercées à l’encontre des Gilets jaunes, Badinter ne dira pas un mot. Pourtant, en trois ans de conflit social, on déplore dix-sept morts et deux-mille-quatre-cents blessés dont vingt-trois éborgnés et cinq amputés. L’embarrassant silence de Robert Badinter, si prompt à condamner avec véhémence la violence symbolique d’une image, à propos des violences policières sur les manifestants, celles qui tuent, mutilent, en dit long sur la violence sociale, sourde et diffuse, qu’exerce la classe dominante sur le reste de la population.
Guillaume Cayet compose un théâtre résolument démocratique au service des sans voix, dont la radicalité n’est que la réponse modérée à l’expression d’une violence officielle inouïe qui culpabilise dans les discours, détruit dans les lois et mutile dans la rue. Dans une langue puissante proche de la tragédie antique, « Grès (tentative de sédimentation) », drame social, se fait conte fantastique pour évoquer très justement le déni national. Comment expliquer sinon par l’inconscient ce refus de voir la réalité ?
L’histoire a montré hélas que c’est quand cette vérité touche directement les intérêts des individus que ces derniers comprennent enfin les inégalités avec lesquelles ils s’arrangeaient jusque-là. « C’est quand les comme moi ont commencé à comprendre. Que la violence n’était pas une anomalie. Mais le fondement même de notre système. Qu’on a dépassé la disparition du déclic ». Un peu plus tôt, cet « Œdipe sans royaume » avait prophétisé : « Bientôt la Zone ne sera plus que le vestige d’une époque révolue ».
[1] Les citations sont extraites de Guillaume Cayet, Grès (Tentative de sédimentation), Éditions Théâtrales, Lisière, Montreuil, 2022, 72 pp.
[2] Guillaume Cayet, « L’histoire d’une transformation », dossier de presse Grès (Tentative de sédimentation), SD.
[3] « Ces deux mouvements ont été fortement marqués par un usage intensif de la violence par les forces de l’ordre qui occasionnèrent dès les premières manifestations de nombreuses blessures et mutilations parmi les manifestants, par une très forte médiatisation de ces violences dont les images circulèrent énormément sur les réseaux sociaux, ainsi que par l’éclatement de multiples affaires de violences graves (Affaire Bénala1, Violences du Burger King2, Affaire Geneviève Legay3...) qui installèrent durablement la question des violences policières dans l'environnement politique et médiatique français ». Voir « Enquête sur les victimes de violences policières en manifestation », Rapport 2019-20, Observatoire national des Street-medics et secouristes volontaires, mars 2022, https://obs-medics.org/wp-content/uploads/2022/04/Enquete-sur-les-Victimes-de-Violences-Policieres-en-Manifestation-Observatoire-des-Street-medics-2019-2020.pdf Consulté le 8 juillet 2022.
[4] Affreux, sales et méchants (Brutti, sporchi e cattivi) est un film italien d’Ettore Scola, sorti en 1976, qui raconte la vie quotidienne d'une famille italienne du quart-monde, originaire des Pouilles, dans un bidonville de Rome au début des années 1970. Le film devait débuter par une préface écrite et lue par Pier Paolo Pasolini, qui comptait y décrire la transformation du sous-prolétariat au contact de la société de consommation. Mais l’auteur fut assassiné avant de l’ avoir écrit.
[5] Robert Badinter invité spécial de C’est dans l’air, France 5, 28 janvier 2020, https://www.youtube.com/watch?v=8c4d6TM1lBg Consulté le 7 juillet2022.
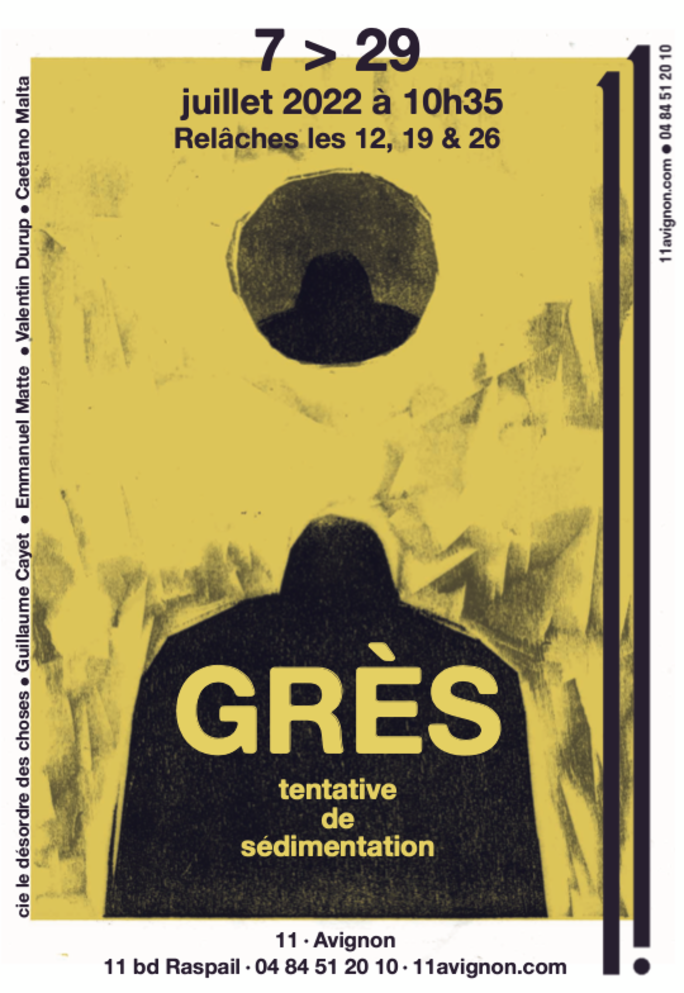
Agrandissement : Illustration 6
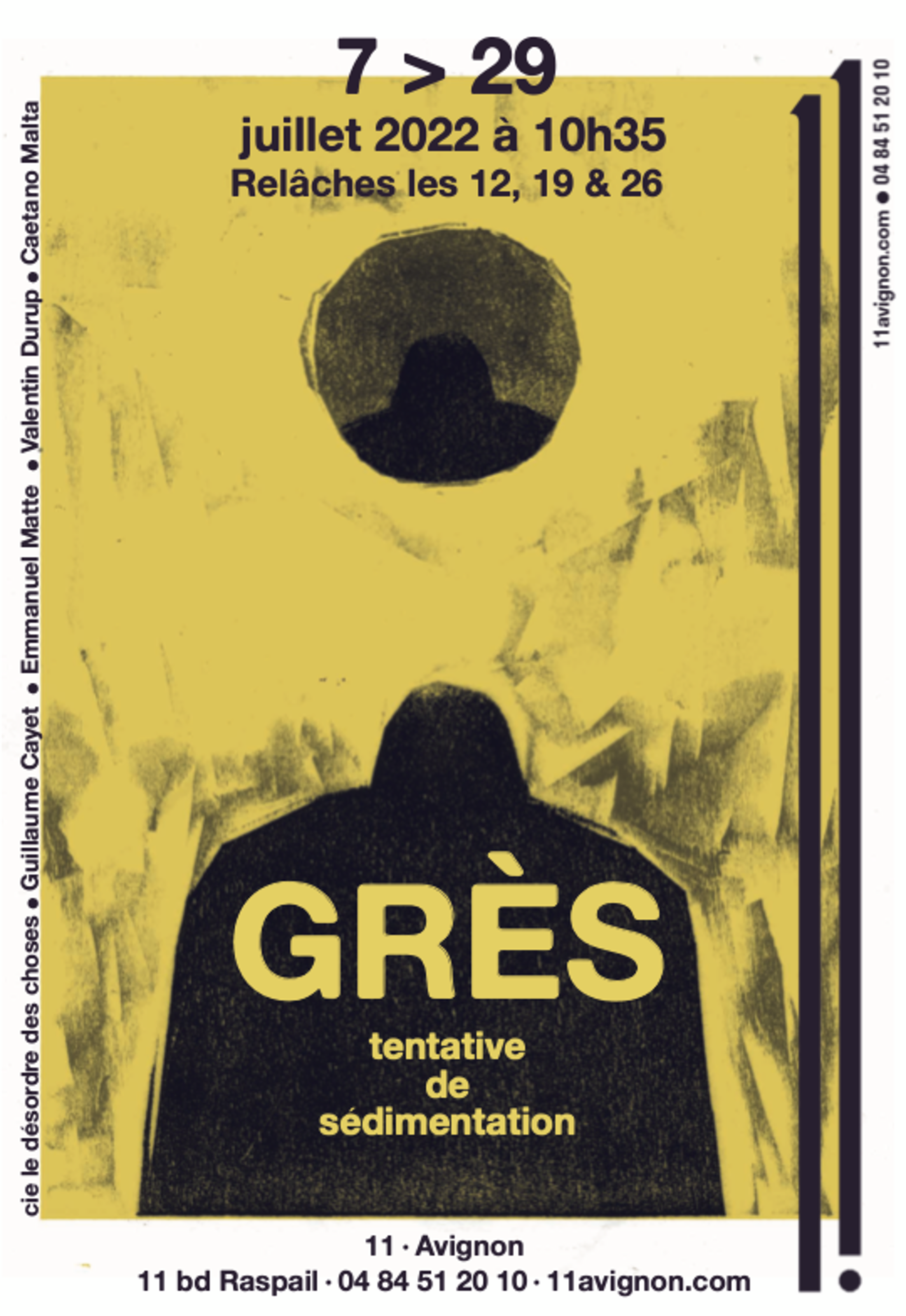
GRÈS (TENTATIVE DE SÉDIMENTATION), écriture et mise en scène Guillaume Cayet, jeu Emmanuel Matte, musique live Valentin Durup, scénographie Salma Bordes, création lumières Juliette Romens, création vidéo Antoine Briot, costumes Cécile Box, régie Clémentine Gaud, production le désordre des choses, coproductions La Comédie de Clermont-Ferrand - scène nationale, La Ferme du Bonheur - Nanterre, Théâtre de Privas - scène conventionnée art et territoire, Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies Contemporaines - Paris, La 2deuche - espace culturel de Lempdes - scène régionale Auvergne Rhône-Alpes. Spectacle créé le 2 octobre 2021 à La Passerelle (Pont-de-Menat) dans le cadre de la tournée décentralisée de la Comédie de Clermont-Ferrand - scène nationale, en coréalisation avec la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge, vu le 19 novembre 2021 à Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies Contemporaines - Paris.
Du 7 au 29 juillet 2022 à 10h35. Relâche les 12, 19 et 26 juillet.
11 . Avignon
11, boulevard Raspail
84 000 Avignon



