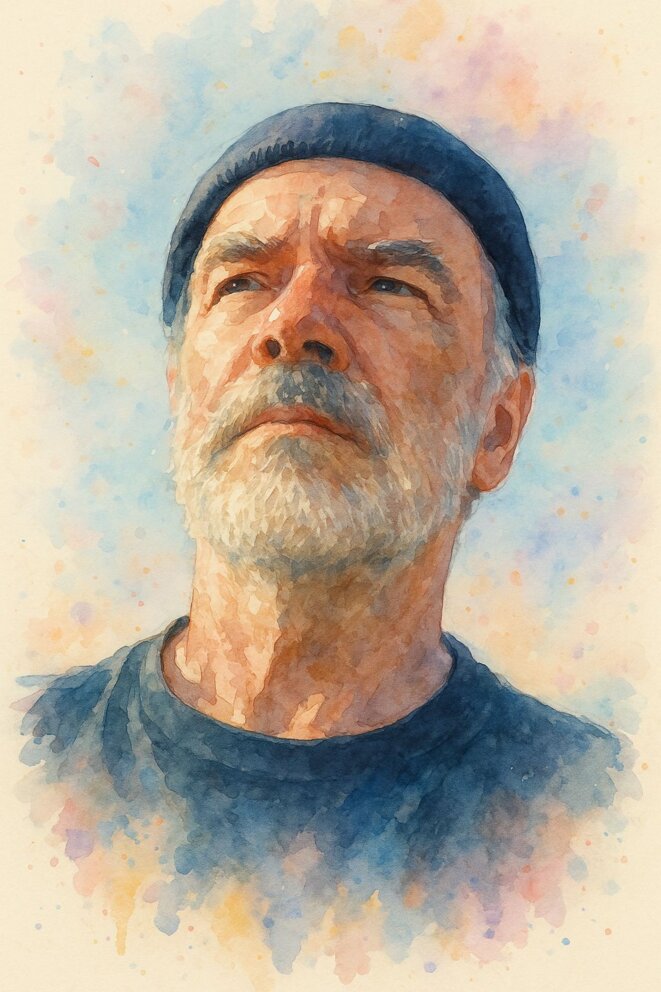Il y a cette odeur de terre mouillée. J’avance dans le flot, ou plutôt je glisse à côté, invisible. Je suis là sans y être, parmi eux, ces silhouettes aux foulards relevés, aux pancartes trempées, aux yeux qui piquent à cause du gaz. Ils ne me voient pas, et pourtant parfois j’ai l’impression qu’ils sentent ma présence. Un frisson dans l’air, une main qui se frotte le bras, une respiration plus courte. Ils pensent au vent, au froid, mais c’est moi, Rémy Fraisse.
Je n’ai plus de corps, mais la mémoire du corps. Je me souviens de cette vibration particulière, celle du sol quand les grenades tombent, ce grondement qui passe de la terre au ventre. Je l’ai connu avant de m’éteindre. Je ne pensais pas qu’on pouvait mourir d’un bruit. Pourtant c’est ce bruit-là, une déflagration et un trou dans mon dos qui m’arracha à moi-même. Une grenade F1, offensive que l'on utilisait durant la première guerre mondiale. C'est ma mort qui l'a faite interdire. C'est bien ma seule victoire posthume. Depuis, j’erre entre les cortèges, d’une plaine à une autre, d’une saison à la suivante. Au milieu d'autres grenades toujours chargées de TNT.
Aujourd’hui, à Sainte-Soline, ils marchent pour la même raison qu’alors : l’eau. On la stocke, on la détourne, on la privatise même sans scrupule. Je me demande d’où vient cette manie qu’ont les hommes d’enfermer ce qui coule.
Je flotte au-dessus des rangs, j’écoute. Les tambours résonnent un peu en retard sur les slogans. Il y a des drapeaux roses, bleus, jaunes. Une fille marche pieds nus dans la boue. Son regard passe à travers moi sans me trouver, mais il y a quelque chose dans ses pupilles, cette même flamme que j’avais, un mélange de peur et d’obstination. Elle ne sait pas qu’elle me ressemble.
Au loin, les gendarmes s’alignent, lourds dans leurs carapaces. Je les entends avant de les voir, les radios qui grésillent, les ordres qui tombent, les voix tendues où percent des rires nerveux. Puis cette phrase qui tombe comme une pierre :
— Faut leur tirer dans la gueule !
Et là, tout se fige. Même le vent. Même les corbeaux. Il n’y a plus qu’une rumeur en suspension. Ils vont tirer. Ils le savent. Je ne veux pas y croire, mais je sais que c’est la haine habituelle. La haine légitimée par l’uniforme et les mots qui les ont préparés à ça. Quand un ministre dit « adversaire », « éco-terroristes », « woke » assez de fois, le visage s’efface. On ne voit pas des gens, on ne voit plus que des cibles mouvantes, des ombres à viser.
Je traverse la ligne. J’aurais voulu leur parler, moi qui suis pourtant mort à cause d’eux, ou de ce qu’ils représentent. Mais ils n’entendront rien, et moi je n’ai plus de voix. Alors je reste là, dans la poussière, à regarder la scène se rejouer encore et encore. Le passé ne s’arrête jamais quand la justice se tait. Pour moi mes assassins courent encore. Peut être dans leurs rangs.
Autour, les manifestants reculent, puis reviennent, puis reculent encore. Certains ramassent les grenades avant qu’elles n’éclatent, les renvoient comme des balles de feu.
Le ciel se brouille, les lacrymos font pleurer. Il y a des cris, des « soignez-le », des « on n’a plus d’eau », des « ça va passer ». Tout se mélange, comme dans un cauchemar où les mots perdent leur sens.
Je reconnais la sensation, ce mélange d’adrénaline et de douceur. La douceur, oui, celle de se savoir du bon côté même au milieu du chaos. Ils ne veulent pas la guerre, ils veulent un peu de respect pour la terre. Mais le pouvoir a les oreilles bouchées par le dogmatisme ou saturées par le bruit des lobbies.
Je passe près d’un groupe à genoux autour d’un blessé. Ils sont trois, peut-être quatre, penchés sur lui comme autour d’un feu qu’il faut sauver. Une fille garde la main plaquée sur la plaie, paume blanche, doigts tremblants. Son visage est gris de gaz, son foulard taché de sang. À côté, un gars cherche du sérum dans un sac à moitié ouvert, les mains sales, les yeux agrandis par la peur. Personne ne parle, ou si peu, seulement ces mots mécaniques de premiers secours appris à la hâte : « Respire, garde les yeux ouverts, ça va aller. »
Le sol colle, visqueux, une pâte de sang et de terre qui s’épaissit sous leurs genoux. L’odeur est comme un mélange d’humain et rage. Et au-dessus, ça continue.
Les tirs, secs, rapides, précis. Pas des tirs de défense, non. Des tirs de chasse. Les grenades partent à l’horizontale, sifflent, cognent. On entend le métal ricocher sur les pancartes. Encore et encore, comme une pluie horizontale.
De l’autre côté, derrière la ligne, j’entends les voix. On dirait des voix d’hommes ivres.
« Touché dans les couilles », éclat de rire.
« En pleine tête, celui-là », encore un.
Les mots claquent plus fort que les grenades. Ils résonnent comme une victoire de terrain, une chasse à l’homme qui s’assume enfin. Et dans ce vacarme, je distingue des rires francs, presque joyeux. L’euphorie d’avoir frappé juste.
Des soudards, rien que des soudards fiers de leur métier. Ce n’est plus le maintien de l’ordre, c’est un jeu vidéo à ciel ouvert, une salle d’arcade dans la boue. Sauf qu’ici, les pixels saignent.
Je voudrais crier, leur dire d’arrêter, mais ma voix n’a plus de corps. Alors je regarde. Je tremble. Pas de peur, non, de rage contenue, de dégoût qui me traverse sans trouver de sortie. Mes tremblements ne font pas de bruit. Ils passent dans la pluie, dans la terre, dans le vent. Peut-être qu’ils atteignent leurs bottes, qu’ils sentent quelque chose sous leurs semelles, un tremblement venu du dessous, de nous, les morts.
Je me souviens de cette phrase que j’ai entendue autrefois, juste avant que tout s’éteigne : « On ne tire pas sur les gens, on disperse. » Mensonge. On tire. On vise. On commente la trajectoire. On rit.
Je regarde la fille toujours agenouillée. Elle pleure sans s’arrêter de presser la plaie. Les larmes se mêlent au sang, au gaz, à la pluie. Autour d’elle, tout s’effondre lentement, les cris, les appels radio, les ordres d’avancer, le brouillard qui monte.
Les gendarmes se rapprochent, silhouettes noires, visières brillantes. Leur bottes font un bruit lourd dans la boue. Ils tirent encore, à dix mètres, à cinq. La ligne de tir est basse, calculée. Un gradé gueule :
« Allez, faut les pousser ! »
Pousser quoi ? Des corps déjà à terre ? Des vivants déjà à moitié morts ?
Je vois les doigts de la fille glisser. Le sang coule plus vite maintenant, plus clair, plus mince. Elle s’acharne comme on s’accroche à la vie d’un inconnu qu’on ne reverra jamais. Le type qu’elle soigne ne dit plus rien. Ses yeux cherchent un point fixe au ciel, un bout de lumière. Il ne trouvera que la fumée.
Et derrière, toujours les voix : « C’est bon, celui-là est calmé », rire gras.
« On ne va pas s’arrêter là », rire plus fort encore.
Rire de sinistres pandours.
C’est ça, la guerre sans nom, des rires dans les micros, des ordres noyés dans le gaz, des hommes qui oublient qu’ils tirent sur d’autres hommes pour ne défendre qu’un chantier inutile comme à Sivens.
Rien n’a changé.
Le ciel s’ouvre d’un coup, la pluie tombe, dilue tout, les gaz, le sang, les injures.
La nuit tombe. Les champs se vident. Ne restent que les bâches déchirées, les mégots mouillés, les rubans de banderoles.
Des hommes et des femmes se souviendront longtemps. Ils seront "mille et cent", peut être danseront ils sur cette valse de Ciac boum en levant le poing :
La terre boit l’eau de pluie et ce qu’elle mélange avec elle. Je me demande si un jour elle rendra tout ce qu’on lui enfouit : les blessures, les noms, les raisons pour lesquelles on revient marcher.