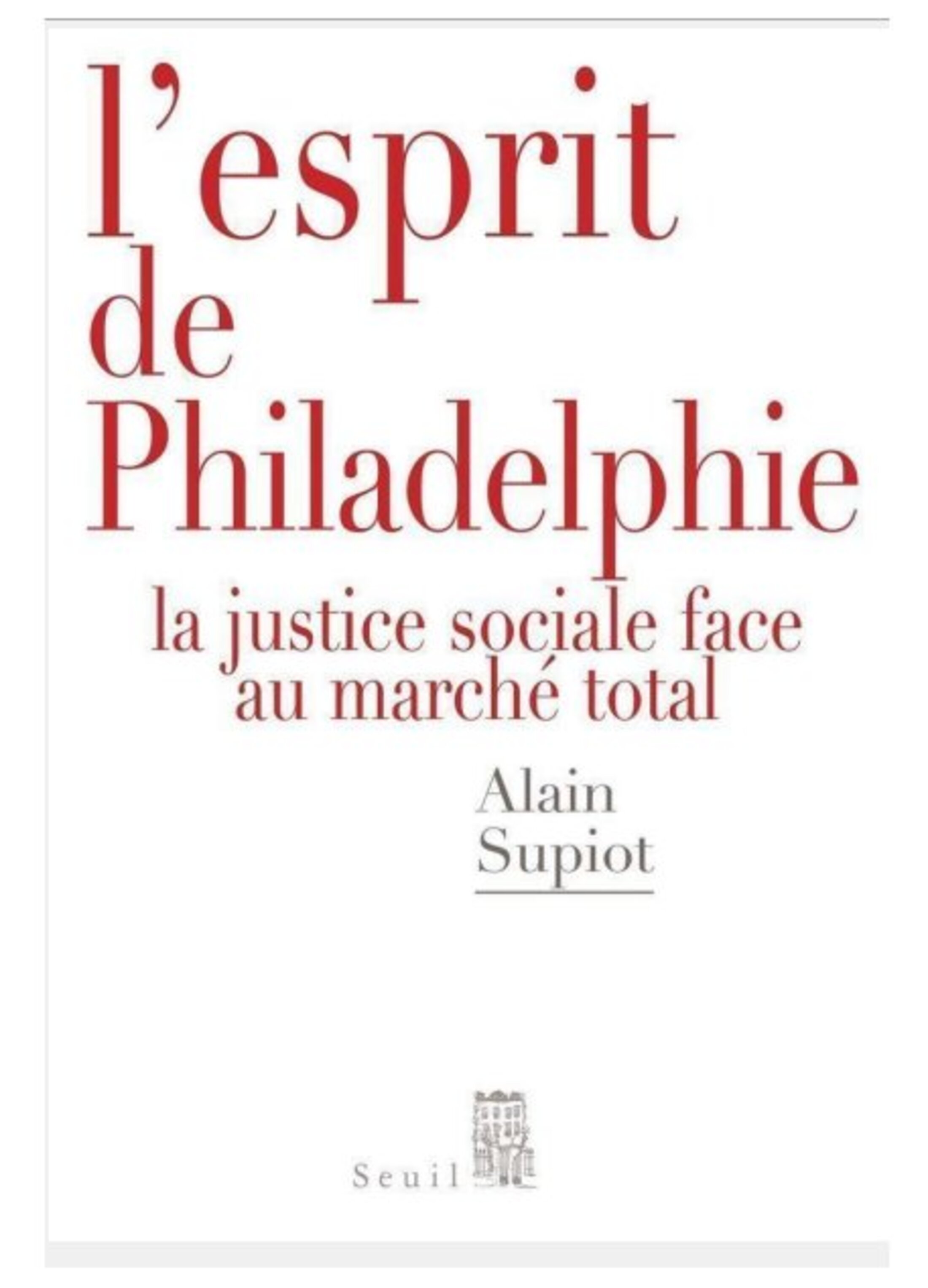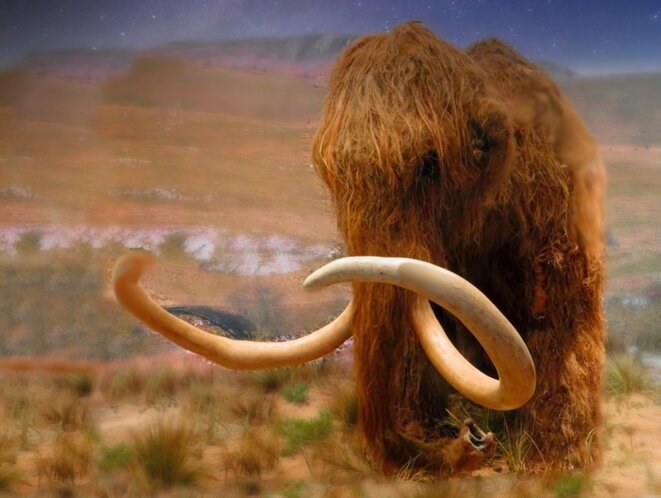Contexte et intention de l’ouvrage
Alain Supiot, juriste et professeur au Collège de France, propose dans ce livre une réflexion sur l’avenir du droit, du travail et de la justice sociale dans un monde dominé par la logique marchande et financière. Le titre renvoie à la Déclaration de Philadelphie (1944), adoptée par l’Organisation internationale du travail (OIT), qui affirmait que « le travail n’est pas une marchandise » et que la paix universelle ne pouvait se fonder que sur la justice sociale. Supiot y voit une inspiration pour repenser nos institutions après la crise financière de 2008.
- La Déclaration de Philadelphie comme boussole
- En 1944, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration de Philadelphie affirmait la primauté de la dignité humaine sur la logique marchande.
- Elle insistait sur le fait que les règles économiques doivent être subordonnées à la justice sociale.
- Cette idée inspira la construction des États sociaux (Sécurité sociale, droit du travail, régulation internationale).
Supiot rappelle que cet « esprit » s’est peu à peu effacé au profit d’une domination des marchés financiers et d’une logique de compétition généralisée.
- L’érosion du modèle social d’après-guerre
- Après 1945, l’État-providence et les institutions internationales (ONU, OIT, FMI, Banque mondiale) visaient à encadrer le capitalisme et à éviter les déséquilibres qui avaient mené à la guerre.
- Mais à partir des années 1980, avec la mondialisation néolibérale, s’est imposée une idéologie du « marché total », où toute activité humaine est soumise à la logique concurrentielle.
- La justice sociale est alors reléguée au second plan : les droits sociaux sont perçus comme des entraves à la compétitivité.
- Le « marché total » et ses impasses
- L’utopie du marché total consiste à croire que les lois de l’offre et de la demande peuvent réguler à elles seules la vie sociale.
- Elle produit une « gouvernance par les nombres » : indicateurs, classements, objectifs chiffrés deviennent des instruments de pouvoir, au détriment du débat politique.
- Supiot montre que cette logique engendre des crises : financières (2008), écologiques, sociales (précarisation du travail, montée des inégalités).
- L’importance du droit et des institutions
- Pour Supiot, le droit n’est pas seulement un outil technique, mais une institution symbolique qui permet de donner un cadre à la vie commune.
- Abandonner la régulation juridique au profit des seuls mécanismes de marché revient à laisser la société sans repères collectifs.
- « L’esprit de Philadelphie » rappelle que la justice sociale n’est pas une option, mais une condition de stabilité politique et économique.
- L’actualité de l’esprit de Philadelphie
- Face aux crises contemporaines (économique, écologique, géopolitique), Supiot plaide pour retrouver une hiérarchie claire : l’économie doit être au service des êtres humains, et non l’inverse.
- Cela implique :
- de réaffirmer que le travail ne peut être réduit à une marchandise,
- de repenser les solidarités à l’échelle mondiale,
- de reconstruire des institutions internationales capables de faire primer la justice sociale.
- Une critique du néolibéralisme
- Supiot critique la croyance selon laquelle la liberté économique suffirait à assurer la prospérité générale.
- Il montre que cette logique produit en réalité des fractures sociales (exclusion, chômage, inégalités massives) et nourrit les tensions politiques.
- Loin de pacifier le monde, la mondialisation dérégulée peut conduire à de nouvelles formes de violence.
- Vers une refondation
- Pour Supiot, renouer avec l’esprit de Philadelphie, c’est renouer avec une vision humaniste et universelle du droit.
- Cela suppose :
- de penser l’économie dans le cadre de limites écologiques,
- de renforcer les protections sociales,
- de bâtir des règles internationales contraignantes en matière de travail et de droits humains,
- d’abandonner l’illusion d’un marché autorégulé et sans frontières.
Conclusion
L’esprit de Philadelphie est un appel à redonner sens et primauté à la justice sociale face à la domination des logiques marchandes et financières. Supiot y rappelle que les sociétés ne peuvent se fonder sur le seul calcul économique : elles ont besoin de droit, d’institutions et de solidarité pour durer. Comme en 1944, il faut aujourd’hui penser un nouvel ordre international capable d’assurer dignité et sécurité à tous.

Agrandissement : Illustration 1