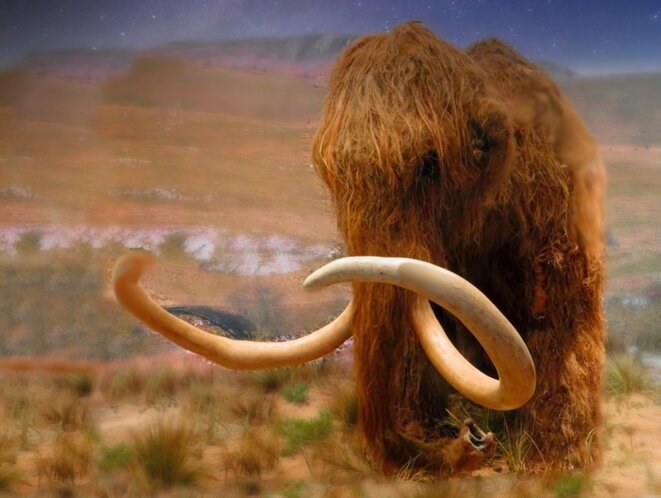Car c’est la troisième fois en un peu plus d’un an que le chef de l’État refuse de reconnaître le résultat des élections législatives de 2024, remportées par la gauche unie sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP).
Trois fois que le verdict des urnes est ignoré, contourné, renvoyé aux oubliettes d’un pouvoir devenu imperméable à la volonté populaire.
Il est tentant d’y voir une simple manœuvre de palais, une stratégie d’appareil destinée à “stabiliser le pays”.
Mais les mots doivent garder leur poids : ce n’est pas un ajustement, c’est une flétrissure démocratique.
Comme l’écrivait Montesquieu, « il n’est point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et sous les couleurs de la justice. »
Et c’est bien à cette ombre-là que la France s’habitue.
L’ironie d’un tweet oublié
Il y a dix ans, en décembre 2015, le même Lecornu écrivait sur Twitter :
« Dans les autres démocraties, quand on a été battu, on ne revient pas. C’est une exception française, et ce n’est pas une bonne exception. »
Ce jeune homme, alors plein de convictions, dénonçait avec vigueur la tendance du Parti socialiste à s’accrocher au pouvoir malgré ses défaites électorales.
L’élan démocratique était sincère, presque émouvant.
Mais dix ans plus tard, ce même Lecornu, face à la défaite de son propre camp, a préféré le silence à la cohérence.
Au lieu de rappeler le principe qu’il prônait jadis, il a accepté le poste de Premier ministre qu’un président affaibli, mais déterminé à ne pas céder, lui offrait sur un plateau.
La continuité autoritaire
Cette nomination n’est pas un épiphénomène. Elle s’inscrit dans une dérive plus profonde : celle d’un pouvoir exécutif qui s’auto-reproduit, se justifie, s’impose.
George Orwell prévenait déjà : « Le pouvoir n’est pas un moyen, il est une fin. »
Et le macronisme tardif semble lui donner raison.
Chaque épisode de cette séquence politique — dissolution surprise, refus d’alternance, mise à l’écart du Parlement — renforce l’idée que la légitimité démocratique n’est plus qu’un décor.
Il ne s’agit plus d’un désaccord politique, mais d’une mutation du régime.
L’État de droit survit encore, les institutions fonctionnent en apparence, les procédures sont respectées — mais la substance démocratique s’est vidée.
Comme le notait Hannah Arendt, « le mensonge politique devient non plus un outil, mais une nécessité de gouvernement. »
L’érosion lente du consentement
Les dictatures ne s’imposent jamais d’un seul coup. Elles s’installent par couches successives de résignation.
D’abord un président qui “temporise” la transition.
Puis un ministre qui “accepte” pour “la stabilité”.
Enfin, un peuple qui “comprend”, puis qui se tait.
Et c’est ainsi que la démocratie, peu à peu, devient une façade tranquille derrière laquelle se recompose l’autorité nue.
Lecornu à Matignon, c’est moins une nomination qu’un symptôme.
Celui d’une République où la victoire électorale n’ouvre plus les portes du pouvoir, où la légitimité ne vient plus des urnes mais de la confiance présidentielle.
Celui d’un pays où l’on préfère la continuité du commandement à l’alternance politique — ce qui revient, selon les mots de Tocqueville, à “faire mourir la liberté par la peur du désordre”.
Le vertige du silence
Faut-il alors s’étonner que la colère monte, que le doute gagne ?
Les démocraties meurent rarement sous le fracas d’un coup d’État ; elles s’éteignent dans le murmure des justifications.
Et lorsque le pouvoir prétend incarner seul la raison, la stabilité, la continuité — alors le peuple cesse d’y croire.
Bertolt Brecht l’avait écrit dans un vers resté célèbre :
« Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde. »
La formule résonne aujourd’hui avec une inquiétante actualité.
Car c’est bien du ventre de nos renoncements, de nos silences et de nos “accommodements raisonnables”, que peut renaître ce que nous pensions impossible :
une France sans démocratie véritable berceau du fascisme.