Le Premier Août, jour de « fête nationale » en Suisse, est devenu très problématique en plus d’être conservateur, parce que prétexte à des manipulations malsaines. Alors qu’il est le fruit d’une « invention de la tradition » attribuant à tort une origine médiévale mythique à un pays né au XIXe siècle qui ne saurait se comprendre aujourd’hui sans examiner l’histoire de son affirmation comme État fédéral moderne, le thème légendaire de la lutte contre le pouvoir de juges étrangers ne relève plus seulement du folklore et d’un patriotisme bon-enfant. Un parti gouvernemental d’extrême-droite (ce qui, en Suisse, malheureusement, n’est pas un oxymore), curieusement intitulé « démocratique » et du « centre » en français, manipule en effet ce concept pour remettre en cause les engagements de la Suisse dans la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH). Ce qui est une affaire sérieuse dans le monde troublé qui est le nôtre.
Quand elle a été déposée, le 12 août 2016, cette nouvelle initiative de l’UDC d’extrême-droite, initiative intitulée « contre les juges étrangers », dont le contenu confirme justement la transformation effective de l’ancien parti national agrarien conservateur en un parti d’extrême-droite ayant rompu avec les principes fondamentaux de respect des droits humains, a immédiatement, et heureusement, été dénoncée dans un appel solennel émanant de la société civile (http://appel-urgent.ch/) :
« Abolir les droits humains ?
Jamais !
L’initiative de l’UDC contre les « juges étrangers » prévoit la possibilité de dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme. Elle met ainsi en cause des acquis et des principes du vivre ensemble établis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
L’initiative contre les droits humains de l’UDC cherche, sous prétexte « d’autodétermination », à supprimer une protection internationale efficace contre l’arbitraire. Elle menace l’État de droit en Suisse et voudrait faire reculer la démocratie dans le pays. L’initiative de l’UDC contre les droits humains ne doit passer en aucun cas ! Contribuez à son rejet ! »
Auparavant, un autre appel soutenu par une centaine d’organisations et des milliers de citoyens avait déjà affirmé l’importance pour la Suisse et l’Europe de la CEDH (http://www.facteurdeprotection-d.ch/) :
« La CEDH définit un cadre minimal en matière de droits humains. Ce dernier repose sur un consensus de la communauté européenne des valeurs. La CEDH protège donc les droits fondamentaux de tous les individus en Europe. La CEDH a beaucoup contribué à l’émergence, après la Seconde Guerre mondiale, d’une Europe qui privilégie l’État de droit, la démocratie et le progrès économique et social. »
Facteur de protection D - Les droits humains nous protègent est une campagne salutaire qui publie des portraits de citoyens et citoyennes vivant en Suisse qui ont pu faire valoir des droits bafoués en recourant à la CEDH. En voici trois exemples :
Surveillé par son assurance suite à un grave accident, et ce sans base légale
Ce dernier cas concerne le journaliste Daniel Monnat dont un film documentaire réalisé dans le cadre de la Télévision suisse romande sur la grave affaire des fonds en déshérence et de l’attitude des autorités et élites économiques suisses vis-à-vis du national-socialisme au cours de la Seconde Guerre mondiale avait été attaqué parce que trop critique aux yeux de ses censeurs, et interdit de rediffusion. Aujourd’hui, c’est bien entendu l’UDC qui reste en première ligne pour remettre en cause les acquis de connaissance et de capacité de discernement sur cette période de l’histoire qui ont été notamment rendus possibles par les travaux de la Commission internationale d’experts Suisse-Seconde Guerre mondiale, présidée par Jean-François Bergier et dont le rapport a été remis en 2002. Occultations, silences, brouillages et récits unilatéralement complaisants, loin de toute réalité scientifique et de tout examen nuancé du passé, y compris de ses aspects problématiques, voilà ce que l’extrême-droite et un quarteron d’ultra-conservateurs voudraient imposer à la société helvétique.
C’est donc dans ce contexte peu réjouissant que l’extrême-droite gouvernementale UDC exploite à fond la mythologie du Premier Août au service de ses obsessions contre les « juges étrangers », comme dans cet appel publié sur son site. C’est donc aussi dans ce contexte que le Premier Août est devenu une journée particulièrement problématique en plus d’être conservatrice.

Agrandissement : Illustration 1

Pourtant, en 1957, le grand écrivain Max Frisch s’était exprimé dans un discours du Premier Août, en jouissant d’une pleine liberté d’expression [1]. Il affirmait que la Suisse avait peur et ironisait sur les regards portés de l’extérieur sur la Suisse : une paysanne des Balkans qui pensait qu’il ne s’y trouvait pas de prisons ; des touristes américains qui voyaient les Suisses ramper « devant le dollar » ; cet Anglais de la RAF interné qui plaisantait : « - Les Suisses travaillent six jours d’affilée à la victoire de Hitler, et le septième, ils prient pour la victoire de la liberté »; mais il « avait été lui-même abattu par un excellent canon mitrailleur produit par Oerlikon-Suisse ». Max Frisch disait aimer « la Suisse telle qu’elle est », mais que cela ne devait pas aller sans critique. Il voulait parler du pays et pas de la patrie, parce que « la patrie est pour moi quelque chose qui commence à l’arsenal et se termine au cimetière militaire. » « Entendons-nous le passé ou le présent ? », s’exclamait-il. Lui, il préférait penser « à l’avenir : à une Suisse qui ne soit plus dominée par les spéculateurs et dans laquelle les syndicats soient un peu plus qu’une amicale fatiguée de petits-bourgeois replets ». Il jouait aussi magnifiquement sur les mots. Le travailleur, Arbeitnehmer, « ne prend (nehmen) pas du tout le travail, il l’effectue » ; l’employeur, Arbeitgeber, « ne donne (geben) pas le travail, mais le prend parce qu’il en a besoin, et le paye ». Tout cela a été dit en 1957. Mais, plus de 50 ans plus tard, n’avons-nous pas toujours besoin, peut-être de plus en plus besoin, de réfléchir aux mots que nous utilisons, en relisant Orwell, Kraus et Klemperer ? N’avons-nous pas besoin de prendre un peu plus au sérieux le sens de ce que nous commémorons ou pas ?
Un projet de calendrier civil en Italie
Un petit livre collectif récemment publié en Italie [2] peut en tout cas nous aider à y réfléchir. Dirigé par le grand historien de l’oralité et de la subalternité Alessandro Portelli, il est constitué de 22 chapitres, 22 dates dans l’année qui marquent un événement significatif et dont le sens pour aujourd’hui nous est brièvement présenté par un historien ou une historienne qui l’a étudié.
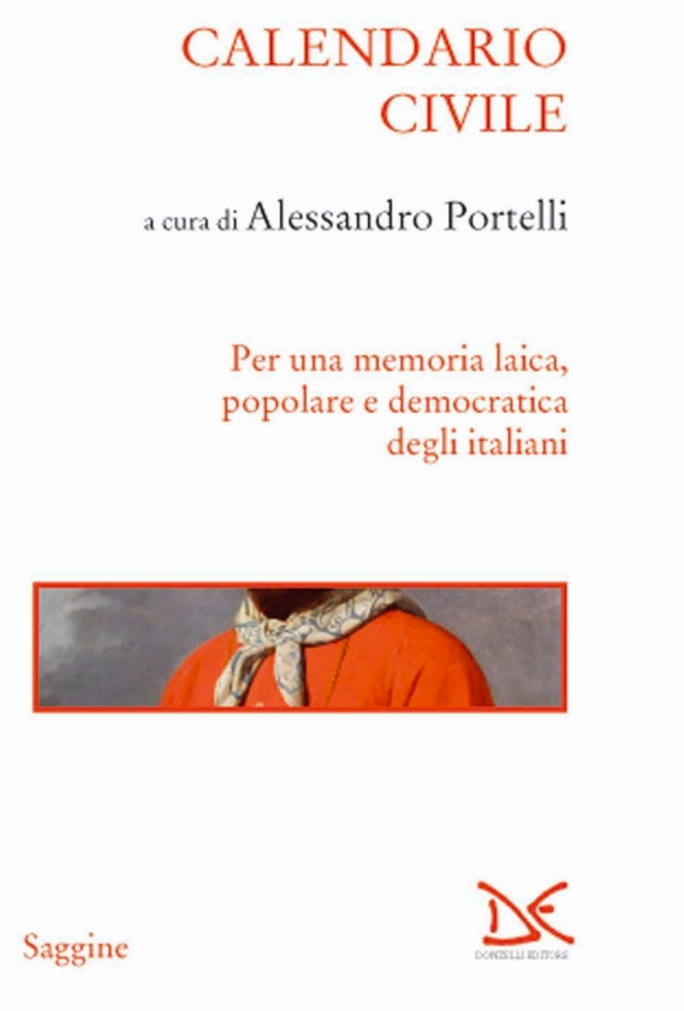
Agrandissement : Illustration 2
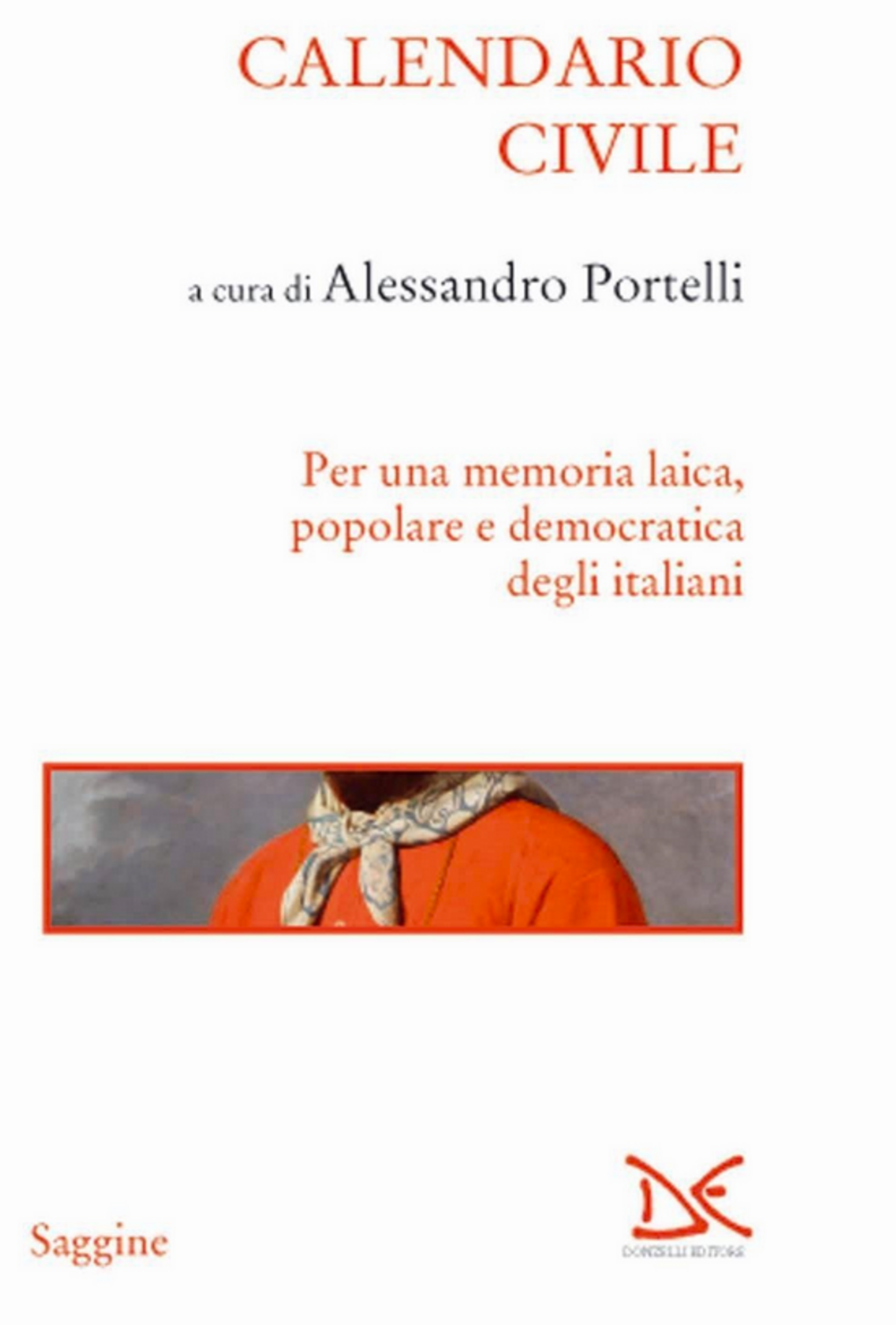
Ces 22 jours sont très différents par ce qu’ils incarnent, mais aussi par leur statut dans la société. Tous ne sont pas des jours fériés, tous ne donnent pas lieu à une reconnaissance partagée donnant lieu à consensus. Ils constituent dans leur ensemble une proposition collective, sans doute pas exhaustive, sûrement discutable, où chacune et chacun ne mettra pas les mêmes accents, n’exprimera pas les mêmes sensibilités. Le mélange des genres est aussi étonnant, de l’assassinat par l’État italien de Carlo Giuliani le 21 juillet 2001 lors du G8 de Gênes (mais le chapitre s’intitule « Les faits du G8 de Gênes », comprenant aussi les tortures perpétrées contre des manifestants au cours de la nuit suivante et reconnues depuis peu) à une fin enfin survenue le 4 novembre 1918 de cette grande boucherie qu’a été la Première Guerre mondiale, journée qui est pourtant aujourd'hui officiellement instituée comme celle « de l’unité nationale et des forces armées ». Ces dates commémoratives ont elles-mêmes leur histoire, si l’on pense à cette journée du souvenir du 10 février, introduite en 2004, après la journée de la mémoire du 27 janvier qui l’avait été en 2000. Les notices respectives de Raoul Pupo et Adachiara Zevi rendent compte avec pertinence de travail d’histoire et de mémoire qu’elles rendent possibles l’une et l’autre. Mais il n’en reste pas moins que la seconde venue a fait suite à l’instauration d’une journée de reconnaissance des victimes et des opposants, notamment les Justes, aux crimes de masse nazi-fascistes, et qu’elle a donc servi à intégrer d’autres victimes italiennes, notamment des zones frontalières est-adriatiques, dans ce processus de reconnaissance avec une perspective de « mémoire partagée » de toutes les victimes qui peut poser problème si elles devaient toutes être mises sur le même plan interprétatif.

Agrandissement : Illustration 3

Ces dates comprennent des massacres nazis (les Fosses Ardéatines, sans doute le massacre le plus emblématique parmi beaucoup d’autres), les bombardements alliés de San Lorenzo à Rome le 19 juillet 1943, puis la déportation des juifs romains le 16 octobre de la même année ; des crimes néo-fascistes perpétrés en lien avec d’obscurs secteurs de l’État (l’attentat meurtrier de 10h 25, le 2 août 1980, en gare de Bologne, pour lequel les familles des victimes réclament toujours de savoir la vérité sur sa nature réelle ; mais auparavant celui de Piazza Fontana, à Milan, le 12 décembre 1969, attribué à tort à un anarchiste dont la mort plus que suspecte produira de la violence radicale au cœur des années de plomb), des crimes mafieux (l’assassinat du juge Falcone, de sa femme et de son escorte à Capaci le 23 mai 1992 ; mais l’exécution du juge Borsellino le 19 juillet aurait pu y figurer aussi). Enfin, en 2007, le 9 mai, jour de l’assassinat d’Aldo Moro par les Brigades rouges en 1978, a été instauré comme journée de la mémoire des victimes du terrorisme.
D’autres dates n’évoquent pas seulement des victimes, mais plutôt des acteurs de l’émancipation. L’occupation des usines le 1er septembre 1920, lors du biennio rosso. Les quatre journées de l’insurrection antifasciste napolitaine (dès le 29 septembre 1943), qui soulignent la dimension nationale de cette lutte et complexifient la césure du 8 septembre (l’Armistice qui met soudain des Italiens face à des ennemis désormais déclarés), puis bien sûr la Libération du fascisme le 25 avril 1945. Mais se trouvent aussi les symboles de l’émancipation laïque et républicaine : la proclamation le 9 février 1949 de l’éphémère République romaine, écrasée le 30 juin ; la brèche de Porta Pia du 20 septembre 1870 par laquelle les troupes italiennes entrent dans Rome ; le vote pour la République du 2 juin 1946 qui marque aussi l’introduction du suffrage féminin ; et enfin, ce 12 mai 1974 qui voit triompher le référendum qui abroge l’interdiction du divorce.
Enfin, ce calendrier civil comprend deux dates internationales, celle de la fête des travailleurs le 1er Mai (curieusement appelée fête du travail dans le sommaire, ce que ne confirme pas l’auteur, Cesare Bermani, dans la conclusion de sa présentation) et celle de la journée internationale des femmes du 8 mars. S’y est ajoutée tout récemment, avec une grande pertinence, une journée en mémoire des victimes de l’immigration qui fait suite au naufrage de 500 réfugiés le 3 octobre 2013 au large de Lampedusa.
On le voit, cette proposition de calendrier est complexe et hybride. Elle comprend à la fois ce qui figurait déjà et pouvait être partagé, et ce qui devrait s’y insérer dans une construction mémorielle inclusive, « populaire et démocratique ». Chacun peut y voir ce qui manque à ses yeux, et je citerais ici volontiers, dans ce sens, les victimes de la violente colonisation italienne, mais aussi celles de l’émigration (dont les tragédies de Marcinelle, Mattmark) et du travail (la trop fameuse « morte bianca » qui a fait, qui fait, tellement de victimes, notamment en Italie). Mais, en même temps, le travail d’histoire et de mémoire n’a pas forcément à être réduit à des rituels dans et pour toutes ses thématiques, il peut se développer de toutes sortes de manières à travers les productions humaines.
Les complaintes trop souvent lues ou entendues contre de prétendus abus des pratiques et lois mémorielles ne sont pas toujours pertinentes. Notre rapport critique au passé a besoin de connaissance et de reconnaissance. Et les effets sociétaux des cadres sociaux de la mémoire chers à Maurice Halbwachs sont passionnants à étudier. Il n’en reste pas moins, cela étant, que le travail d’histoire implique aussi de l’attention et de la rigueur. Un fait tout récent montre ainsi à quels mésusages du passé peuvent mener les manipulations de la mémoire. Un communiqué de l’Association italienne de Public History qui dénonce l’invention abusive et de toutes pièces par une instance politique d’une commémoration insensée et relevant d’une manipulation du passé à des fins néo-identitaires l'illustre parfaitement :
« Le Conseil de Région des Pouilles [sud de l’Italie] s’est prononcé le 4 juillet 2017 pour l’institution d’une journée de la mémoire « pour commémorer les Méridionaux morts au moment de l’unification italienne ». La date choisie est celle du 13 février en souvenir du jour de 1861 au cours duquel, suite à la capitulation de Gaète [ville côtière au sud de Rome] assiégée par les troupes de Savoie, François II de Bourbon fut déchu, ce qui mit fin au Royaume des Deux-Siciles. Pour le mouvement de ces « néo-bourbonniques », cette date serait le début de l’histoire d’un Sud ayant perdu son indépendance et devenu victime des abus et intimidations de vainqueurs qui se rendirent coupables de tueries et de massacres. C’est alors qu’aurait commencé le déclin économique du Mezzogiorno au profit des régions du Nord de l’Italie. »
Néo-monarchisme, dépréciation des mouvements du Risorgimento, ces propos peuvent rappeler les constructions mémorielles invraisemblables qui, en France, se développent par exemple dans le contexte vendéen. Le travail critique de l’histoire invalide forcément de telles élucubrations. Cela dit, si les citoyens, comme les historiens, n’ont ni à proposer, ni à défendre n’importe quoi en matière de manipulation mémorielle, ils n’en ont pas moins le droit de réfléchir au sens de ce qu’ils fêtent ou ne fêtent pas, de ce qu’ils commémorent ou ne commémorent pas. Ils ont le droit de se positionner face à ce que la société ou certains secteurs de la société entendent leur faire fêter, commémorer, ou pas. C’est en tout cas ce que montre avec brio Alessandro Portelli dans l’introduction de son Calendario civile. Grand spécialiste de l’histoire ouvrière de la ville de Terni [3], dans le centre de l’Italie, il cite l’un de ses témoins, Arnaldo Lippi, qui lui racontait que des travailleurs de la laine s’étaient adressés un jour à leur patron pour faire déplacer la fête de début novembre du jour des saints, le 1er, au jour des morts, le 2. Le patron, bigot, s’y refusa. « - Écoutez, nous, des saints, nous n’en avons pas, mais des morts, oui, nous en avons. Et nous voulons aller les commémorer », lui dirent les ouvriers. Et donc, comme ils l’avaient annoncé, les travailleurs, dont une majorité de femmes, se présentèrent au travail le 1er et trouvèrent porte close. Le lendemain, 2 novembre, personne ne vint travailler. Et dès le 3, le patron déclara un lock-out qui dura longtemps et qui affama cette population ouvrière.
Cette histoire pleine de sens pour les réflexions sur la mémoire et les commémorations, et surtout sur la place et la reconnaissance des subalternes et de leurs valeurs dans la société, ainsi que sur leur espace d’initiative en la matière, ne peut que nous inciter à ne pas banaliser ce qui nous est imposé en termes de commémorations, de représentations et d’usages du passé. Elle ne rend donc pas le Premier Août helvétique moins problématique.
Charles Heimberg (Genève)
[1] Voir l’heureuse et récente traduction-édition d’interventions publiques de Max Frisch : Le public comme partenaire, traduit par Antonin Wiser, Lausanne, Éditions d’en bas, 2017. Voir le chapitre « Discours de fête (1957) », pp. 13-19.
[2] Alessandro Portelli (a cura di), Calendario civile. Per una memoria laica, popolare e democratica degli italiani, Rome, Donzelli, 2017.
[3] On ne dira jamais assez combien grande est la perte de ne pas voir traduire en français les ouvrages d’histoire orale d’Alessandro Portelli : sa magnifique étude sur la mémoire des Fosses Ardéatines, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Rome, Donzelli, 1999 ; mais aussi, récemment réédités en un seul volume, ses travaux sur Terni : La città dell’acciaio. Due secoli di storia operaia, Rome, Donzelli, 2017.



