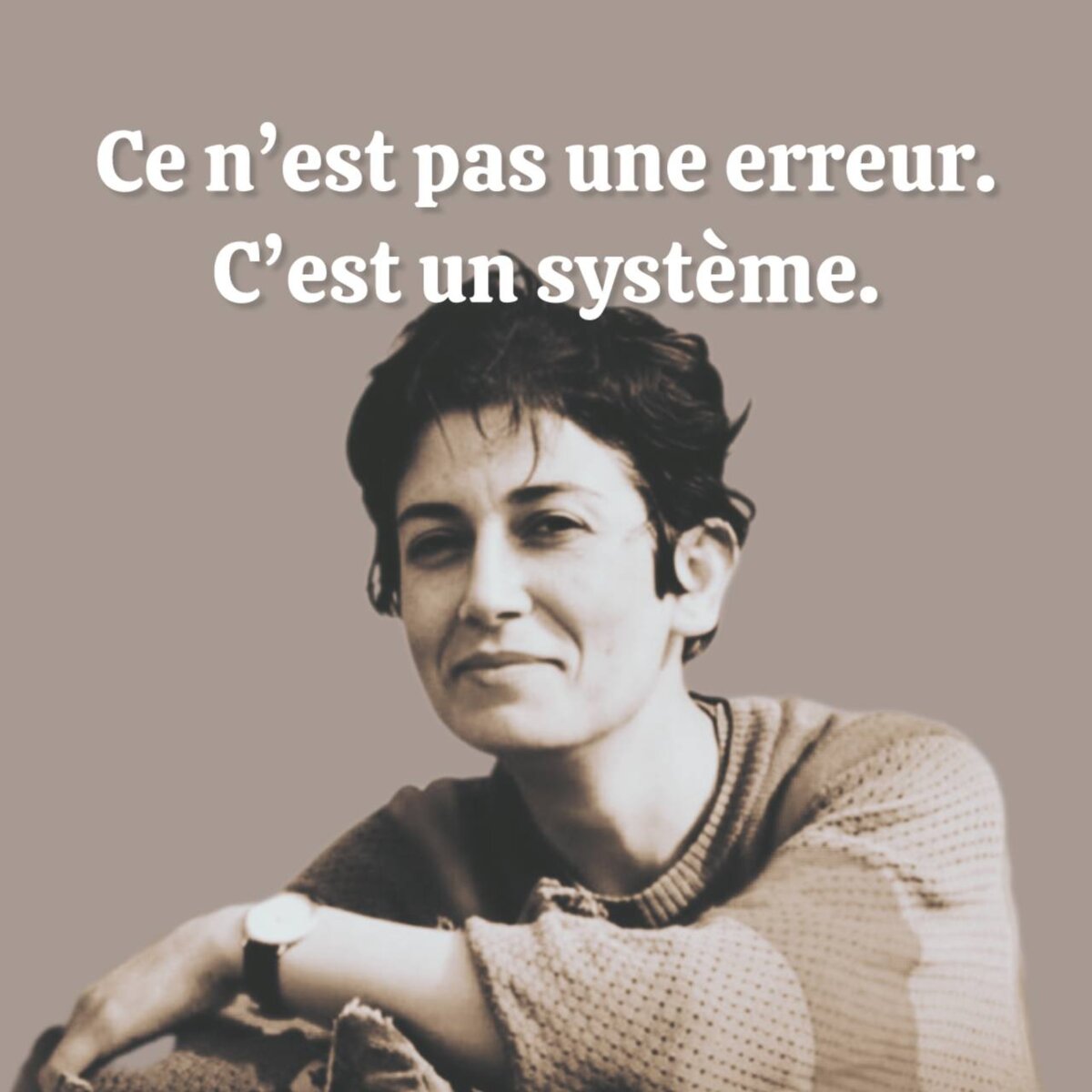
Agrandissement : Illustration 1
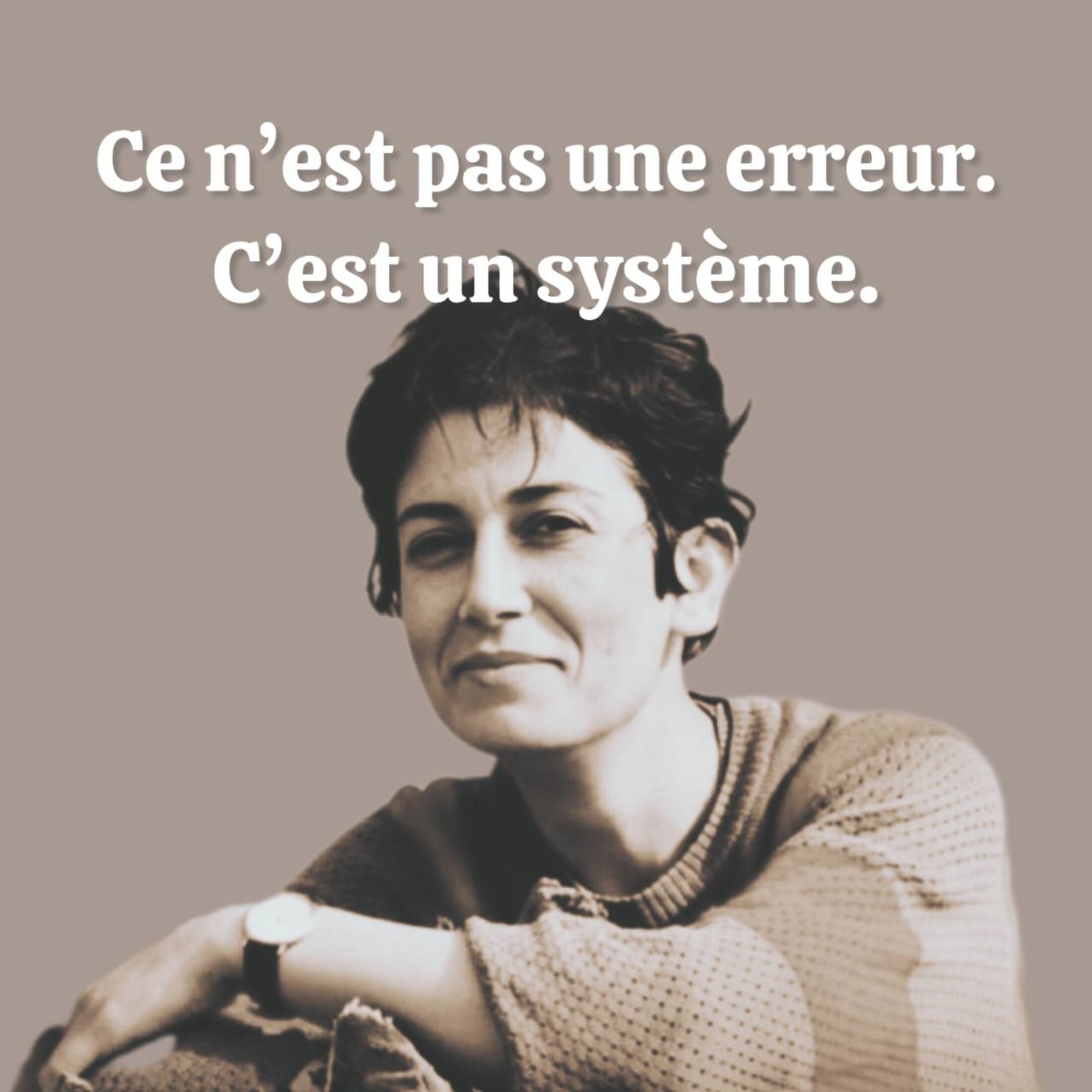
La Cour suprême de la République islamique d’Iran a rejeté, sans demander le dossier ni examiner les arguments de la défense, la deuxième demande de révision du procès de Pakhshan Azizi, travailleuse sociale condamnée à mort. Une seule justification : « infondé ». Ce mot, en apparence juridique, résume à lui seul une logique autoritaire où la justice n’est plus un principe, mais un outil d’élimination légitimée.
Pakhshan Azizi, femme kurde et travailleuse sociale, avait soutenu en Syrie des femmes yézidies rescapées de Daech. Aujourd’hui, en Iran, elle est condamnée à mort pour appartenance à cette même organisation. Un renversement qui ne relève pas d’une erreur judiciaire, mais révèle un fonctionnement où les faits sont réinterprétés à l’aune des impératifs idéologiques du pouvoir.
Dans ce système, le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas en autonomie. Il est enchâssé dans un ordre plus large — religieux, sécuritaire, politique. La justice y est redéfinie à l’intersection du dogme théologique et des logiques de contrôle étatique. Le tribunal n’est plus un lieu de vérification, mais un espace de mise en scène de la conformité.
Pakhshan Azizi incarne une forme d’action que cet ordre perçoit comme dangereuse : une pratique qui ne vient pas du pouvoir, mais de la société, des marges, du soin. Une action sociale autonome, surtout lorsqu’elle est portée par une femme — et plus encore lorsqu’elle émane des sociétés périphériques face à un État centralisateur — devient une perturbation de l’ordre établi. Non pas pour ce qu’elle fait, mais pour ce qu’elle symbolise.
Le tribunal ne vise pas la vérité, mais la reproduction de l’ordre. Par la langue du droit, les logiques sécuritaires et la légitimation religieuse, l’élimination devient une procédure. La violence ne s’exerce pas en marge du droit, mais par lui.
Pakhshan Azizi n’est pas un cas isolé. Elle est la figure de ce que ce système craint fondamentalement : une subjectivité politique qui ne provient pas de l’appareil d’État, mais de la société elle-même. Le rejet de sa demande ne dit pas seulement « non » à une défense — il affirme un modèle où toute autonomie est systématiquement redéfinie comme une menace.
- Hengameh Hoveyda



