La conférence de Jean-Louis Fabiani revenait sur ses contributions en matière de sociologie des publics et de la culture, l'un des domaines de spécialité où il fait autorité, et notamment sur un livre dense et trop peu souvent travaillé en études théâtrales, L'Education populaire et le théâtre. Le public d'Avignon en question (PUG, 2008)1.
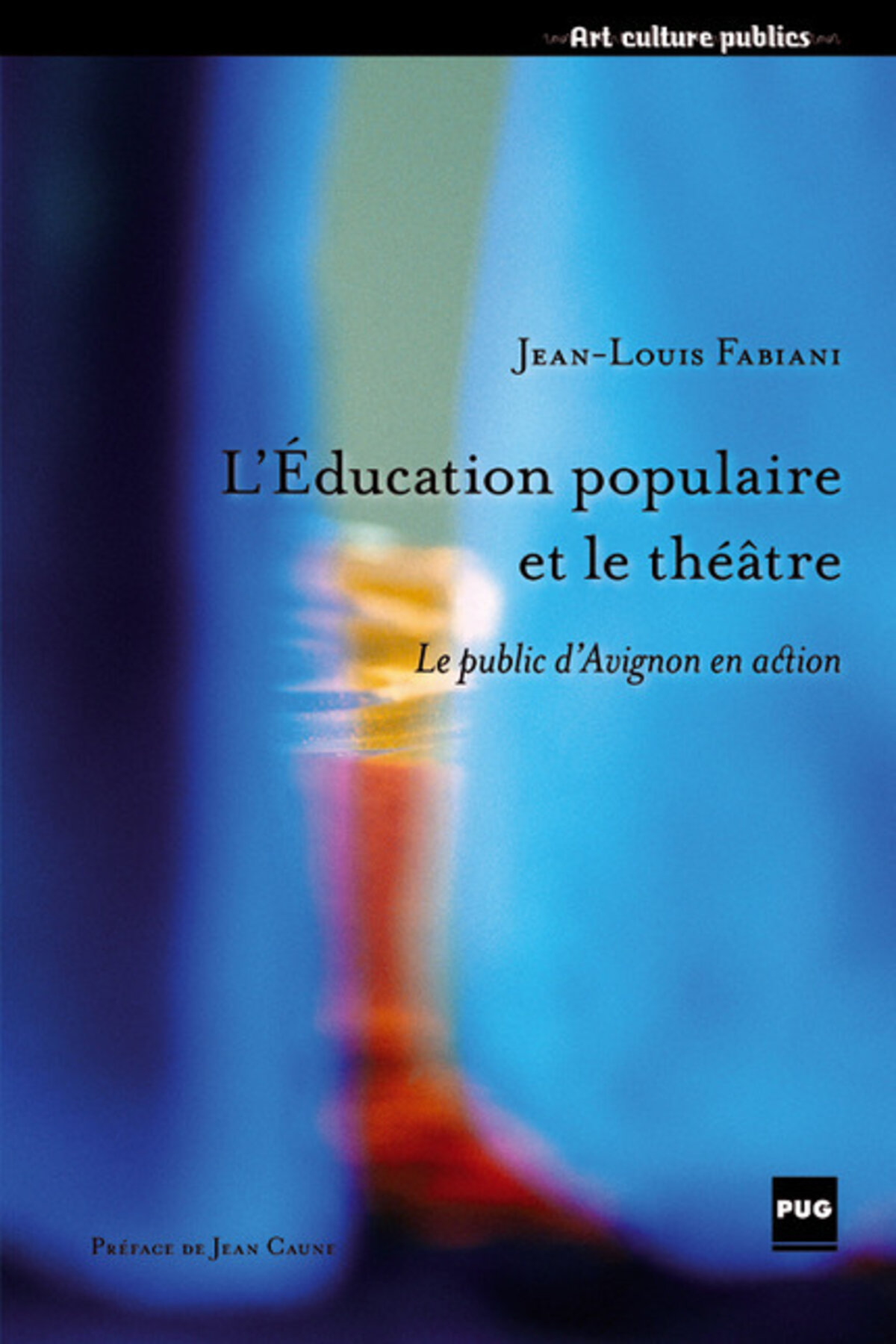
Agrandissement : Illustration 1
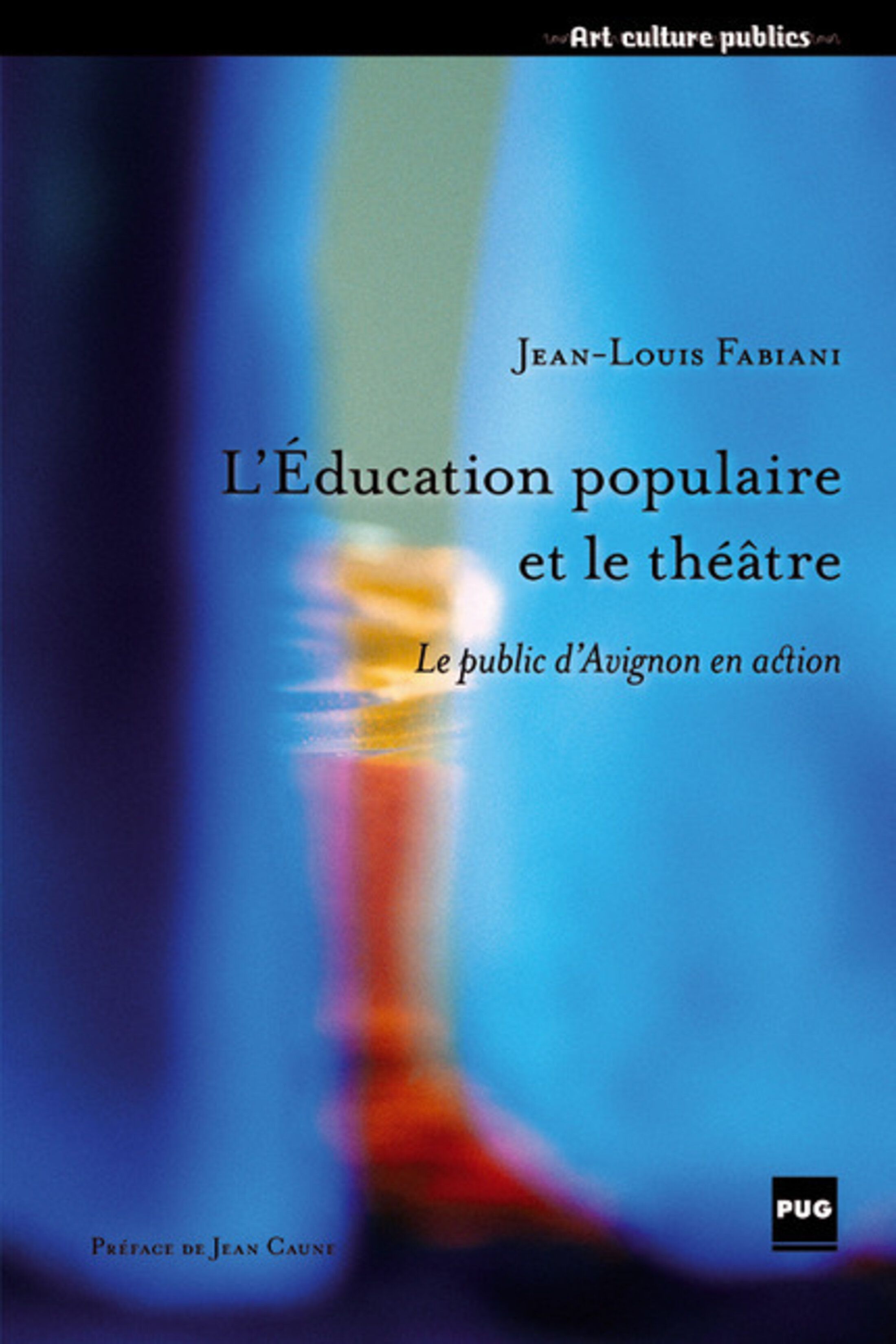
1. Rupture dans l'anthropologie herméneutique
L'enquête se concentre sur le public festivalier pendant l'été 2005, et notamment sur l'observation des traditionnels débats des CEMÉA, qui existent depuis la création du festival.
Ces derniers servirent de caisse de résonance à cette 59ème édition du festival, qui a marqué les mémoires par l'entrée en scène - fréquemment décrite comme fracassante et provocatrice - de nouvelles figures d'artistes (W. Vandekeybus, J. Fabre, P. Rambert, T. Ostermeier...), souvent plus proches de la danse et de la performance que du théâtre.
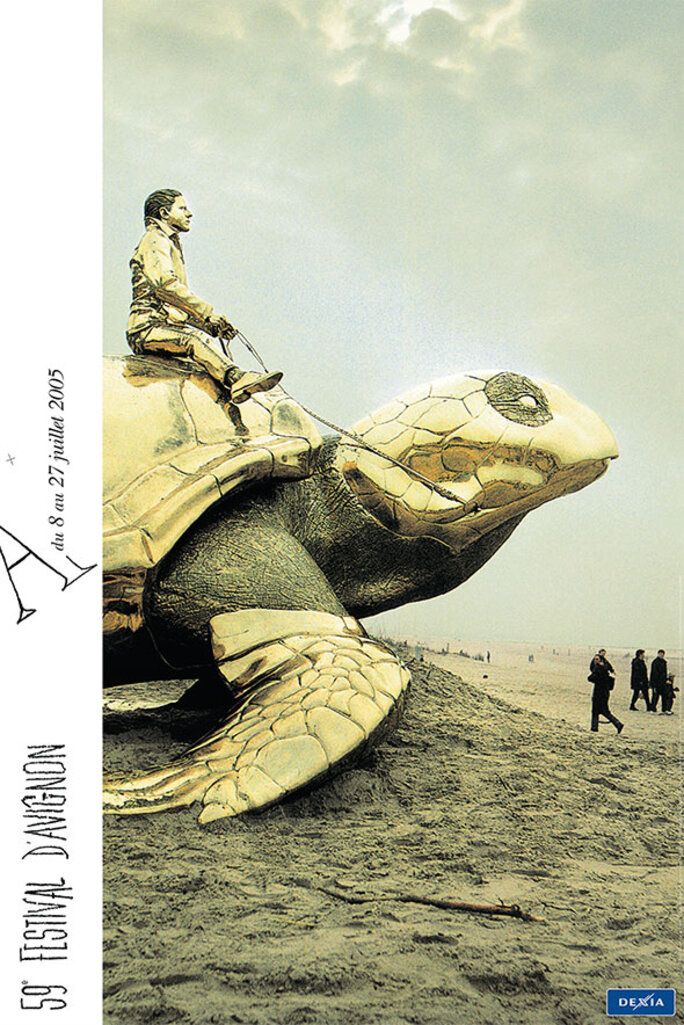
Agrandissement : Illustration 2
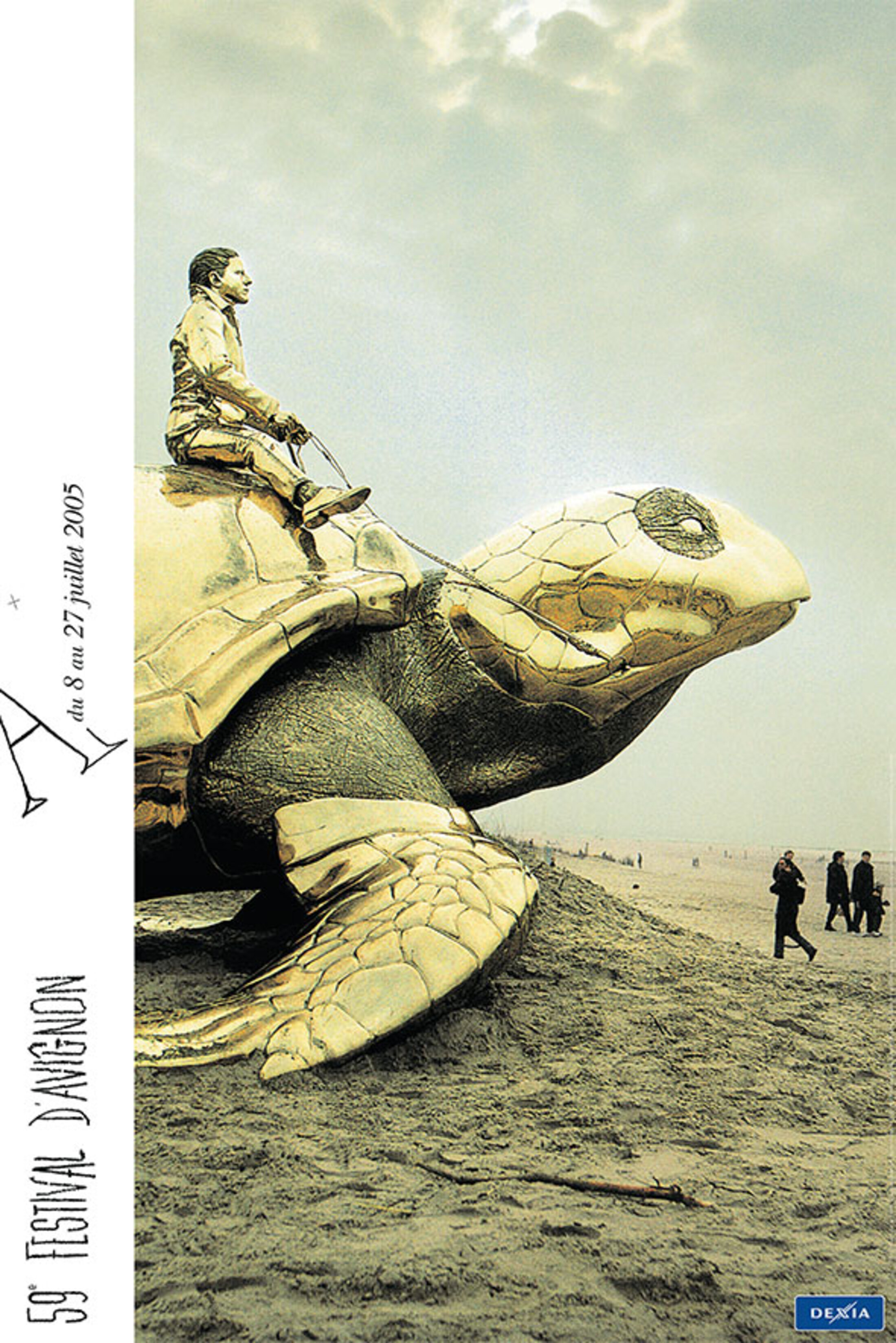
La presse et la sphère politique amplifièrent et sans doute dramatisèrent cette polémique (cf. déconsidération du Ministre de la culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabres), déclenchée par la consécration avignonnaise de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler "le théâtre postdramatique": des formes scéniques pluridisciplinaires, mondialisées, souvent saturées d'effets (esthétique du choc), marginalisant le texte et appelant un régime de compréhension inédit, car déplaçant les lignes entre le dicible et le sensible.
La réitération, différente de celle de Mai 68 car largement dépolitisée, du geste de rupture avec la tradition vilarienne - privilégiant quant à elle la sobriété, le didactisme mais aussi la cohésion de la communauté - était éclatantes dans ces nouvelles formes scéniques explorant le dissensus, le choc, et parfois convoitant le scandale.
Le travail de Fabiani revendique un décalage par rapport au mécanicisme bourdieusien, afin d'intégrer dans la démarche sociologique la question du jugement esthétique et du rapport à l'oeuvre, en la sortant de son interprétation totalisante en tant qu'objet "classant". Il met en exergue la conflictualisation de deux modèles herméneutiques de la modernité et son exacerbation, lors de cette édition:
- celui du "créateur autonome", autrement dit le metteur en scène, figure d'artiste civilisationnelle revendiquant une forme de désintérêt du public, à minima une déconnexion du geste créateur et de la notion d'horizon d'attente.
- celui du "spectateur émancipé" (Dort, Rancière) et du "public" de théâtre comme modélisation de l'expérience démocratique, autonomie interprétative de la ruche sociale autoinstituée et autoinstituante, par rapport au légitimisme ascendant du Sens.
A tous égards, cette contribution sociologique rejoint certains constats émis, sur le terrain de la philosophie, par Carole Talon-Hugon dans Avignon 2005. Le Conflits des héritages : la philosophe considère cette édition comme un agon herméneutique où s'affrontent deux dynamiques interprétatives "libérées" par la philosophie kantienne: la liberté interprétative de l'artiste et celle du spectateur.
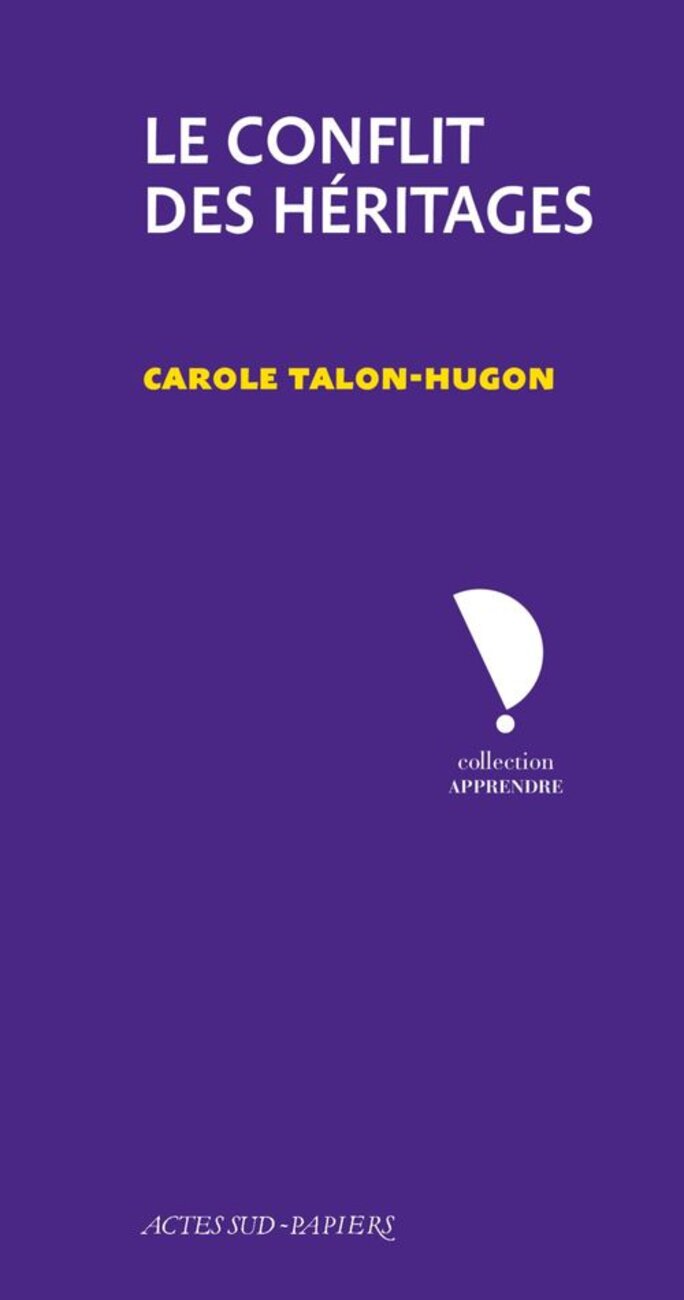
Agrandissement : Illustration 3
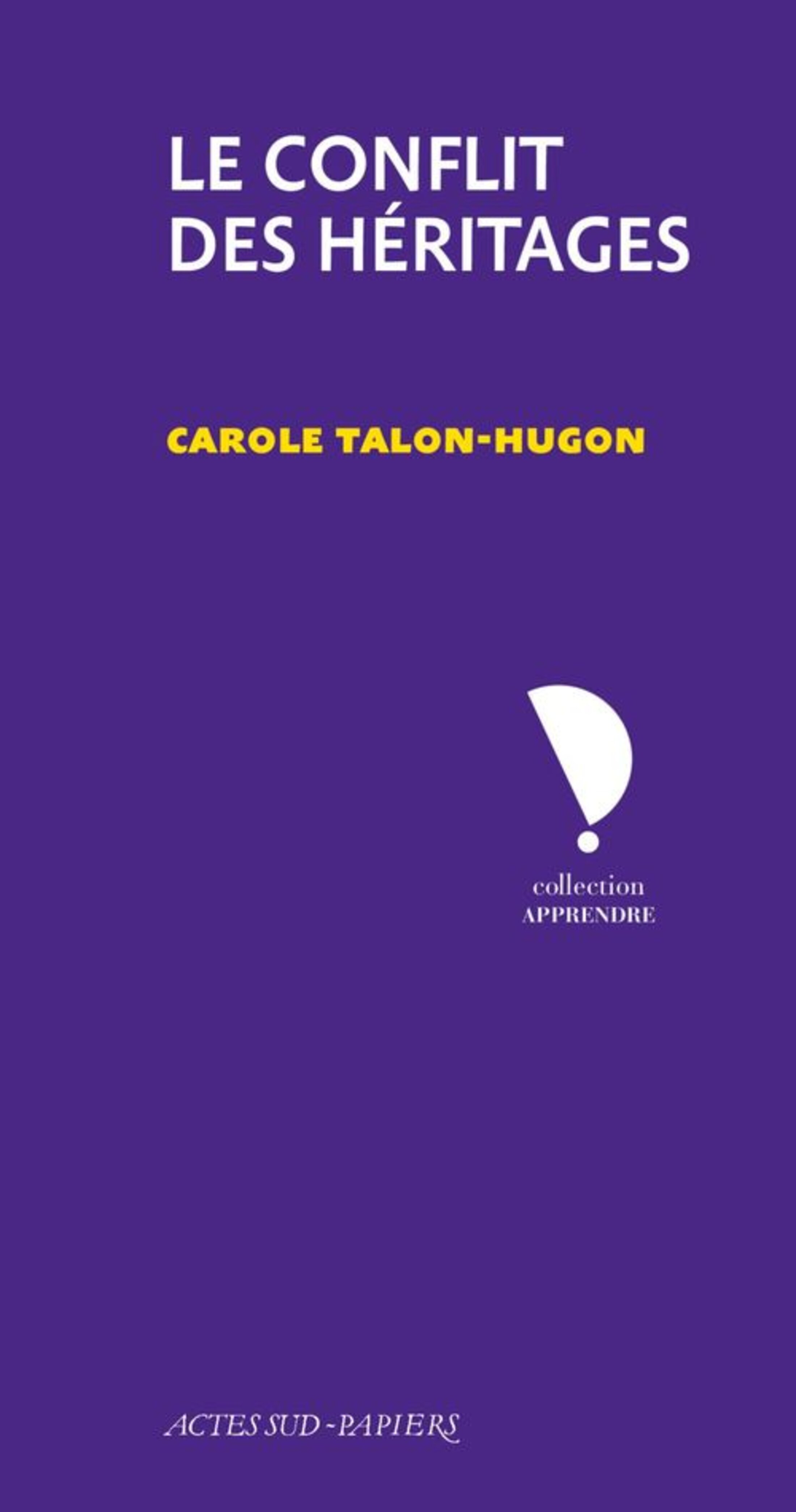
2. Début ou fin de règne?
La passionnante conférence de Jean-Louis Fabiani (trop riche pour être ici résumée) a suscité de nombreuses pistes de réflexion; elle éclaire des zones de travail encore dans l'ombre. De quoi "Avignon 2005" fut-il le révélateur? Selon Gérard Noiriel, qui dénonça la dimension nihiliste, esthétisante de cette tendance, cette édition revêt un caractère obscène en sacralisant une figure cynique et apolitique, celle du "Créateur" démiurge (Agone, 2009).
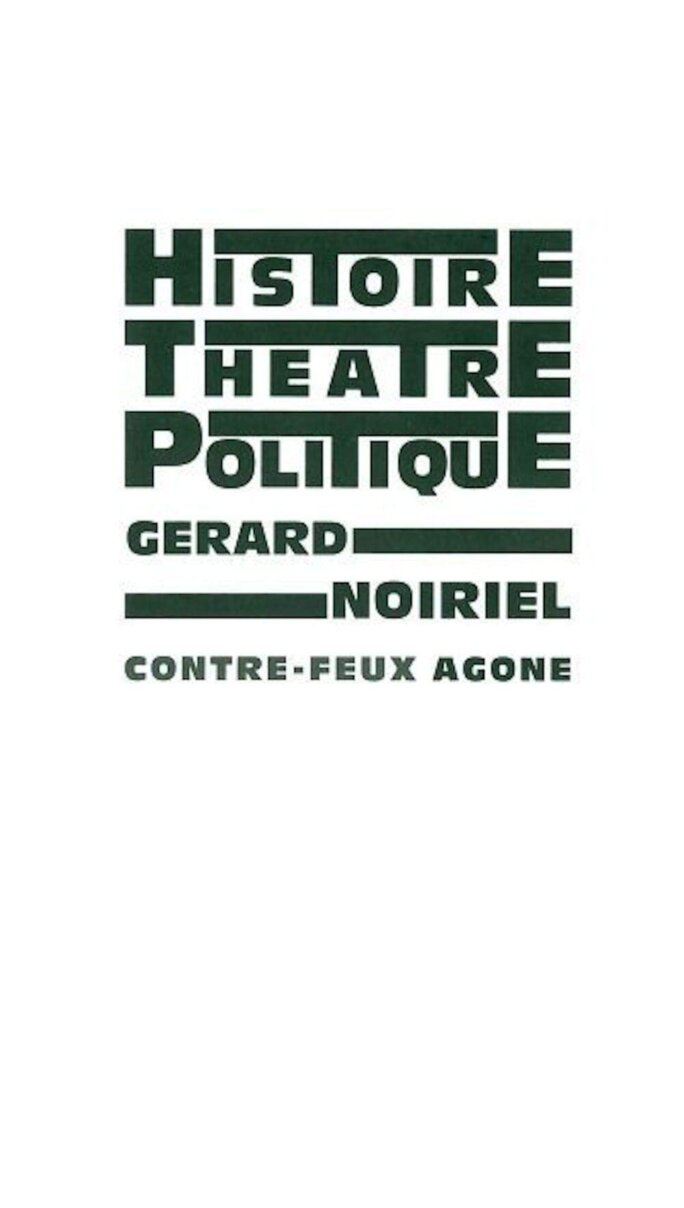
Agrandissement : Illustration 4
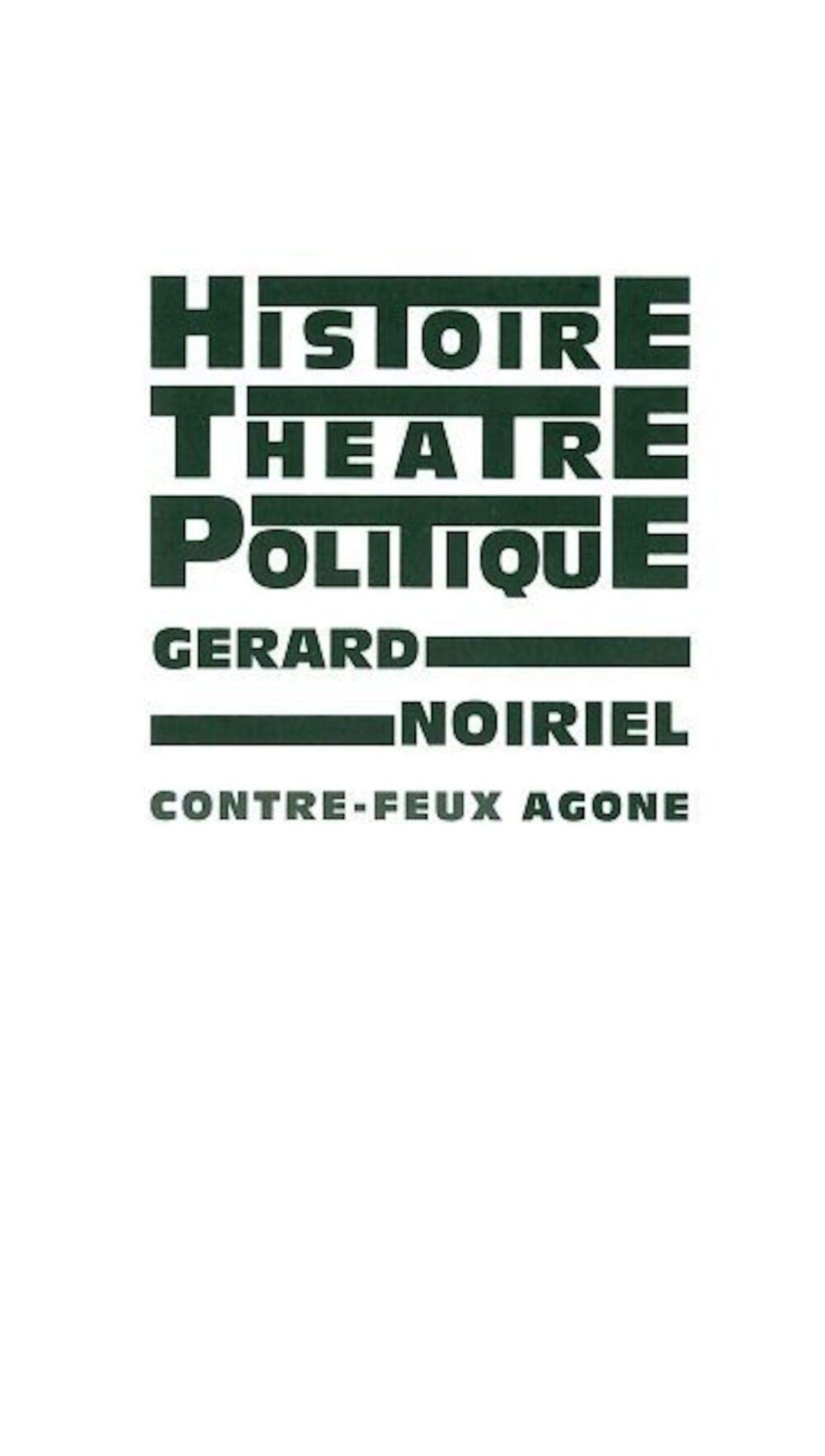
Mais le sillage laissé par cette édition demeure peu aisé à analyser car il n'est pas monolithique. Les années post-2005 ont au contraire tendu à faire la place à des formes oppositionnelles, loin des propositions autonomistes voire esthétisantes de la 59ème édition. Nous voyons apparaître:
- Se manifestant par une très forte transitivité du discours, un didactisme parfois obséquieux et lourd (pièces politiques, voire "surpolitiques" et sur-fléchées). Ce néo-didactisme est antibrechtien, car il contrôle l'interprétation du spectateur (l'exemple type étant Mesdames et Messieurs et le reste du monde, le mini-festival "engagé" de David Bobée)
- La surenchère des formes participatives et amateurs (cf. Cour d'honneur de Jérôme Bel, en cela spectacle paradigmatique), l'inversion des figures de créateur et de spectateur.
- La figure du "retrait" (parfois surjoué) du metteur en scène: ainsi dans les spectacles du collectif de Rimini Protokol, ou de Milo Rau, pour ne citer qu'eux, on assiste à la mise en place d'une sorte de cybernétique interactive, dans laquelle le metteur en scène est censé se dissoudre dans les interactions, et appuie lourdement sur son auto-effacement (Milo Rau utilise beaucoup cet ethos du "retrait" derrière le réel). Paradoxalement, ce retrait n'est pas antinomique avec le fléchage idéologique ni avec la "mégalomanie".
Ces nouvelles figures de metteur en scène et de contrôle de l'interprétation ne sont pas forcément moins "autoritaires" que les précédentes. Leur légitimité se fonde plus sur l'hétéronomie que l'autonomie, si bien que j'ai pu parler à leur sujet d'ingénieurs du social. Il apparaît en tout cas assez nettement que l'édition 2005 marque plutôt la fin d'un cycle, celui du règne du "Maître en scène" et du théâtre postdramatique comme grand "opéra sensoriel".
Elle a ouvert une nouvelle séquence dans laquelle les figures de "Créateurs" cherchent à abandonner, au moins en apparence, leur majuscule.



