Car l'inconscient ignore la négation.
S'exposant ainsi au risque de reconduire, et propager ce qu'ils "dénoncent" avec la posture d'indignation désormais de mise sur tous les réseaux sociaux; tous bords politiques confondus.
Par un effet d'inversion, il semble devenu impossible au théâtre de se transposer dans le passé. Tout est conçu, reçu au présent, au prisme de nos susceptibilités actuelles. La figure du metteur en scène incarne ce nouveau management du symbolique qui doit adapter le passé et le rendre conforme au déjà-pensé du présent, digérable par ses contemporains.
Deux mises en scène récentes résistent à ces injonctions: celle du Misanthrope par Peter Stein, celle des Sorcières de Salem par Emmanuel Demarcy-Mota.
Retour bref sur ces deux ovnis intempestifs. Au sens nietzschéen.
***
Peter Stein, dont les deux principales sources d'influence sont Peter Brook et Roger Planchon, a choisi de monter un Misanthrope "textocentré", chose qui ne se fait désormais plus dans les "écritures de plateau". Lambert Wilson y porte même une perruque!
L'on pourrait en rire (et la critique ne s'en prive pas) mais il est difficile de qualifier Stein de "ringardise" quand on connaît son parcours.
Il a d'ailleurs participé à l'émancipation, à la libération (au sens lyotardien, sens qui inclut les excès, la liquéfaction et la destruction interne au geste de libération) de la mise en scène.
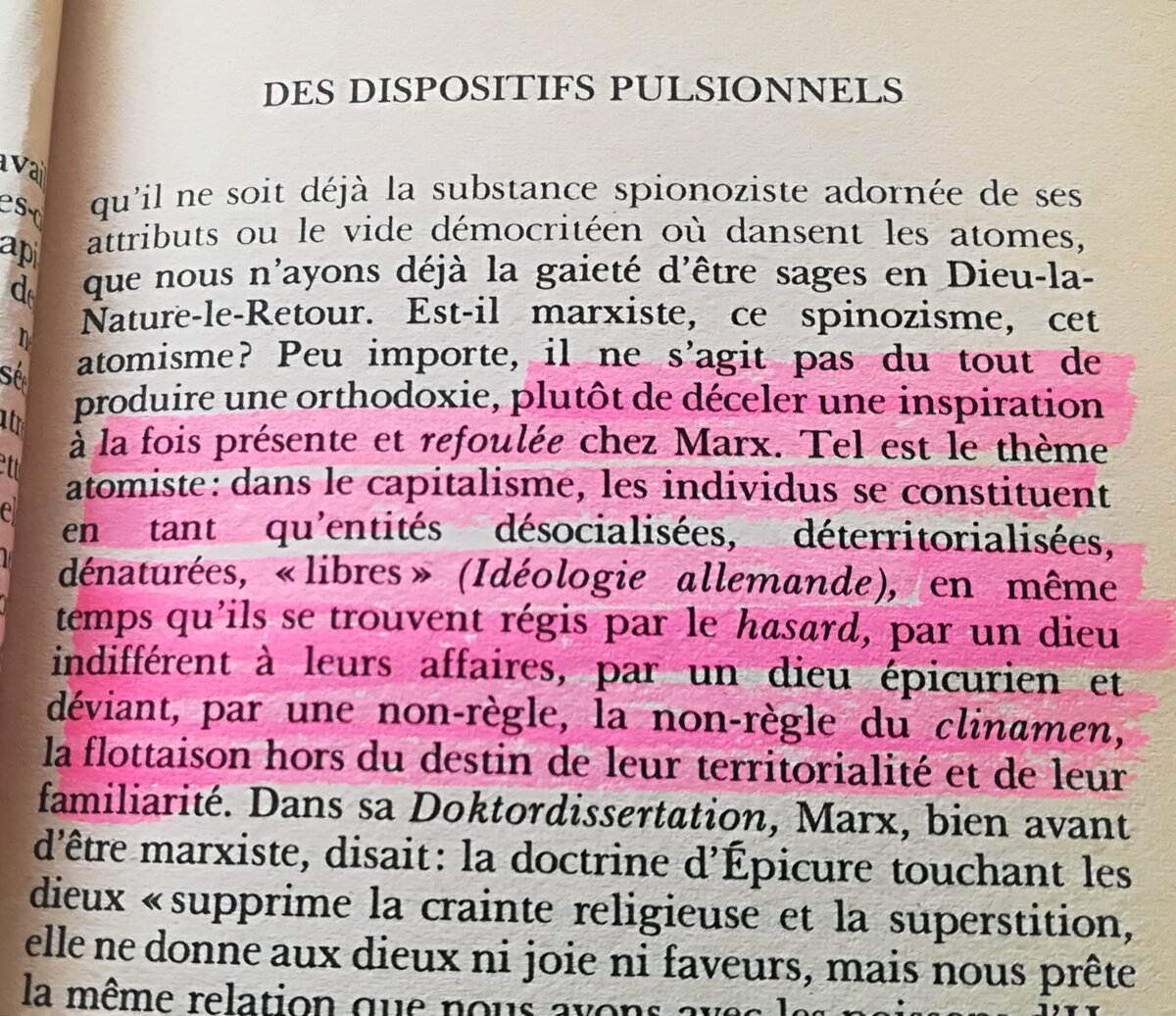
Agrandissement : Illustration 1

Ce retour au texte le rangera pour certains dans le camp des "conservateurs".
Il évoque cependant aussi, dans la critique antitotalitaire de gauche, les mises en garde contre la fluidification, le présentisme et l'atomisation.
Ce revirement de Stein est assez intéressant car il a, par le passé, été l'un des premiers metteurs en scène à appuyer ce présentisme de la mise en scène, notamment dans sa relecture des Euménides qui associait sans précaution le geste d'Oreste à la Shoah :
"Ils ne peuvent justifier Oreste et ils ne peuvent non plus le condamner : l’un à cause des raisons très anciennes, l’autre à cause des raisons qui visent le futur. Si on libère le premier homme qui a tué sa mère, alors tous les crimes futurs de l’humanité sont justifiés, les 6.000.000 juifs tués par le nazisme aussi."
Il est donc possible de relire cette dernière mise en scène de Stein à l'intérieur de son parcours de metteur en scène, et d'une histoire de la mise en scène : comme l'expression d'une forme d'inquiétude récente, quand la mise en scène devient l'exemplification d'une ingénierie, d'une ergonomie sociale vouées à conformer la culture passée aux indignations du présent.
***
La cas d'Emmanuel Demarcy-Mota ne fait pas état d'un tel revirement, car ce metteur en scène (beaucoup plus jeune), bien entendu attaqué par la critique différentialiste de Sceneweb, fait preuve d'une constance assez remarquable.
La pièce de Miller fait cependant figure d'exception dans son parcours de mise en scène qui privilégiait déjà des auteurs du paradoxe (Brecht) et de l'absurde (Pirandello, Ionesco, Camus) mais jusqu'ici, européens: en montant un américain, il prend acte de la globalisation culturelle.
C'est assez savoureux car alors que nous croulons sous des spectacles qui, dans la lignée de Mona Chollet, font de la "sorcière" l'incarnation de l'émancipation et du féminisme (adoubant ainsi l'irrationnalisme bienséant du postmodernisme le plus relativiste, libidinal et néolibéral), le choix se porte ici sur une pièce non-dualiste où la sorcière est "responsabilisée" (et donc humanisée): une figure à DOUBLE entente et non angélisée.
La pièce de Miller n'ignore aucun des rapports de force et d'oppression, fortement traités par la mise en scène (le colonialisme, le sexisme) mais sans manichéisme.
Le "classicisme" de la mise en scène (sa discrétion rigoureuse) est ici, dans un climat de carnavalisation et de "déréférencement des signes", un geste politique plus difficile à entendre que les déclarations d'intention, mais beaucoup plus juste.
Ne pas se conformer aux attentes prédigérées du présent et de ses humeurs; non pas dénoncer mais mettre à jour les mécanismes de dénonciation que nous sommes en train de banaliser; ménager le point de fuite du doute et du paradoxe.
Cela exige beaucoup de mise en doute du narcissisme de la mise en scène, et beaucoup de lucidité politique.
***
Jadis, la haine du théâtre articulait deux types de topos argumentatif: la condamnation du caractère immoral du contenu (licencieux, lubrique, etc - argument plutôt privilégié par la critique des Pères de l'Eglise); la condamnation du caractère dangereux du dispositif (contaminant le spectateur - argument moins fondé sur l'image et plus "protestant", rousseauiste).
Aujourd'hui que procès, bûchers et tribunaux, plus ou moins métaphoriques, fleurissent sur les scènes de théâtre, l'on peut se demander si le théâtre n'est pas en train de retourner dans le giron de l'Eglise.



