Les élections dans une théocratie qui applique la torture et la peine de mort ne sont pas un scrutin démocratiques. Les opposants sont emprisonnés et exécutés, les partis d'opposition sont interdits. Seules les personnes fidèles au « principe du guide suprême religieux » peuvent se présenter candidat dans ce pays. Alors, il ne faut pas se leurrer sur les résultats que vont annoncer les mollahs. Ces derniers cherchent plutôt à se donner un vernis de légitimité qu'ils n'ont pas.
Les premiers rapports parvenus d'Iran sur la participation électorale font état du désintérêt de la population qui ne se fait aucune illusion sur la capacité du régime à se réformer. Puisque tous les clans du régime s'opposent à une véritable démocratie et des élections libres. Je vous invite à la lecture d’extraits du dernier rapport annuel d’Amnesty International, paru le 24 février 2016, sur la situation des droits de l'homme en Iran :
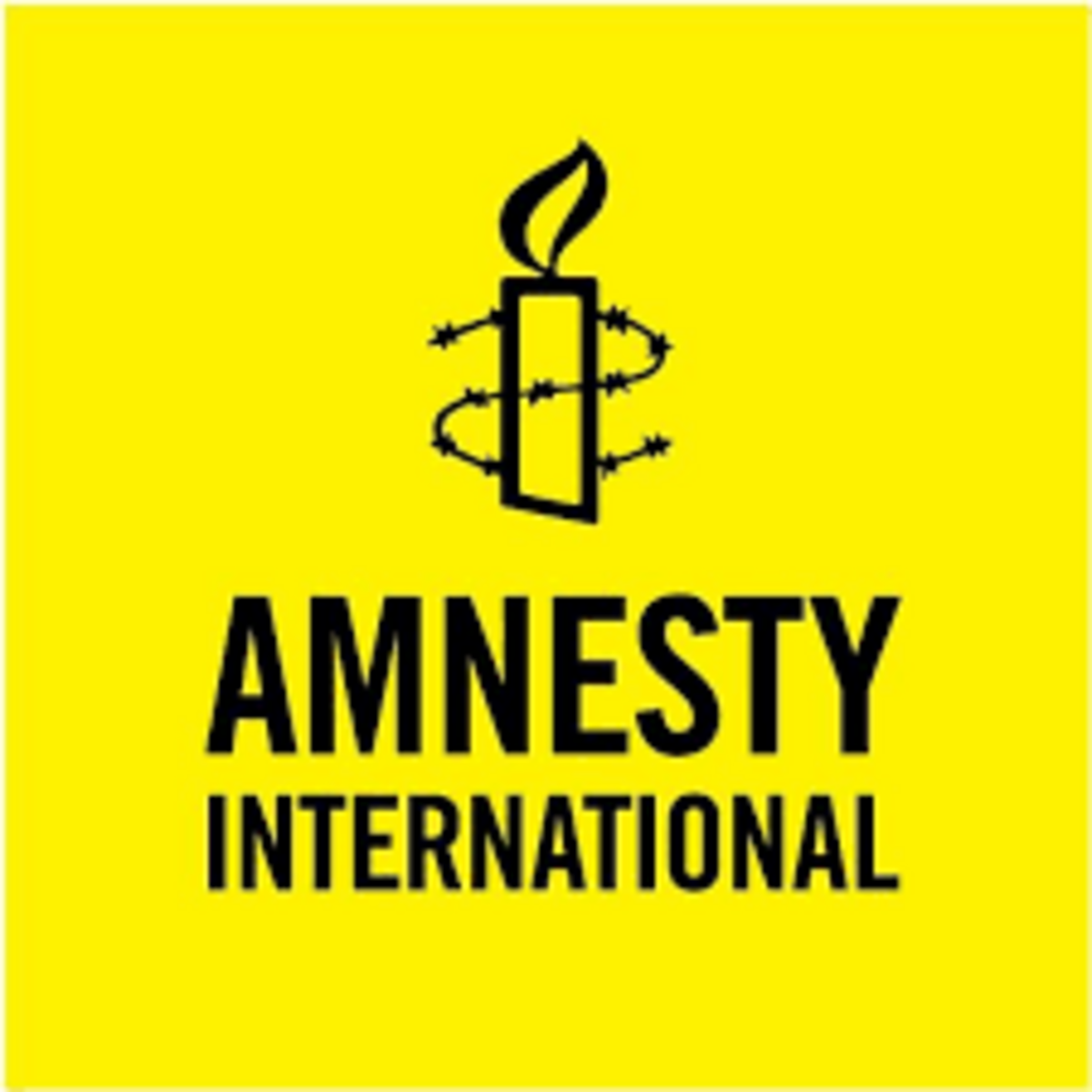
Amnesty International : Les autorités ont imposé des restrictions sévères à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Des journalistes, des défenseurs des droits humains et des syndicalistes, entre autres voix dissidentes, ont été arrêtés et emprisonnés sur la base d’accusations vagues et de portée large. Le recours à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements est resté répandu, en toute impunité. Les conditions de détention étaient éprouvantes.
Cette année encore des procès inéquitables ont eu lieu, débouchant dans certains cas sur des condamnations à mort. Les femmes, ainsi que les membres des minorités ethniques et religieuses, souffraient de discrimination généralisée, dans la loi et dans la pratique. Des châtiments cruels ont été appliqués ; des condamnés ont notamment été rendus aveugles, amputés ou fouettés. Les tribunaux ont prononcé des condamnations à mort pour toute une série de crimes ; de nombreux prisonniers, dont au moins quatre mineurs délinquants, ont été exécutés.
Peine de mort
Cette année encore, la peine de mort a été largement appliquée ; de nombreuses exécutions, y compris de mineurs délinquants, ont eu lieu, dans certains cas en public.
Les tribunaux ont prononcé de nombreuses sentences capitales, le plus souvent à l’issue de procès inéquitables et pour des infractions, par exemple celles liées à la drogue, qui ne relevaient pas des « crimes les plus graves » au regard du droit international. La majorité des personnes exécutées au cours de l’année avaient été condamnées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; d’autres ont été exécutées pour meurtre ou après avoir été déclarées coupables de crimes définis de manière vague comme « l’inimitié à l’égard de Dieu ».
Plusieurs dizaines de mineurs délinquants étaient toujours sous le coup d’une sentence capitale. Un certain nombre ont été de nouveau condamnés à mort après avoir bénéficié d'un deuxième procès en vertu des nouvelles directives sur la condamnation des mineurs figurant dans le Code pénal islamique de 2013. Amnesty International est en mesure de confirmer l’exécution d’au moins trois mineurs délinquants ; Javad Saberi, pendu le 15 avril, Samad Zahabi, pendu le 5 octobre, et Fatemeh Salbehi, pendue le 13 octobre. Selon des groupes de défense des droits humains, un autre mineur délinquant, Vazir Amroddin, ressortissant afghan, aurait été pendu en juin ou en juillet. En février, les autorités ont transféré Saman Naseem, condamné en 2013 pour un crime commis alors qu’il était âgé de 17 ans, dans un lieu tenu secret, ce qui a suscité l’inquiétude au niveau international et a fait craindre qu’il ne soit sur le point d’être exécuté. Après l'avoir soumis à une disparition forcée pendant cinq mois, les autorités l'ont finalement autorisé à téléphoner à sa famille en juillet, et ont confirmé à son avocat que la Cour suprême avait ordonné, en avril, qu'il soit rejugé.
Torture et autres mauvais traitements
Le gouvernement a maintenu les restrictions sévères pesant sur la liberté d’expression, d’association et de réunion (…) Cette année encore, des détenus se sont plaints d’avoir été torturés et maltraités, tout particulièrement lors des enquêtes initiales ; ces pratiques avaient essentiellement pour but de les contraindre à « avouer » ou de recueillir d’autres éléments à charge.
Les prévenus et les condamnés étaient privés des soins médicaux adaptés à leur état ; dans certains cas, les autorités n'ont pas fourni, à titre de punition, les médicaments prescrits à certains prisonniers, ou ont refusé de suivre les recommandations d’un médecin qui conseillait leur hospitalisation4. Les détenus étaient souvent soumis à de longues périodes d’isolement, ce qui s'apparentait à de la torture ou d’autres mauvais traitements.
Ils étaient enfermés dans des cellules surpeuplées et insalubres, recevaient une quantité insuffisante de nourriture et étaient exposés à des températures extrêmes. C’était notamment le cas des détenus des prisons de Dizel Abad à Kermanshah, d’Adel Abad à Chiraz, de Gharchak à Varamin et de Vakilabad à Meched. Selon d'anciens prisonniers, 700 à 800 détenus de la prison centrale de Tabriz étaient entassés dans trois cellules mal aérées et insalubres, avec à leur disposition seulement 10 toilettes. Les autorités ne tenaient le plus souvent pas compte des règlements pénitentiaires exigeant que les différentes catégories de prisonniers soient détenus dans des quartiers séparés. Des prisonniers politiques, dont certains étaient des prisonniers d’opinion, se sont mis en grève de la faim pour protester contre cet état de fait. La mort d'au moins un prisonnier d'opinion, Shahrokh Zamani, probablement imputable aux mauvaises conditions de détention et au manque de soins médicaux, a été signalée.
Châtiments cruels, inhumains ou dégradants
Des châtiments violant la prohibition de la torture et des autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes ont continué d’être prononcés et appliqués. Ces peines, telles que la flagellation, l'amputation et l'énucléation, ont été parfois infligées en public. Le 3 mars, les autorités de Karaj ont délibérément rendu aveugle de l’œil gauche un homme qui avait été condamné au titre du principe de « réparation » (qisas) pour avoir jeté de l’acide dans la figure d’un autre homme. Il devait également subir l’ablation de l’œil droit. L’application de la peine d’un autre prisonnier prévue pour le 3 mars a été reportée. Cet homme devait être rendu aveugle et sourd.
Le 28 juin, les autorités de la prison centrale de Meched, dans la province du Khorassan, ont amputé, semble-t-il sans anesthésie, quatre doigts de la main droite de deux hommes condamnés pour vol.
Des peines de flagellation ont également été appliquées. En juin, un procureur adjoint de Chiraz a annoncé l’interpellation de 500 personnes, dont 480 ont été jugées et déclarées coupables dans les 24 heures qui ont suivi pour avoir mangé en public pendant le mois de ramadan. La plupart ont été condamnées à la flagellation, peine qui leur a été appliquée par le Bureau d’exécution des peines. Certaines peines de flagellation auraient été infligées en public.
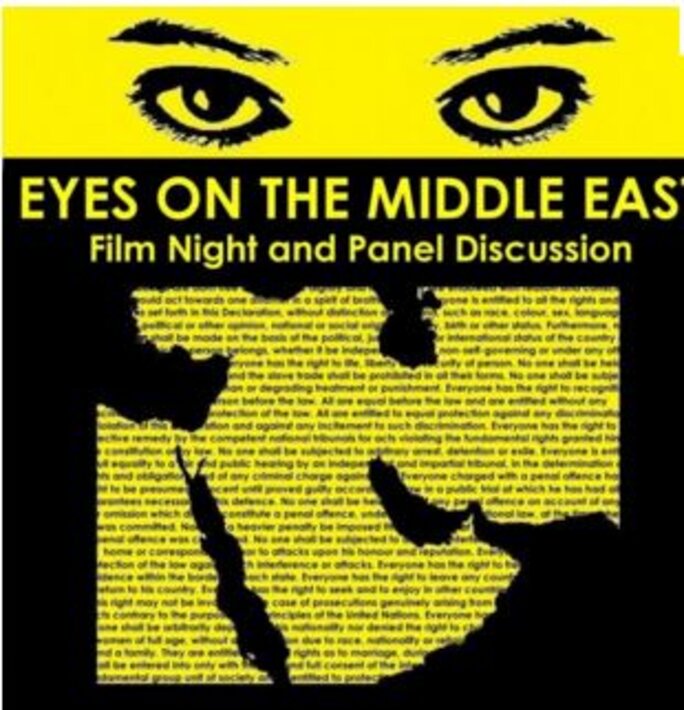
Procès inéquitables
De nombreux procès, dont certains ont abouti à une condamnation à mort, ont été manifestement iniques. Les accusés avaient le plus souvent été détenus avant leur procès pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, durant lesquels ils n’avaient eu que peu, ou pas du tout, la possibilité d'entrer en contact avec leur avocat ou leur famille. Ils avaient été contraints de rédiger ou de signer des « aveux », retenus comme principale preuve à charge dans une procédure inéquitable.
Liberté de religion et de conviction
Les membres de minorités religieuses – baha’is, soufis, yarsans (ou Gens de la vérité), musulmans convertis au christianisme, sunnites et musulmans chiites convertis au sunnisme, entre autres – ont continué d'être confrontés à la discrimination dans le domaine de l’emploi et à des restrictions à l’accès à l’éducation et à la liberté de pratiquer leur foi. Des informations ont fait état de l’arrestation et de l'incarcération de plusieurs dizaines de baha’is, de musulmans convertis au christianisme et de membres d’autres minorités religieuses, entre autres pour avoir dispensé des cours à des étudiants baha’is, à qui l’enseignement supérieur est interdit.
Cette année encore, les autorités ont détruit des lieux sacrés baha’is, sunnites et soufis, dont des cimetières et des lieux de culte.
En août, un tribunal révolutionnaire de Téhéran a déclaré Mohammad Ali Taheri coupable de « diffusion de la corruption sur terre » pour avoir fondé le groupe spirituel Erfan-e Halgheh, et l’a condamné à mort. Cet homme avait déjà été condamné en 2011 à cinq ans d’emprisonnement, 74 coups de fouet et une amende pour « outrage aux valeurs sacrées de l’islam »9. Des peines de prison ont aussi été prononcées contre plusieurs de ses disciples. En décembre, la Cour suprême a annulé sa condamnation pour « enquête insuffisante » et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance.
Droits des femmes
Les femmes ont continué d'être l'objet de discrimination, dans la législation – notamment en droit pénal et dans le droit de la famille – et en pratique (…) Les femmes et les filles n’étaient pas suffisamment protégées contre les violences, sexuelles et autres, telles que le mariage précoce et forcé. Les autorités n’ont adopté aucune loi érigeant en infractions pénales ces pratiques, pas plus que d'autres formes de violence telles que le viol conjugal et les violences au sein de la famille. Les lois sur le port obligatoire du voile (hijab) permettaient toujours à la police et aux forces paramilitaires de harceler les femmes, de leur infliger des violences et de les emprisonner.



