
Agrandissement : Illustration 1
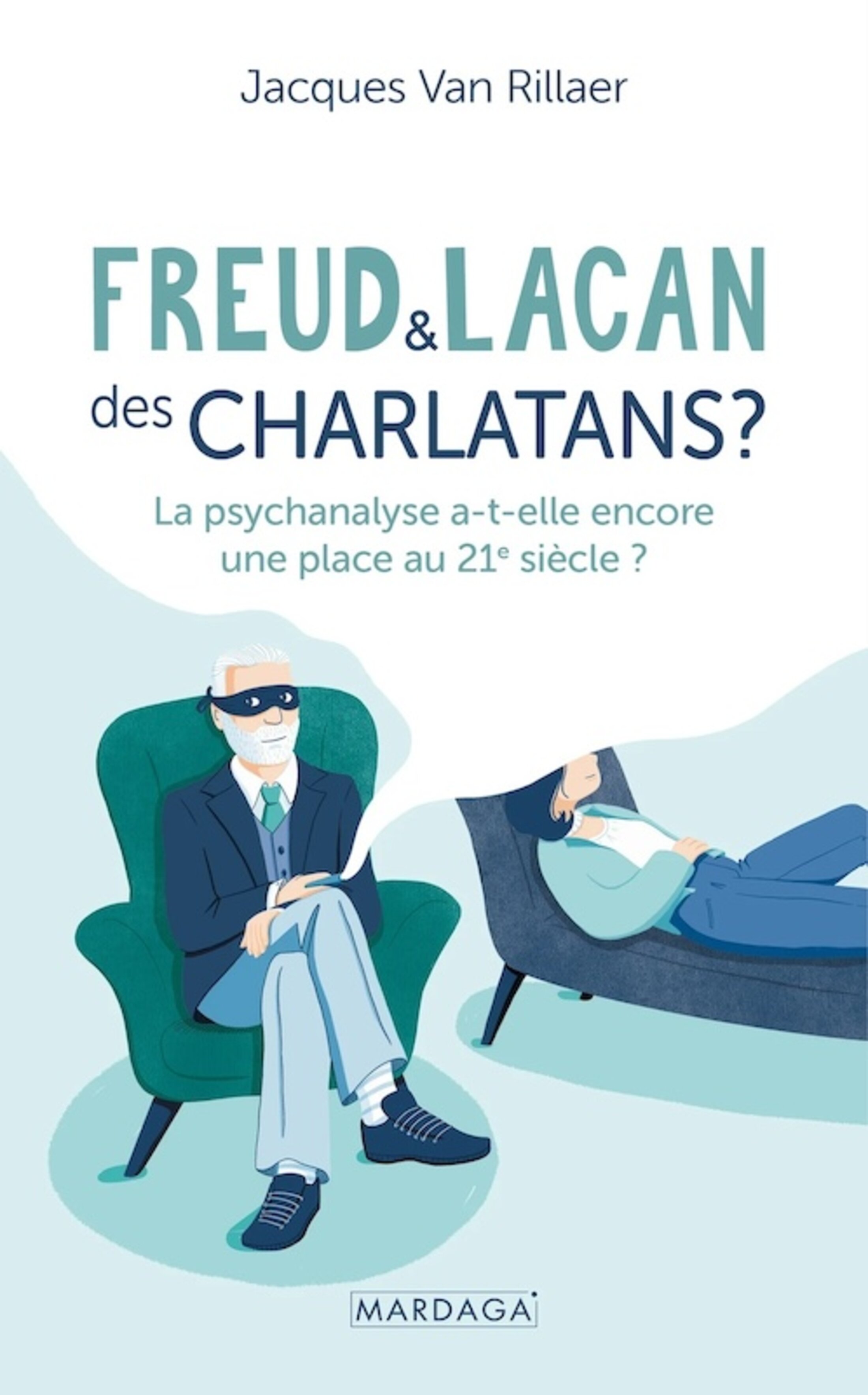
Freud compare son travail à celui d’un expert capable d’établir l’authenticité de tableaux par l’examen de détails comme les ongles ou les lobes de l’oreille. Il écrit que le psychanalyste est lui aussi apte à « deviner (erraten) des choses secrètes et cachées à partir d’éléments sous-estimés ou non observés » (X 185).
Pour « deviner » ce que l’analysé refoule, Freud utilise quatre clés : la mise en relation de paroles de l’analysé avec des événements passés (réels ou imaginés), le décodage symbolique, le décryptage par « pont verbal » et l’explication par le contraire.
a) La psychanalyse de Freud se spécifie par le renvoi incessant au passé: « Toute analyse de phénomènes psychologiques ne mérite pas le nom de psychanalyse. Celle-ci signifie davantage que le démontage de phénomènes composés en éléments plus simples ; elle consiste à ramener une formation psychique à d’autres qui l’ont précédé dans le temps et à partir desquelles elle s’est développée » (VIII 411).
Citons, parmi les innombrables exemples, que lorsque sa jeune patiente Dora dit qu’elle a été énurétique « vers sept ou huit ans pendant un certain temps », Freud en déduit illico qu’elle s’est alors masturbée, car « l’énurésie nocturne n’a pas de cause plus vraisemblable que la masturbation » (V 236). Notons que la patiente a nié énergiquement cette activité à cet âge, dénégation qui, pour Freud, prouve son interprétation.
b) Freud et Jung croient en l’existence de symboles dont la signification est universelle, fixée une fois pour toute. Ils pensent même que cette signification est transmise génétiquement. Par exemple, pour Freud, le serpent, dans les rêves ou en cas de phobie, symbolise le pénis : « Le serpent est, de tous les animaux, le symbole le plus significatif du membre masculin » (II 362) ; « Lorsque la peur naturelle de l’homme pour le serpent s’accroît de façon considérable, sa signification sexuelle devient évidente » (II 352, je souligne).
En réalité, le serpent peut symboliser bien d’autres choses qu’un pénis. Dans le caducée, symbole de la médecine, le serpent ou les serpents entrelacés représentent les poisons que connaît le médecin pour guérir. Dans la Bible, le serpent « le plus rusé de tous les animaux que Yahvé avait faits » représente le Diable, la séduction, la perfidie (Genèse, 3 :1).
Par ailleurs, la peur des serpents favorise la survie de l’espèce humaine et semble génétiquement préparée. Elle se développe très facilement chez les enfants dès l’âge de deux ans et apparaît spontanément chez les singes au même âge (Marks, p. 178). Cette peur est bien antérieure à la peur des pénis qui, elle, est nettement moins fréquente. Beaucoup d’adultes redoutent les serpents alors qu’ils ne craignent pas les pénis. Pourquoi diable la peur du symbole serait-elle plus fréquente et plus forte que la peur du signifié ?
Une large part du succès de la psychanalyse tient à la facilité de trouver des analogies pour soi-disant établir, à partir de quelques éléments, l’identité cachée de phénomènes. Le procédé suivant, encore plus facile, contribue également à son succès.
c) Le décodage par « pont verbal » (Passwort) ou « mot-pont » (Wort-Brücke) permet des interprétations à jet continu. Ainsi, quand l’Homme aux rats, célèbre patient de Freud, se trouvait trop gros (zu dick) et s’efforçait de maigrir, Freud y a vu le désir de tuer son rival appelé Richard et surnommé Dick : vouloir être moins dick c’est vouloir tuer Dick… inconsciemment (VII 411). Soulignons en passant la façon dont Freud publie ses observations. Dans ses notes, retrouvées après sa mort, il écrit à propos de cette interprétation : « Ceci est ma trouvaille et il ne sait pas l’apprécier » (1907-1908). Dans le texte destiné aux lecteurs, il affirme pourtant que c’est le patient qui a lui-même découvert cette signification !
L’interprétation par pont verbal implique que le trouble mental dépend de la langue du patient. Si l’Homme aux rats avait été francophone, le même trouble serait-il apparu ? On ne voit pas comment le désir d’être moins gros traduirait le désir d’agresser un rival surnommé Dick. Chez un francophone, le désir de tuer Richard-Dick aurait-il provoqué des « tics », d et t étant des dentales faciles à confondre ? Je laisse le lecteur imaginer d’autres jeux de mots et conclure.
Le décryptage par mot-pont a été abondamment exploité par Lacan, qui l’appelait « décomposition signifiante » et disait : « J’attache énormément d’importance aux jeux de mots. Cela me paraît la clé de la psychanalyse » (2005: 96). Selon sa « théorie de la suprématie du Signifiant sur le signifié », l’Inconscient est régi par les propriétés phonétiques des mots et non par les significations auxquelles les mots renvoient normalement ; les significations dépendent essentiellement des interrelations des mots en tant que mots. Dès lors, la pratique analytique s’apparente à un jeu de calembours, un jeu facile à la portée de tous et qui fonctionne à tous les coups. Si quelqu’un dit « ne me prenez pas au mot », il dit sans le savoir qu’il a peur d’être pris pour un homo…
Cette technique a permis à la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto des explications fulgurantes, par exemple des difficultés scolaires : « Le mot "lire” est un mot qui, pour certains enfants, éveille quelque chose de totalement tabou : c’est le "lit” conjugal des parents. Au moment où l’enfant est en train d’élaborer son interdit de l’inceste, le verbe du “lit” que leur paraît être le mot “lire” rend ce mot banni, et les activités qui entourent le fait de lire sont quelque chose qui le met dans un très grand trouble. […] De même le mot “écrire”, pour certains d’entre eux, signifie les cris qu’ils entendent entre les parents. Les mots de “lire” et “écrire”, pour certains enfants, sont des signifiants inconscients de l’union sexuelle dont on ne leur a pas clairement parlé et qui, à cause de cela, les empêche de dépasser le trouble que ces mots induisent dans leur vie imaginaire » (1989: 19, 38).
d) Freud a estimé très tôt que ce qui est manifeste est l’inverse de ce qui se joue dans l’inconscient. Ainsi, il écrit à son ami Wilhelm Fliess le 17-2-1896 : « L’agoraphobie chez les femmes, c’est le refoulement de l’intention d’aller chercher dans la rue le premier venu ». Dans L’interprétation du rêve, il formule cette clé comme ceci : « L’inversion (Umkerung), la transformation dans le contraire (Verwandlung ins Gegenteil), est un des moyens de représentation que le travail du rêve utilise le plus volontiers et à diverses fins. […] Elle est au service de la censure » (II 332).
Quand sa patiente Dora a rêvé que la maison brûle et que sa mère veut sauver sa boîte à bijoux (la boîte de la mère), Freud lui explique que dans ce rêve « absolument tout est transformé en son contraire » (V 231, je souligne) : le coffret n’est plus celui de sa mère, c’est le sien ; le coffret n’est d’ailleurs plus un coffret, mais représente l’organe génital féminin ; la tentative de sauver sa « boîte à bijoux » cache sa peur du désir de s’offrir à l’ami de son père qui tente de la séduire.
Une illustration de l’affirmation que le sens véritable de propos est le contraire de ce qui est énoncé se trouve dans les notes de Freud, retrouvées après sa mort, sur le cas de l’Homme aux rats : « Le patient est sûr de n’avoir jamais pensé qu’il pût souhaiter la mort de son père. Après ces paroles prononcées avec une vigueur accrue, je crois nécessaire de lui donner un fragment de la théorie. La théorie affirme que, puisque toute angoisse correspond à un ancien souhait refoulé, on doit supposer exactement le contraire. Il est certain aussi que l’inconscient est alors juste le contraire du conscient. Il est très ébranlé, très incrédule » (1907-1908, p. 77, je souligne).
Freud répétera sans cesse que « dans l’inconscient les opposés coïncident » (XII 113). Ainsi, « nous sommes redevables des plus beaux épanouissements de notre vie amoureuse à la réaction contre l’impulsion hostile que nous ressentons en notre for intérieur » (X 354) ; « La compassion est une formation réactionnelle contre la pulsion sadique » (X 222), formule par laquelle il explique son manque de compassion pour ses patients : « Après 41 ans de pratique médicale, ma connaissance de moi-même me dit que je n’ai pas vraiment été un vrai un médecin. […] De mes premières années, je n’ai pas connaissance d’un besoin d’aider des gens qui souffrent, ma prédisposition sadique n’était pas très grande de sorte que ses rejetons n’ont pas eu besoin de se développer » (XIV 290).
Cette clé interprétative vaut pour les actions : lorsqu’une jeune fille, en s’installant sur le divan, a tiré le bas de sa jupe sur sa cheville qui dépassait, Freud a vu d’emblée dans cette « action fortuite » (Zufallshandlung) « le penchant à l’exhibitionnisme » (VIII 472).
Le célèbre sexologue Havelock Ellis disait, avec raison, que Freud interprète selon le principe « Face je gagne, pile tu perds ».



