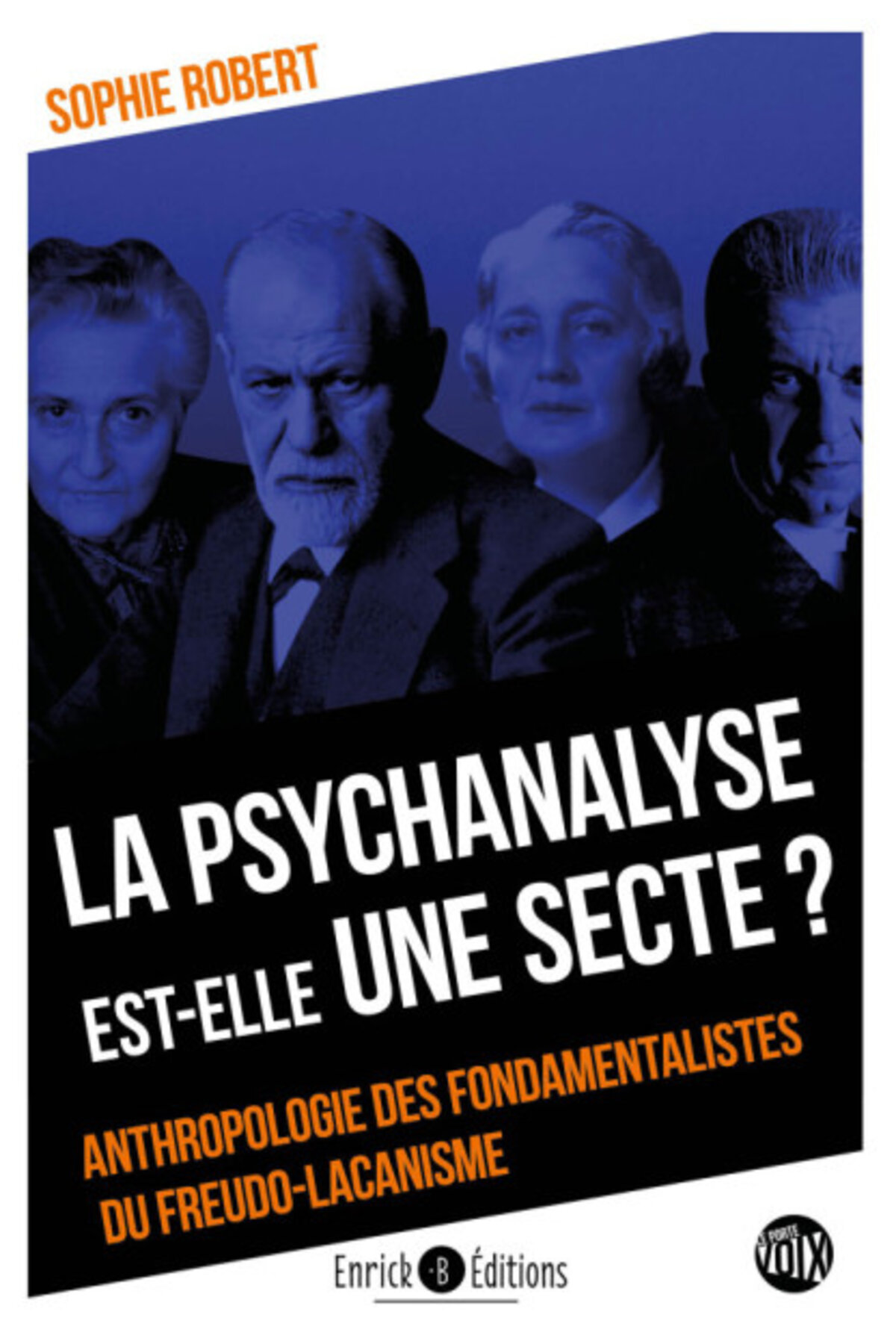
Agrandissement : Illustration 1
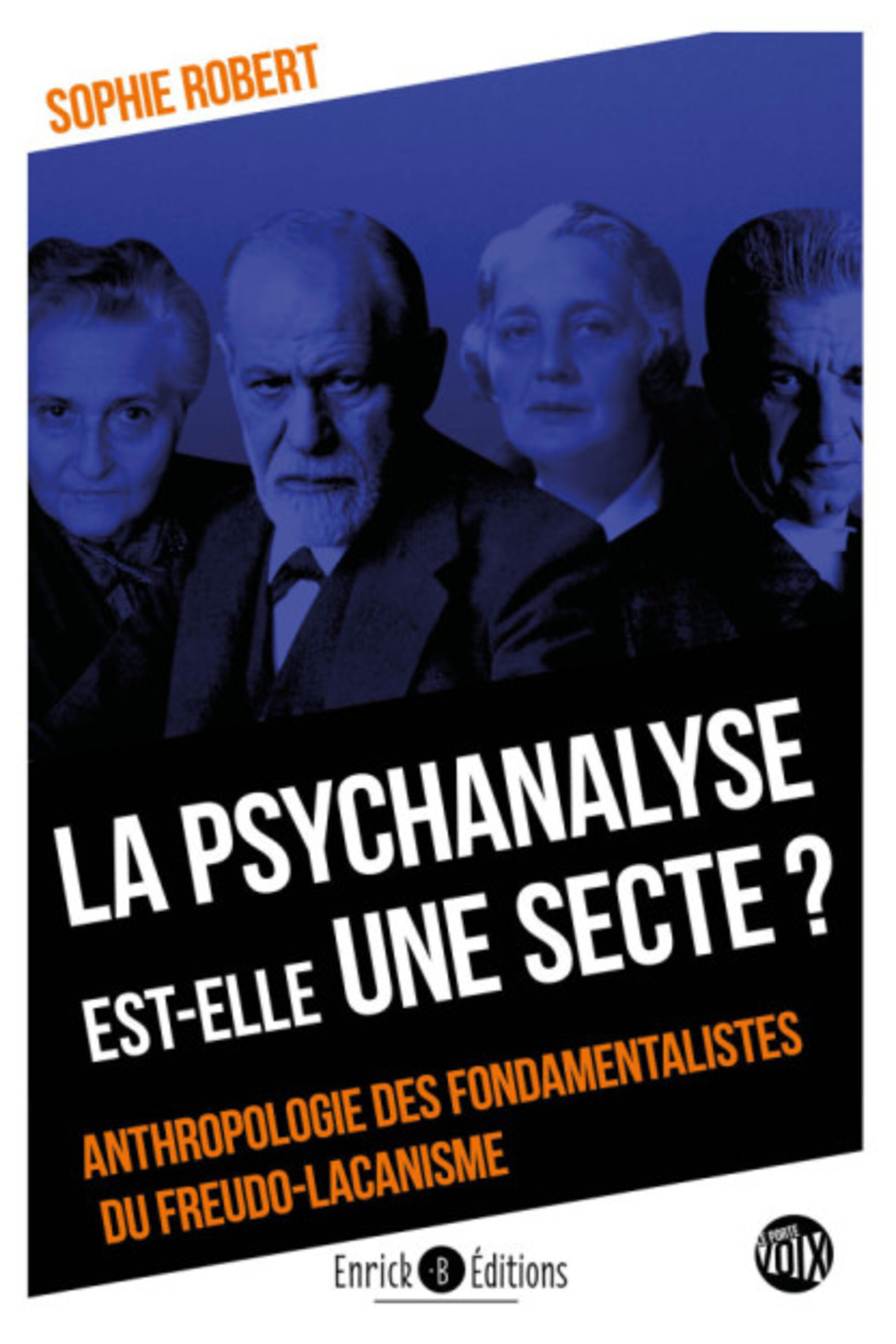
Jusqu’il y a peu d’années, l’existence du complexe d’Œdipe ne faisait guère de doute pour un Français ou un Belge francophone. Plusieurs événements ont fissuré cette croyance collective : Le Livre noir de la psychanalyse (2005) ; les documentaires Le Mur, la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme (2010) et Le Phallus et le Néant (2019) de Sophie Robert ; Le Crépuscule d’une idole (2010) de Michel Onfray. À présent, de plus en plus de personnes osent se demander si elles ont réellement désiré sexuellement le parent de sexe opposé.
Il faut préciser que la version freudienne du complexe d’Œdipe diffère radicalement de la version populaire. Ce n’est pas : « Le garçon voudrait se marier avec maman ». Freud, qui a vécu l’attirance sexuelle pour sa mère et la haine pour son père, affirmait l’universalité de ces deux sentiments chez les hommes. Il écrivait dans son dernier livre : « Quand le garçon (à partir de 2 ou 3 ans) est entré dans la phase phallique de son développement libidinal, reçoit de son membre sexué des sensations empreintes de plaisir et a appris à s'en procurer à son gré par une stimulation manuelle, il devient l'amant [Liebhaber] de la mère. Il souhaite la posséder corporellement dans les formes qu'il a devinées par ses observations de la vie sexuelle […]. Son père est maintenant le rival qui se trouve sur son chemin et dont il aimerait se débarrasser » [1].
Freud voyait dans cette « découverte » sa plus grande contribution : « J'ose dire que si la psychanalyse ne pouvait tirer gloire d'aucune autre réalisation que de celle de la mise à découvert du complexe d'Œdipe refoulé, cela seul lui permettrait de prétendre à être rangée parmi les acquisitions nouvelles et précieuses de l'humanité » [2]. Il croyait que cette découverte était la principale cause d’hostilité à son égard : « Rien d'autre n’a davantage nui à la psychanalyse dans la faveur des contemporains que la thèse du complexe d'Œdipe comme formation universellement humaine liée au destin » [3].
Les énoncés de Lacan sur l’Œdipe illustrent une stratégie typique de l’usage des concepts psychanalytiques : tantôt une acception large, recevable par le public, tantôt un sens restreint utilisé par les analystes. Version « soft » : « Le complexe d’Œdipe n’est pas réductible à une situation réelle, à l’influence effectivement exercée sur l’enfant par le couple parental. Il tire son efficacité de ce qu’il fait intervenir une instance interdictrice qui barre l’accès à la satisfaction naturellement cherchée et lie inséparablement le désir et la loi » [4]. Version « hard » : « Le rapport sexuel, il n'y en a pas, mais cela ne va pas de soi. Il n'y en a pas, sauf incestueux. C'est très exactement ça qu'a avancé Freud — il n'y en a pas, sauf incestueux, ou meurtrier. Le mythe d'Œdipe désigne ceci, que la seule personne avec laquelle on ait envie de coucher, c'est sa mère, et que pour le père, on le tue » [5].
Vous doutez de l’universalité de l’Œdipe parce que vous n’avez pas envie de « coucher avec votre mère » ? L’analyste a le choix de la réplique : « Vous “résistez” à reconnaître vos pulsions inconscientes » ou « Vous prenez les choses au pied de la lettre alors que la psychanalyse a changé ».
Quand vous critiquez un énoncé psychanalytique, on vous sert l’argument freudien classique : il s’agit d’un contenu « inconscient » que seuls les analystes connaissent. L’autre technique consiste à dire que la théorie a évolué. À vrai dire, les théories des autres analystes — Adler, Jung, Reich, Ferenczi, Rank, Klein, les néo-freudiens, Lacan, les néo-lacaniens et alii — sont toutes aussi « irréfutables » et non scientifiques que celle du Père-fondateur. Toutes utilisent les mêmes techniques d’interprétation : le renvoi à des événements réels ou imaginés du passé, le décodage symbolique, le jeu de mot, l’explication par le contraire. Toutes utilisent les mêmes procédés d’immunisation : l’affirmation que tout contradicteur « résiste » ou est « névrosé ».
Il y a évidemment des processus inconscients. Il en est question depuis l’Antiquité [6]. Ils sont un des principaux objets d’étude de la psychologie scientifique. Toutefois l’inconscient imaginé par Freud n’en est qu’une des multiples formulations. Parlant de l’inconscient « freudien », Lacan a reconnu tout à la fin de sa vie : « L’inconscient est peut-être un délire freudien. L'inconscient ça explique tout mais, comme l'a bien articulé un nommé Karl Popper, ça explique trop. C'est une conjecture qui ne peut avoir de réfutation » [7].
L’absence de critère objectif de la validité des interprétations a donné lieu à une multiplicité d’Écoles. Dès lors la vérité doctrinale de chacune d’elles se fonde sur l’autorité du Maître et le consensus du groupe. Il en résulte que ces Écoles sont comparables à des sectes : organisations fermées, caractérisées par une haute vénération du Sachant, initiation personnelle coûteuse, étude assidue de textes canoniques et leur commentaire ad infinitum, diffusion de légendes, excommunication des hérétiques, immunisation contre toute critique.
Sophie Robert a réalisé un formidable travail de documentariste. Elle a investigué la théorie et les mœurs des lacaniens, la plus obscurantiste et charlatanesque des « sectes » psychanalytiques. Elle l’a payé très cher. Elle raconte ici son aventure, qu’elle complète par une analyse des noyaux durs du freudisme et du lacanisme.
[1] Abrégé de psychanalyse (1939) Œuvres complètes, PUF, 2010, XX 283s.
[2] Ibidem, p. 287.
[3] La question de l’analyse profane (1926) Œuvres complètes, PUF, 2006, XVIII 37
[4] Laplanche J. & Pontalis J.-B. (1967) Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, p. 83.
[5] L'escroquerie psychanalytique. Ornicar? Bulletin périodique du champ freudien, 1979, 17 : 9s.
[6] Ellenberger, H. (1974) Histoire de la découverte de l'inconscient. Fayard, 1994, 1016 p.
[7] Lettres de l'École, n°25, Bulletin intérieur de l'École freudienne de Paris, volume II, La Transmission, juin 1979.



