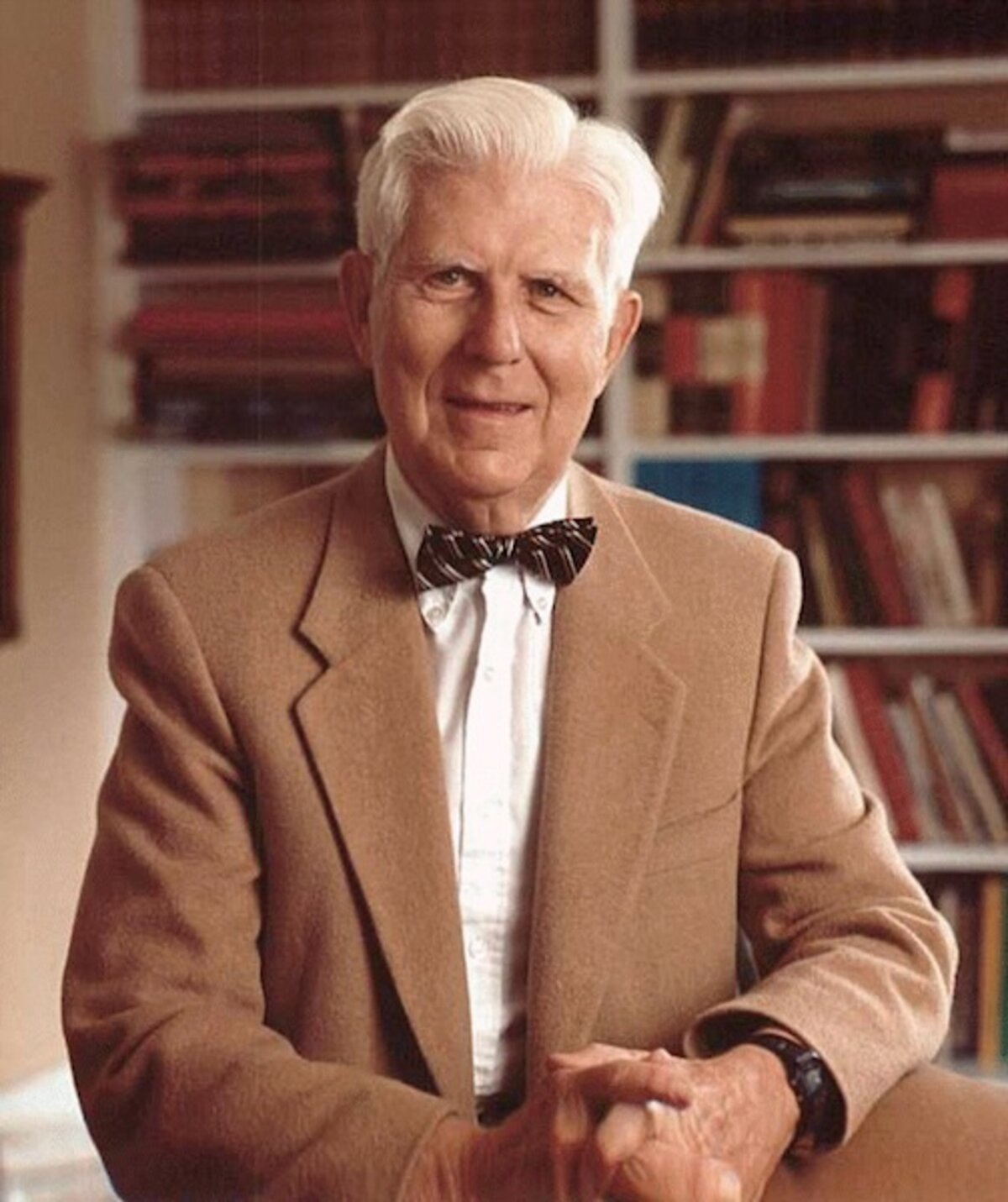
Agrandissement : Illustration 1
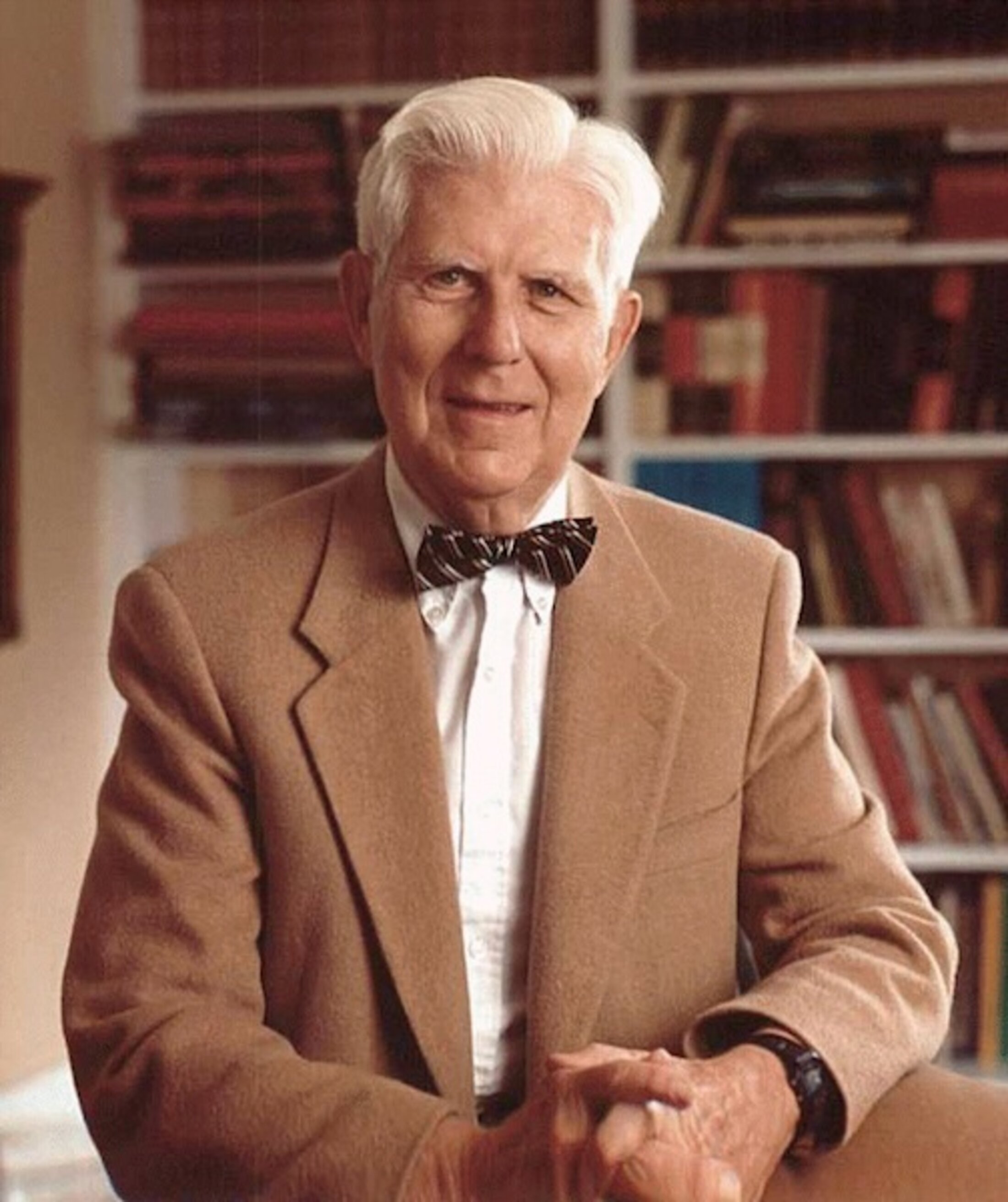
Le principe de la thérapie freudienne
Pour Freud, le principe essentiel de la psychothérapie est une forme particulière d’« analyse » : expliquer des phénomènes psychiques (rêves, actes manqués, symptômes) par des processus inconscients (souvenirs ou fantasmes refoulés, désirs réprimés) que seul l’analyste freudien peut décoder. Il écrit : « Chaque fois que nous sommes en présence d'un symptôme, nous pouvons en conclure qu'il existe chez le malade des processus inconscients déterminés qui justement contiennent le sens du symptôme. À partir de processus conscients il ne se forme pas de symptômes. Dès que les processus inconscients en question sont devenus conscients, le symptôme doit disparaître » [1]
En cas de non-amélioration, Freud pense qu’il faut analyser plus « profondément ». Il évoque aussi un second principe : le transfert (le report sur l’analyste de sentiments éprouvés pour une personne du passé) doit être positif : « Si le
transfert négatif prend le dessus, les succès sont balayés comme fétus de paille au vent. On constate avec effroi que toute la peine et le travail dépensés jusque-là ont été vains » [2].
Le principe de l’analyse freudienne
Freud utilise essentiellement trois techniques :
- a) Le décodage symbolique d’un élément de rêve ou d’un symptôme. Selon Freud, le serpent est de tous les animaux celui qui symbolise le mieux le pénis et la peur intense des serpents est « en réalité » la peur du pénis [3].
- b) Le décryptage de « mots-ponts » (Wort-Brücke). P.ex. l'Homme aux rats se dit un jour qu'il est trop gros (zu dick) et essaie de maigrir. Interprétation de Freud : son rival s'appelle Richard et est parfois appelé Dick. En essayant d'être moins « dick », l'Homme aux rats tue « inconsciemment » son concurrent [4]. Ce type de décodage a été abondamment utilisé par Lacan, qui l’appelait « décomposition signifiante » et disait : « J’attache énormément d’importance aux jeux de mots. Cela me paraît la clé de la psychanalyse » [5].
- c) La technique des « associations libres », le procédé herméneutique le plus original de Freud. Le patient est invité à dire tout ce qui lui passe par la tête et l’analyste attire son attention sur des éléments qu’il juge significatifs. L’analyste invite à associer à partir de ces éléments ou décode directement le sens inconscient. Ainsi, Dora rêve d’une ville, puis de sa maison… son père est mort… elle va à la gare, puis voit une épaisse forêt… elle rentre à la maison en voiture, etc. [6]. De l’ensemble du récit du rêve, Freud fait ressortir un mot et un symbole. Dora a parlé d’une gare. Or, raisonne Freud, c’est un endroit qui sert au « Verkehr », mot signifiant à la fois trafic et commerce sexuel. D’autre part, Dora a rêvé d’une épaisse forêt, symbole évident, selon Freud, des poils pubiens. « Donc » Dora a fait un rêve à contenu sexuel. À noter que ces interprétations sont toutes des idées de Freud et que Dora éprouve beaucoup de résistance à les accepter. Mais la résistance est, pour Freud, la preuve de la justesse de son interprétation. Après l’interprétation de ce rêve, Dora ne viendra plus qu’à une séance, question d’annoncer qu’elle interrompt le traitement. Freud y verra la preuve d’un « transfert négatif » : à travers lui c’est un autre que Dora agresse. Le psychanalyste a toujours le dernier mot.
Pour en savoir plus sur cette analyse époustouflante : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2821
Une nouvelle écoute des patients
Beck (né en 1921) est le fils de Juifs ukrainiens émigrés aux E.U. Il est diplômé psychiatre de l’université de Yale (1953) et a été certifié psychanalyste de l’Institut Psychanalytique de Philadelphie en 1956. Il a fait toute sa carrière comme professeur de psychiatrie à l’université de Pennsylvanie et il y a fondé un institut de thérapie cognitive.
Le point de départ de son éloignement de la psychanalyse se situe en 1956. Il écoutait les « associations libres » d’un patient en analyse. Le patient le critiquait, éprouvait de la colère et lui dit ensuite qu’il se sentait culpabilisé. Beck entendit simplement une succession de deux émotions, la seconde étant la conséquence de la précédente. Le patient ajouta alors que, pendant qu’il avait énoncé ses critiques, il avait pensé : « J’ai dit ce qu’il ne fallait pas dire… je n’aurais pas dû dire ça… j’ai tort de le critiquer. Je suis mauvais… je n’ai pas d’excuse à être aussi méprisable » [7]. Il y avait donc eu deux courants de pensée parallèles : un courant conversationnel, à l’intention de l’analyste, et un courant de communication avec soi-même. Chez ce patient, la culpabilité n’apparaissait plus comme une conséquence automatique de la colère, mais comme un effet de pensées non énoncées.
À la suite de cette observation, Beck eu l’idée de demander à d’autres personnes en analyse d’expliciter et d’énoncer ce second flux de cognitions. Des patients rapportèrent que ce langage intérieur se produisait également dans d’autres interactions. En fait, les humains se parlent constamment à eux-mêmes et parlent différemment aux autres. Durant les séances de psychanalyse, les patients n’accordent pas beaucoup plus d’attention à ce langage intérieur qu’ils ne le font dans la vie quotidienne. Cette communication interne est automatique, fugitive, sans attention consciente. Elle a des fonctions d’auto-surveillance, d’auto-avertissement, d’auto-instruction, d’autocritique, d’auto-gratifications. Elle est utile, mais joue aussi de très mauvais tours. Elle est la source de beaucoup de troubles psychologiques. Beck a constaté qu’en la rendant davantage consciente et en l’analysant, il aidait ses patients à résoudre de nombreuses difficultés et cela bien plus rapidement qu’en se contentant d’analyser l’énoncé d’associations libres.
Les personnes déprimées pensent négativement
En examinant la façon dont pensent les personnes déprimées, Beck a constaté : « La négativité de la dépression imprégnait les communications internes des patients, telles que l’autoévaluation, les attributions, les attentes, les déductions et la mémoire, et se manifestait dans une faible estime de soi, une auto-responsabilisation et une autocritique, des prédictions négatives, des interprétations négatives des expériences et des souvenirs désagréables. […] Je notai aussi une variété d’erreurs dans la pensée dépressive des patients, que j’intitulai abstraction sélective, surgénéralisation, pensée dichotomique et exagération des aspects négatifs de leurs expériences. Bien plus, je remarquai que les patients déprimés avaient tendance à prédire des résultats négatifs spécifiques aux tâches spécifiques qu’ils pouvaient entreprendre et n’attendaient en général de leur vie à long terme que des résultats négatifs » [8].
Réfutation de la théorie freudienne de la dépression
Les personnes déprimées manifestent peu d’agressivité envers les autres. Freud en a déduit, en ce qui concerne les personnes endeuillées, qu’elles éprouvent de l’agressivité envers « l’objet perdu » et que cette agressivité est retournée contre elles-mêmes [9]. D’autre part, selon une autre de ses théories, l’agressivité réprimée se libère dans des rêves.
À partir des années 1950, les tentatives de validation empirique de conceptions freudiennes se sont multipliées aux Etats-Unis. Beck a mené des recherches de ce type notamment sur les rêves des déprimés. Il a constaté que, dans leurs rêves, les déprimés ne sont guère agressifs, mais sont souvent victimes d’événements pénibles. « En général, ils tendaient à se percevoir comme des “perdants” dans tous les sens du terme : ils perdaient quelque chose qui avait une grande valeur, ils étaient vaincus, déficients, en quelque sorte mis en dehors de la société » [10]. Par d’autres recherches, il en est venu à réfuter que ces rêves expriment des désir masochistes et a conclu : « Le contenu manifeste des rêves, au lieu d’être l’expression d’un besoin profondément ancré pour la punition ou l’hostilité inversée, ne reflète que la façon dont les patients se perçoivent eux-mêmes et perçoivent leurs expériences » [11]. Plus généralement, Beck estime que les rêves sont davantage le reflet de nos préoccupations que l’expression masquée d’un désir qui remonte à l’enfance.
Sur la validité et l’utilité de l’interprétation des rêves, voir : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2617
Le manque de fiabilité des diagnostics psychopathologiques (1967)
Beck a reconnu s’être inspiré de publications d’Albert Ellis, un autre déconverti de la psychanalyse [12]. Il s’en distingue toutefois par une carrière académique et de nombreuses recherches méthodiques visant à améliorer la scientificité de la psychopathologie. Il a examiné par exemple le degré de concordance de diagnostics psychologiques émis par différents thérapeutes sur les mêmes patients. À l’époque, le Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM) en était à sa 1ère édition et ses concepts étaient très largement de nature psychanalytique. Beck et ses collaborateurs ont demandé à quatre psychiatres d’un hôpital universitaire de diagnostiquer 153 patients. L’accord n’a été que de 70% pour la distinction entre psychose et névrose, et encore beaucoup plus faible pour toutes les autres catégories (p.ex. 38% d’accord pour « trouble de la personnalité ») [13]. Cette recherche a, parmi d’autres, montré l’importance de définir de façon précise et consensuelle des catégories de la psychopathologie pour la pratique clinique et surtout pour la recherche.
Sur cette question, voir : http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2025
Modifier activement la façon de penser
Le travail de l’analyste freudien revient à induire un transfert positif et à attribuer des significations inconscientes — « freudiennes » — à des symptômes : « Vous avez une phobie des serpents ? vous avez un problème sexuel, vous avez inconsciemment peur des pénis ». Cela suffit, en principe, à les faire disparaître les symptômes. Beck a constaté la faible efficacité de ce procédé en comparaison à celui qu’il a mis au point : (a) l’identification de « pensées automatiques », (b) l’analyse des processus de pensée en jeu, (c) la modification active de schémas de pensée névrotisants, dépressiogèns, autodestructeurs. Certes, les façons de penser sont déterminées par des expériences passées [14], le manque de formation épistémologique, des facteurs génétiques et biologiques, mais « la reconstruction d’expériences de l’enfance et l’interprétation de conflits inconscients ne sont pas nécessaires » [15]. Certains processus cognitifs constituent des déterminants essentiels des troubles cognitifs et affectifs. On peut les modifier consciemment et méthodiquement, de manière à changer la façon habituelle d’interpréter des événements, de ressentir et d’agir. Cela ne se fait pas facilement, c’est un « travail » qui demande beaucoup de répétitions et s’avère parfois très laborieux.
Les séances de thérapie sont structurées : il s’agit de se focaliser sur les problèmes importants, d’analyser des processus cognitifs, de formuler des tâches hors séances (homeworks assignmets), etc., plutôt que de bavarder sur n’importe quoi ou de faire des « associations libres » à l’infini. Ce travail se fait dans un climat de collaboration. Beck parle d’ « empirisme collaboratif ».
Citons quelques processus, que Beck a mis en évidence dans la façon de penser des déprimés, et qui lui sont ensuite apparus évidents dans d’autres troubles.
- L’abstraction sélective : focalisation sur un ou quelques éléments, en faisant abstraction de leur contexte, de leur fréquence ou de leur évolution. P.ex., ruminer une parole d’un partenaire jugée blessante en négligeant d’autres propos et sa propre contribution à ce comportement.
- La personnalisation : interprétation centrée sur soi. La personne se croit, à tort, visée par un comportement d'autrui. P.ex. en arrivant à une soirée, elle voit quelqu'un sourire et en déduit illico qu'« on » la trouve ridicule. Ce type d'inférence est particulièrement fréquent chez les individus très attentifs à ce que les autres pensent d'eux.
- La surgénéralisation : généralisation outrancière ou fallacieuse de l’apparition d’un événement. P.ex., l’employé critiqué par deux collègues pense : « personne ne m’aime, tout le monde me déteste ».
- La dichotomisation (pensée en tout ou rien) : évaluation en fonction de deux catégories diamétralement opposées (bon/mauvais, blanc/noir, vrai/faux, etc.), sans envisager des degrés intermédiaires. P.ex., penser : « Il critique toutes mes propositions » au lieu de : « il critique environ cinq de mes propositions sur dix ». Se dire, après une prestation, « j’ai été nul » au lieu de « j’ai fait un six sur dix ».
- La catastrophisation : amplification du désagrément ou du danger que présente un événement. Ce type d'inférence se caractérise par l'utilisation d'un langage emphatique : on qualifie de « terrible, scandaleux, horrible, totalement insupportable » une situation qu'on aurait intérêt à définir comme « pénible, frustrante, irritante, moche, regrettable ».
Expérimenter méthodiquement de nouvelles actions
Beck a souligné l’importance de l’action dès le début de sa prise de distance à l’égard de la psychanalyse. Il écrit : « Au milieu des années 1960, je me familiarisai avec la thérapie comportementale et en intégrai de nombreux principes. […] J’appliquai le concept de résolution de problèmes à toutes les difficultés des patients — qu’il s’agisse d’un problème dans leur façon de penser (c’est-à-dire les distorsions cognitives), d’autres symptômes dépressifs (un manque d’énergie, de la tristesse, des envies suicidaires), ou des “problèmes externes” au travail ou à la maison. Par exemple, une stratégie comportementale spécifique, intitulée “assignation d’une tâche graduée”, fut utilisée pour aider les patients à maîtriser leurs sentiments d’absence d’énergie, d’anhédonie et leur désir de rester inactif. Comme les patients franchissaient avec succès une étape orientée vers un but, ils étaient encouragés à franchir l’étape suivante qui était plus difficile. Les buts de chaque tâche, les étapes spécifiques pour atteindre ces buts, la provision pour le feed-back et les critères pour la réalisation du but étaient tous définis d’avance » [16].
La thérapie cognitive pour de nombreux troubles
Beck a développé un manuel pour le traitement des dépressions [17] qui a permis de réaliser des recherches méthodiques, notamment sur l’efficacité comparée de sa psychothérapie et de traitements pharmacologiques. De nombreuses recherches montrent que, pour les dépressions légères et modérées, la thérapie cognitive est aussi efficace que des antidépresseurs et que les rechutes sont moins nombreuses avec elle [18]. Beck a progressivement développé les principes de son approche pour d’autres troubles. Déjà en 1976, dans le livre fondateur de sa méthode, il présente un traitement des troubles anxieux [19]. Son ouvrage principal sur ces troubles est Anxiety disorders and phobias [20]. Il a publié — généralement avec des collaborateurs — des ouvrages majeurs les addictions [21], les troubles de la personnalité [22], la colère et la violence [23], les mésententes conjugales, les hallucinations [24], la schizophrénie [25]. Partout il insiste sur l’importance de l’action pour modifier « en profondeur » les processus et schémas cognitifs. Il écrit p.ex. dans son excellent Love is never enough : « Une fois que vous décidez d'essayer de changer, vous pouvez vous demander par quels changements il vaut mieux commencer: les structures cognitives ou les actions ? Lorsque je reçois un couple en thérapie, je me concentre d'abord sur leurs actions. Il est beaucoup plus facile de changer des actions concrètes ou d'inciter à de nouvelles actions, que de changer des structures de pensée. Bien souvent, lorsque les actions changent effectivement, elles sont rapidement suivies d'une gratification, telle que la reconnaissance par le partenaire de la capacité de faire quelque chose d'agréable ou de faire cesser un désagrément » [26].
La conception de Beck illustre parfaitement cette pensée de Goethe : “Penser et agir, agir et penser, c'est la somme de toute sagesse [...]. L'un et l'autre doivent éternellement alterner leur effet dans la vie comme l'inspiration et l'expiration. Il faut soumettre l'action à l’épreuve de la pensée et la pensée à l’épreuve de l’action” [27].
Les citations de Freud sont extraites des Œuvres complètes, traduites aux PUF. Le 1er nombre indique le tome, le 2e la page.
[1] Leçons d’introduction à la psychanalyse (1917) XIV 289.
[2] Abrégé de psychanalyse (1938/1940) XX, 269
[3] L’interprétation du rêve (1900) IV 403, 392
[4] Freud écrit dans son carnet de notes découvert après sa mort : « Ceci est ma trouvaille et il ne sait pas l'apprécier ». Dans le texte destiné aux lecteurs, il affirme que le patient a lui-même découvert cette signification ! Pour les citations et les références, voir J. Van Rillaer, Les illusions de la psychanalyse. Mardaga, 1981 (4e éd., 1996), p.132s.
[5] Le Triomphe de la religion. Seuil, 2005, p.96.
[6] Fragment d’une analyse d’hystérie (1905) VI 273
[7] Beck, A. (2005) La thérapie cognitive de la dépression : Histoire d'une découverte. In Meyer, C. et al., Le Livre noir de la psychanalyse. Les Arènes, p. 705.
[8] Ibidem, p. 709.
[9] “Deuil et mélancolie” (1917) XIII, 261-280.
[10] Beck, A. (2005) Op. cit., p. 710.
[11] Ibidem, p. 712.
[12] Beck, A. (2005) The current state of cognitive therapy. A 40-year retrospective. Archives of General Psychiatry, 62 : 953.
Sur Ellis, sa déconversion et sa thérapie cognitive :
[13] Beck, A. et al. (1967) Reliability of psychiatric diagnoses. 2: A study of consistency of clinical judgments and ratings. American Journal of Psychiatry, 119 : 351-357.
[14] Une recherche de Beck a montré que les déprimés, par rapport à des non-déprimés, ont deux fois plus souvent perdu un parent durant l’enfance.
[15] Beck, A. (2005), Op. cit., p. 714.
[16] Ibidem, p. 715.
[17] Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. & Emery, G. (1979) Cognitive therapy of depression. Guilford, 425 p.
[18] Parmi les nombreuses recherches similaires : DeRubeis, R. et al. (2005) Cognitive therapy vs medications in the treatment of moderate to severe depression. Archives of General Psychiatry, 62: 409-416.
[19] Beck, A. (1976) Cognitive therapy and the emotional disorders. Trad., La thérapie cognitive et les troubles émotionnels. De Boeck, 2010, 296 p.
[20] Beck, A. T. & Emery, G. (2005) Anxiety disorders and phobias : A cognitive perspective. Basic Books, 384 p. (1ère version: 1985).
[21] Beck, A., Wright, F.D., Newman, C.F. & Liese, B.S. (1993) Cognitive therapy of substance abuse. Guilford, 345 p.
[22] Beck, A., Freeman, A. & Davis, D.D. & (2003) Cognitive therapy of personality disorders. Guilford, 2e éd., 412 p. (1ère éd., 1990).
[23] Beck, A. (1999) Prisoners of hate : The Cognitive basis of anger, hostility and violence. HarperCollins, 368 p.
[24] Alford, B.A. & Beck, A. (1994) Cognitive therapy of delusional beliefs. Behaviour Research and Therapy, 32: 369-380.
[25] Beck, A., Rector, N., Stolar, N., Grant, P. (2008) Schizophrenia : Cognitive Theory, Research, and Therapy. Guilford, 418 p.
[26] Beck, A. (1988) Love is never enough. Harper & Row. Rééd., Penguin Books, 1989, p.162.
[27] Les Années de voyage. Trad. in Goethe, Romans. Pléiade, II, 9, p.1208. Cit. in P. Hadot (2008) N’oublie pas de vivre. Goethe et la tradition des exercices spirituels. Albin Michel, p. 271.
Pour d’autres déconvertis du freudisme et du lacanisme, voir le film de Sophie Robert: http://www.dailymotion.com/video/x37mnmz
Deux sites pour d’autres publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, l'épistémologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.
1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique: www.pseudo-sciences.org
2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve



