Les recherches de Semmelweis illustrent des démarches essentielles de la recherche scientifique. Elles illustrent le deux types de démarches : simplement observer des relations entre des variables ou expérimenter en manipulant une variable dite « indépendante » et se dire : « si on fait A, on devrait observer B, toutes choses étant égales par ailleurs ». La simple observation est illustrée par la vérification des hypothèses 1 à 3. L’expérimentation est illustrée par la vérification des hypothèses 4, 5, 6 et 8).
* * *
Le médecin hongrois, Ignace Semmelweis (1818-1865), a réalisé des recherches sur la fièvre puerpérale, appelée aussi « fièvre des accouchées ». Il s’agit d’une infection consécutive à un accouchement. Elle est causée par des bactéries qui pénètrent l'utérus et provoquent un forte fièvre. Elle peut évoluer en une grave septicémie qui se termine par la mort. Autrefois une cause majeure de mortalité, elle est devenue rare dans les pays développés, mais reste un problème majeur dans les pays en développement.
Semmelweiss a réalisé ses travaux à l'hôpital général de Vienne de 1844 à 1848. Dans cet hôpital il y avait deux services d'obstétrique. Dans le sien, 8,2 % des accouchées moururent en 1844 ; 6,4 % en 1845 et 11,4 % en 1845.
Dans l'autre service d'obstétrique, qui accueillait autant de femmes que le premier, la mortalité due à la fièvre puerpérale était nettement plus faible : 2,3 % en 1844 ; 2 % en 1845 et 2,7 % en 1845.
1) Semmelweiss commença par examiner des explications qui avaient cours à l'époque. Une opinion répandue imputait les ravages de la fièvre puerpérale à des « influences épidémiques », décrites comme des « changements atmosphériques, cosmiques ou telluriques »
Semmelweiss se disait que ces influences ne pouvaient pas, année après année, atteindre son service et pas l’autre. De plus, la maladie qui sévissait dans l’hôpital était beaucoup moins fréquente dans les environs. Les cas de fièvre puerpérale de femmes ayant accouché avant d’arriver à l’hôpital étaient moins nombreux que dans son service.
2) Une autre explication était que l'entassement à l’hôpital était une cause d’épidémie. À bien faire le décompte, l'entassement était plus grand dans le second service, car l’information sur la différence de mortalité entre les deux services avait circulé et les femmes s’efforçaient à tout prix d’éviter celui de Semmelweiss !
3) Une autre hypothèse était le régime alimentaire. Elle fut rapidement écartée, car les femmes étaient nourries de la même façon dans les deux services.
4) En 1846, une commission d’enquête attribua la cause du plus grand nombre de cas dans la premier service aux blessures que des étudiants en médecine auraient infligées aux femmes en les examinant maladroitement. Semmelweis réfuta cette thèse pour trois raisons : a) les lésions occasionnées par l'accouchement sont bien plus fortes que celles qu’un examen maladroit peut causer ; b) les sages-femmes examinaient les patientes de la même façon que les étudiants en médecine ; c) quand, à la suite du rapport de la Commission, on diminua de moitié le nombre des étudiants en médecine et qu'on réduisit au minimum Ies examens qu'ils faisaient sur les femmes, la mortalité, après une brève chute, atteignit une augmentation jusqu'alors inconnue.
5) On avait échafaudé une explication psychologique. Dans le service de Semmelweis, le prêtre apportant les derniers sacrements à une mourante devait traverser cinq salles avant d'atteindre Ia pièce réservée aux malades: Ia vue du prêtre, précédé d'un servant agitant une clochette, avait un effet terrifiant. Dans le second service, le prêtre accédait directement aux mourantes. Semmelweis convainquit le prêtre de faire un détour pour se rendre dans la salle des malades sans être vu. La mortalité ne diminua pas.
6) Semmelweis constata une différence dans la position lors de l’accouchement : chez lui les femmes accouchaient sur le dos et dans le second service sur le côté. Bien que cette supposition lui parût peu vraisemblable, il fit adopter la position latérale. La mortalité ne fut pas modifiée.
7) Finalement, au début de 1847, un accident fournit à Semmelweis l'indice décisif. Un de ses confrères, Kolletschka, lors d'une autopsie pratiquée avec un étudiant, eut le doigt profondément entaillé par le scalpel de ce dernier et mourut après une maladie très douloureuse, au cours de laquelle il eut les mêmes symptômes que ceux que Semmelweis avait observés chez les femmes atteintes de Ia fièvre puerpérale.
Bien que le rôle des microorganismes dans les affections de ce genre ne fût pas encore, Semmelweis comprit que la « matière cadavérique » introduite dans le sang de Kolletschka avait causé la maladie fatale de son confrère.
La maladie de Kolletschka et celle des femmes de son service évoluant de la même façon, Semmelweis conclut que ses patientes étaient mortes du même genre d'empoisonnement du sang : lui, ses confrères et les étudiants en médecine avaient été les vecteurs de l'élément responsable de l'infection. Car lui et ses assistants avaient l'habitude d'entrer dans les salles d'accouchement après avoir fait des dissections dans l'amphithéâtre d'anatomie et d'examiner les femmes en travail en ne s'étant lavé que superficiellement les mains, si bien qu'elles gardaient souvent une odeur caractéristique.
8) Semmelweis mit alors son idée à l’épreuve. Il raisonna ainsi : si l’hypothèse est correcte, la fièvre puerpérale pourrait être évitée en détruisant chimiquement l’élément infectieux qui adhérait aux mains. À partir de mai 1847, il interdit aux étudiants en médecine de quitter les salles de dissection sans s’être lavé les mains avec une solution de chlorure de chaux avant d'examiner une patiente. La mortalité due à Ia fièvre puerpérale baissa rapidement : en 1848, elle tomba à 1,24 % dans son service contre 1,33 dans le second. L’antisepsie venait de voir le jour.
Une confirmation supplémentaire de l’hypothèse de Semmelweis était qu’elle rendait compte du fait que la mortalité dans le second service avait toujours été nettement inférieure. Les patientes étaient entre les mains de sages-femmes dont la formation ne comportait pas la dissection de cadavres.
9) D'autres expériences cliniques conduisirent bientôt Semmelweis à élargir son hypothèse. Une fois, lui et ses assistants, après s'être désinfectés soigneusement les mains, examinèrent la première une femme en travail, qui souffrait d'un cancer purulent du col de l'utérus. Puis ils examinèrent douze autres femmes dans la même salle, après seulement un lavage de routine, sans nouvelle désinfection. Onze des douze patientes moururent de Ia fièvre puerpérale. Semmelweis en conclut que l’infection peut être causée, non seulement par la matière cadavérique, mais aussi par une « matière putride provenant d’organismes vivants ».
Adapté de Carl Hempel (1966) Éléments d’épistémologie. Trad., 1972, Amand Colin, p. 8-10.
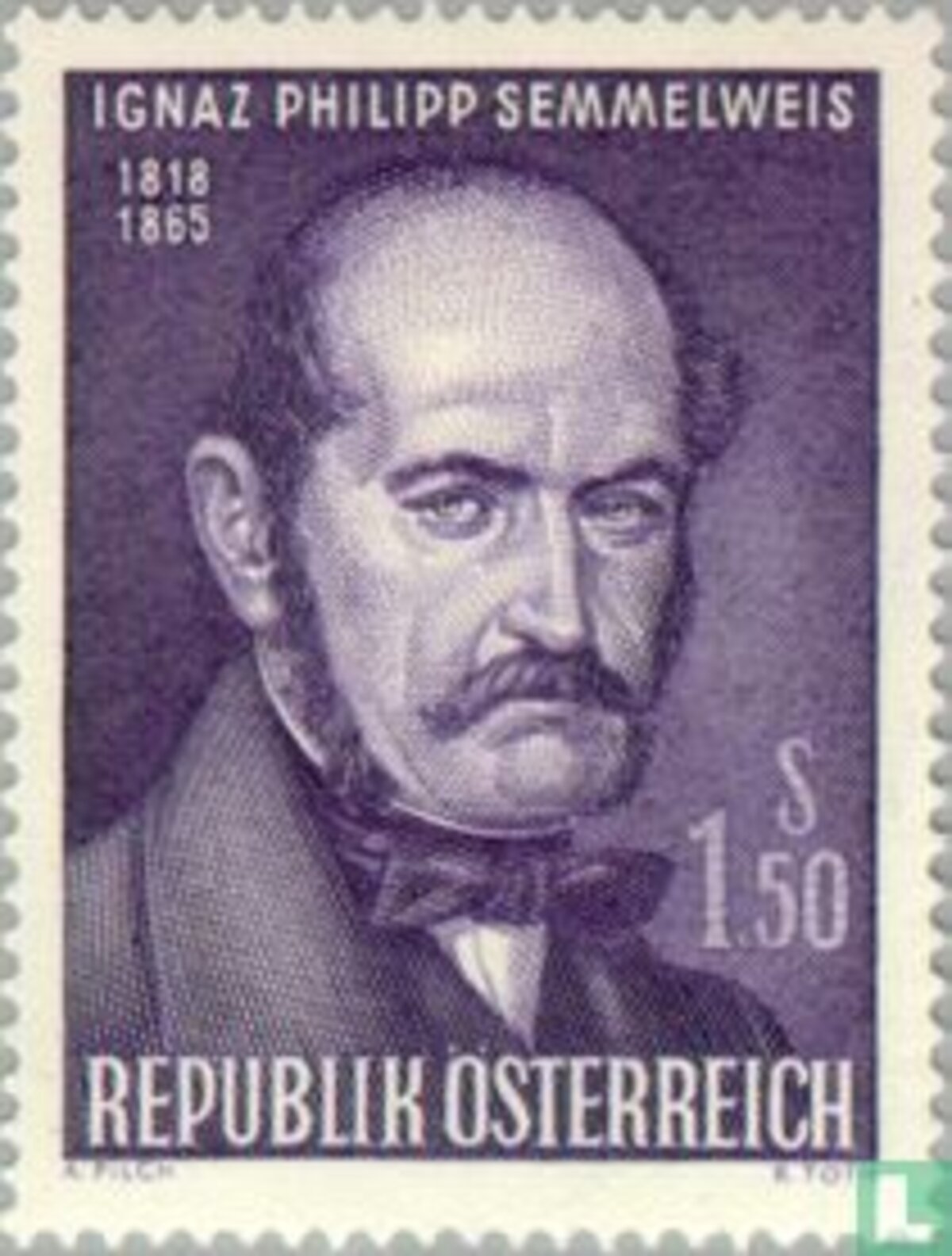
Leçons méthodologiques
1) L’importance de groupes comparables
Dans l’hôpital de Semmelweiss, il y avait deux groupes « naturels » largement semblables.
Dans d’autres recherches, il faut constituer deux groupes. Ces groupes sont alors en tous points comparables sauf pour une variable dont on veut connaître l’impact.
Dans la situation de Semmelweiss, les femmes se retrouvaient aléatoirement dans un des deux services. Il fallait trouver la variable qui les différenciaient.
2) L’importance de la quantification précise et de statistiques. Sans elles, Semmelweiss ne se serait probablement pas mis à rechercher la variable cruciale qui différenciait les deux groupes.
3) L’importance du hasard dans la découverte. Toutefois, comme disait Pasteur, « le hasard ne favorise que les esprits préparés ».
* * *
Le destin tragique du docteur Semmelweis
Extrait de Pierre Darmon (1999) L’homme et les microbes. Fayard, p. 102-103.
Lorsque la mortalité tombe à 1,24 %, Semmelweis alerte la communauté scientifique' En France, ses observations sont publiées dans les Annales d'hygiène et dans La Gazette médicale de Strasbourg. À Londres, il fait paraître un article intitulé “On the causes of the endemic puerperal Fewer of Vienna”. La presse médicale allemande est aussi saisie de l’affaire. Semmelweiss est comparé à Jenner. Il semble triompher. C'est sans compter sur la rancune.
Le professeur Klein, directeur de la maternité, est un personnage médiocre. Il a été blessé dans sa vanité. Ulcéré par le succès de son assistant qui vient de donner une célébrité mondiale aux lacunes de son service, il décide d’attaquer. Il a le bras long et l'oreille du ministre dont il obtient la dissolution d'une commission d'enquête. Semmelweis a été nommé assistant chez lui pour une durée de deux ans. Le délai expiré, il devrait, selon l'usage, obtenir une prolongation. Klein s'y oppose et, le 20 mars 1849, Semmelweis est licencié.
L’homme qui était sur le point de sauver des milliers de vies se retrouve au chômage. Dans son livre La Pratique des accouchements, le Dr Varnier écrira : « Ce sera l'éternelle honte du professeur Klein d'avoir arrêté l'essor de Semmelweis et reculé ainsi de vingt ans au moins l'un des plus grands progrès de ce siècle. »
Et Klein n'est pas seul responsable. Kiwish, le plus célèbre accoucheur de Prague, a fait deux fois le voyage de Vienne pour étudier la question et s'est aveuglément montré hostile à Semmelweis.
La communauté scientifique, un instant secouée, retombe en léthargie. Malheureux et aigri, Semmelweis quitte Vienne et retourne dans sa Hongrie natale. En mai 1851, il y est nommé médecin en chef non salarié d'une maternité à moitié désaffectée. Pendant six ans, sa méthode y fait merveille. Sur 933 accouchées, il ne perd que 8 femmes, soit une mortalité par fièvre puerpérale de 0,85 %.
Aigri, lacéré par le chagrin, Semmelweis finit par adresser des lettres publiques d'injures à plusieurs accoucheurs dont Spaeth et Siebold qui, pris de remords vingt ans plus tard, auront à cœur de le réhabiliter. Il les traite d'aveugles, d'ignares, d'assassins. Puis, sombrant dans l'autoaccusation délirante, il se reproche d'avoir échoué dans sa mission. En 1865, au cours d'une autopsie, il se pique avec un scalpel, comme son ami Kolletschka jadis. Accident? Suicide? Il mourra quelques jours plus tard, à l'âge de 47 ans de cette même septicémie qu'il avait combattue jusqu'à la folie.
Dans les annales de la médecine, l'histoire de Semmelweis restera comme la plus pitoyable. Mais alors même qu'il se mourait de chagrin, un homme commençait à faire parler de lui en France et dans le monde : Louis Pasteur.



