Maurice Maschino, professeur de philosophie dans un lycée et reporter pour Le Monde diplomatique a fait une psychanalyse à Paris au début des années 1980, chez une lacanienne. Il précise que cela s’est bien passé « puisque j’en suis sorti indemne : ni fou ni suicidé. Sans symptômes rédhibitoires. Et sans avoir attrapé, dans l’épreuve, ce que François George appelle la “névrose psychanalysante” ». Toutefois, il a rapidement été gêné par le silence de sa psychanalyste et les interprétations à partir de « Signifiants », qui lui paraissent « le langage de l’imposture ». Lorsqu’il dit : « je l’ai prise au mot », l’analyste réplique : « Moi j’entends homo ». Maschino ajoute : « Comme dans vélo elle entendra pédale, dans modèle, que j’attends un mot d’elle » (p. 21).
L’idée d’entreprendre une enquête lui est venue du comportement d’analysés qu’il fréquentait : « Ce fut d'abord le spectacle désolant — et le verbalisme insupportable — d'un grand nombre d'amis ou de connaissances qui poursuivaient une analyse. Il se trouve que par la force des choses, de mes activités (enseignant, journaliste), de ma situation sociale, je suis davantage en contact avec des intellectuels qu’avec des ouvriers. Or qui dit intellectuel, aujourd’hui (et à Paris), dit : qui est en analyse, l'a été ou s’apprête à y retourner — l’analyse s'est substituée à la thèse (comme elle, interminable). Ce qui ne serait qu'un moindre mal, si la chose restait discrète. Si elle se faisait comme on fait l’amour : sans prévenir tout le quartier. La plupart des allongés, hélas, donnent volontiers dans l’exhibitionnisme. Analysé devient un titre, comme agrégé, et se porte aussi bien que la Légion d'honneur ou la médaille du mérite agricole : beaucoup le mentionnent dans les petites annonces du Nouvel Observateur ou de Elle : “J. F., 25 ans, analysée, cherche...” » (p. 25).
Maschino a publié une annonce dans des journaux pour rencontrer des personnes en analyse ou qui ont été analysées. Il voulait savoir pourquoi tant de gens prennent un jour rendez-vous avec un analyste, ce qu’ils vivent durant la cure et dans quel état ils en sortent. Il put ainsi interviewer 100 personnes. Il interviewa aussi 18 analystes. A leur sujet, il écrit : « Peu drôles dans l’ensemble, mais affables, ils furent, en général, d’un commerce intéressant ».
Le résultat de l’enquête est publiée dans “Votre désir m'intéresse. Enquête sur la pratique psychanalytique” (Hachette, 1982, 254 p.).
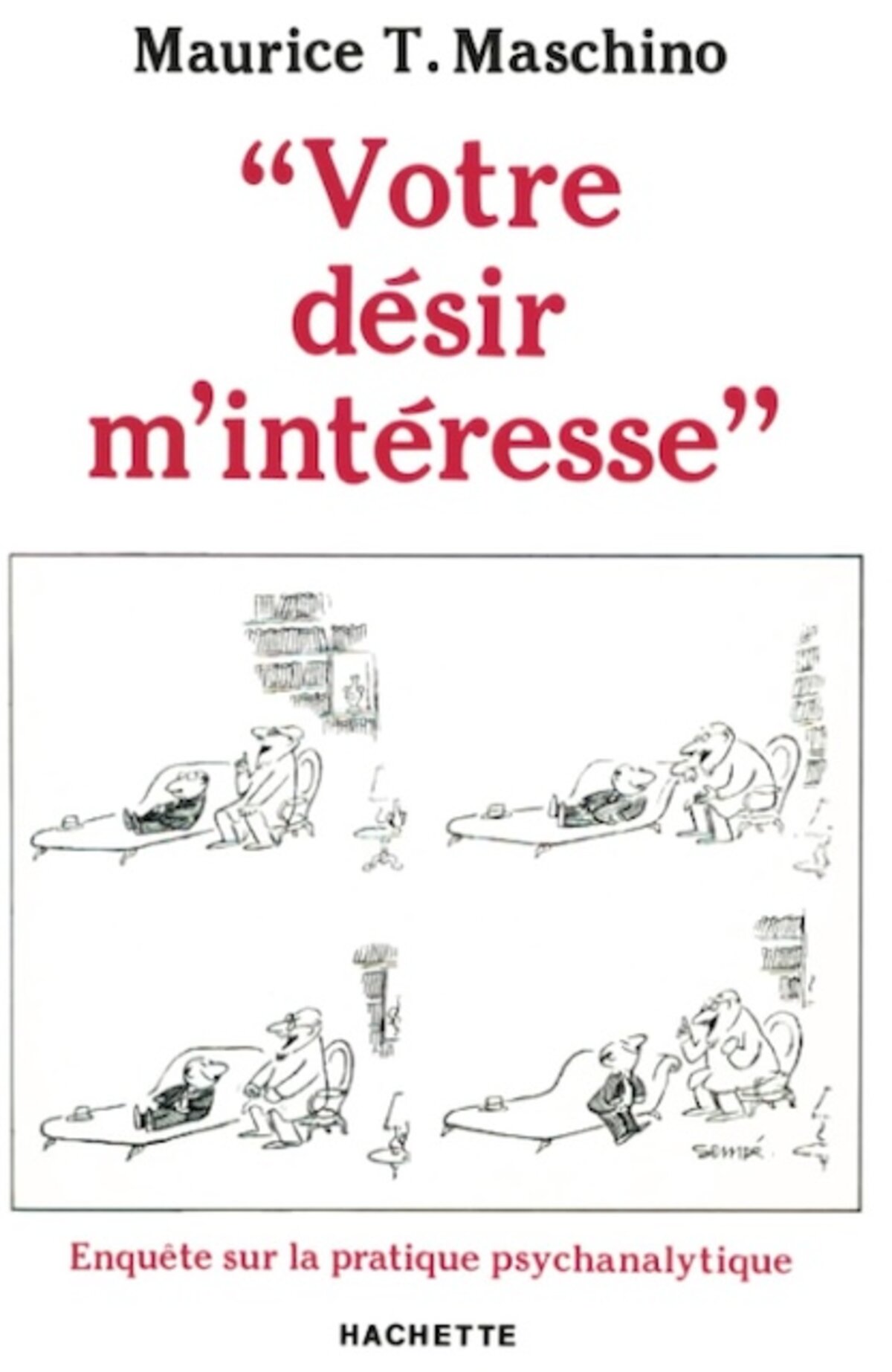
Agrandissement : Illustration 1
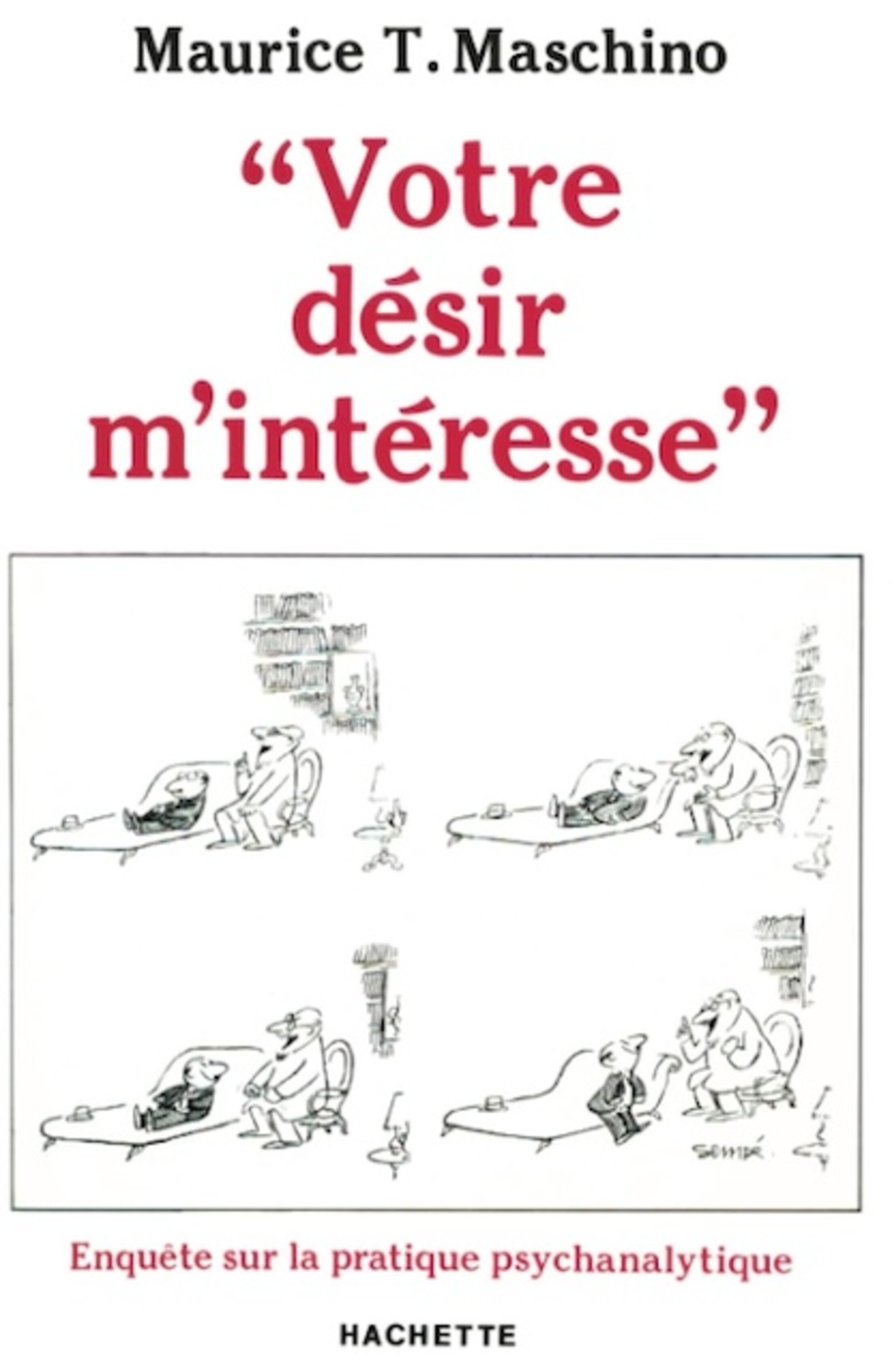
Beaucoup de gens entrent en analyse après un choc affectif, un deuil, un échec sentimental, un « mal-être », une déprime. Un grand nombre a des problèmes existentiels qui, selon la formule de Thomas Szasz, sont transformés en maladies mentales. « Ils demandent à l’analyse ce qu’on demandait autrefois à la religion : une consolation (“Il (elle) m’écoute et me comprend” et l’espoir d’une rédemption (“renaître”, faire peau neuve) ».
« Le bénéfice principal est surtout d’ordre intellectuel : au niveau de la représentation — on “comprend” mieux (on croit mieux comprendre) pourquoi on a des angoisses, des phobies ou des manies, mais on les a toujours ». Beaucoup disent qu’ils ont changé en mieux, mais éprouvent souvent des difficultés à préciser de quelle façon.
Parmi les changements : une plus grande indifférence à l’égard d’autrui, une dépolitisation, l’auto-acceptation (« qui prend facilement une forme d’insupportable suffisance »), le pédantisme.
Pour quelques-uns, la psychanalyse est désormais au centre de leur vie.
Ainsi, « Didier menait une existence qu'il jugeait “vide”, l’analyse l'a remplie. Il ne s'analyse pas pour mieux vivre, il vit pour s'analyser. L'analyse pour l’analyse, comme l'art pour l’art. Tout ce qu'il investissait ailleurs (dans le yoga, abandonné, dans ses efforts de promotion professionnelle, “dérisoires”), il l’investit dans la situation analytique. Son “mysticisme” s'est moins perdu que déplacé. Comme sa dépendance, qui, des autres, s'est reportée sur l’analyse. Il y trouve une “chaleur”, une “sécurité” qu'il ne connaissait pas. Il s'est réfugié là, semble-t-il, comme dans une crèche. Ou un couvent. Il a trouvé un lieu où rêver. Heureux ? Il le dit, et son regard brille quand il le dit. Convaincu qu'il ne fera jamais son deuil de l’analyse, il caresse avec émotion l'idée de devenir un jour analyste : “Pourquoi pas ?” » (p. 81).
Maschino note que pour qu'une analyse soit gratifiante, il faut beaucoup y investir, s’y adonner comme à un art ou s’y donner comme à une religion.
A l’autre bout des bilans, des déçus ou très déçus et, parmi eux, certains continuent toutefois dans l’espoir d’un résultat. Ainsi Hubert : « Il ne paraît pas aigri. Simplement, il récuse “une technique” qui ne lui convient pas : “L’association libre a aggravé ma tendance à théoriser. Je passais mon temps à chercher des coïncidences, ou plutôt, à transformer des coïncidences en causalité, des hasards en nécessité. Tels les hommes d'autrefois, qui interprétaient les phénomènes naturels comme autant de manifestations divines, je voyais dans tout ce qui m’arrivait autant de messages de mon inconscient. J'ai construit un discours — un délire — et m'y suis enfermé ; d’ailleurs, mon analyste m'a reproché de faire de la science-fiction” » (p. 159).
Pour Maschino, une grande nocivité de l’analyse est le rétrécissement du champ des intérêts, en particulier des réalités sociales et politiques
L’analyse de Maschino porte essentiellement sur la pratique lacanienne de la psychanalyse en milieu parisien. Il faut ici rappeler que Lacan a servi de modèle pour une pratique devenue de plus en plus singulière au fil des ans. A litre d’illustration, ce témoignage d’une patiente du Maître : « “La salle d'attente était toujours bourrée. De 7 heures à 19 heures. On ne se parlait pas. On attendait que Lacan apparaisse et, d’un signe, désigne le suivant. On ne passait pas par ordre d’arrivée, quelques-uns attendaient des heures, si bien qu’au moindre bruit, tous les visages, anxieux, se tournaient vers la porte… Parfois, quand on était entré, il la laissait ouverte. Ça m'est arrivé. La fermer, c'était le contenu de la séance. On repartait aussitôt.” Trente secondes, une, deux minutes — ou quatre : Justine ne restait jamais plus longtemps. “Mais, dit-elle, toujours séduite par le discours du maître, le temps ne compte pas. Ce qu'on dit de plus vrai, c’est au début. Une phrase peut suffire. Et puis, le temps de la séance, ce n’est pas seulement celui qu'on passe sur le divan : la séance commence dès la porte d’entrée, quand on sonne, et l’attente n'est pas un temps mort, il se passe quelque chose.” À la limite, la séance est… interminable, puisque l’analysant y pense continuellement : “Deux heures avant d'y aller, j'en rêvais. Comme d’un rendez-vous d'amour” » (p. 83).
Maschino a interrogé des analystes sur leur métier. À titre d’exemple, il a demandé ce qu’est « le bon analyste ». Les réponses ont été décevantes. Plusieurs analystes ont évoqué la question du savoir de l’analyste : « Est mauvais analyste, disent-ils, “celui qui donne dans le dogmatisme. Toute personne qui prétend savoir. Le bon analyste se trouve, devant chaque analysant, comme s'il ne savait rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit rien savoir”. Réponse typiquement “analytique” : comme toute institution, elle est de l’ordre du comme si. C'est-à-dire de l'artifice. Ou l’analyste ne sait rien (hypothèse qu'ils excluent tous, évidemment), ou il croit savoir ; dès lors, cette croyance oriente son attitude, détermine le cours de ses réflexions et le sens de ses questions. On ne dépose pas ses schèmes culturels comme on enlève ses lunettes pour regarder autrui ou le monde d'un œil neuf (on risque alors de loucher ou de ne rien voir) » (p. 231).



