Des explications de réactions affectives et de comportements par la théorie de l’évolution remontent à Darwin, et notamment à son livre sur les émotions : The expression of the emotions in man and animals (Londres, 1872). Toutefois, la psychologie et la psychiatrie évolutionnaires ne se sont bien développées qu’un siècle plus tard. Des œuvres marquantes sont Sociobiology: The New Synthesis d’Edward Wilson (Harvard University Press, 1975) et The Adaptad Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture (Oxford University Press, 1992) de Jerome Barkow, Leda Cosmides et John Tooby.
Ces disciplines ont suscité des critiques, notamment une des plus fondamentales faite aussi envers la psychanalyse : la facilité d’explications grâce à l’invocation de processus simplement inférés et l’absence de preuves expérimentales. Dans le cas des explications évolutionnaires, on a parlé de raisonnement « panglossien » : le fait de remonter le fil d’une idée vers la cause qu’on souhaite prouver. (Pangloss — un personnage du Candide de Voltaire (1759) — expliquait n’importe quel fait par une finalité avantageuse puisque le monde a été créé comme le meilleur possible. Ainsi, « les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes »).
Randolph Nesse a écrit un livre extrêmement intéressant sur ce thème parce qu’il est prudent, nuancé, très bien documenté, parfaitement lisible et rempli de réflexions qui ont leur utilité pour le psychothérapeute mais aussi pour tout lecteur. Il est remarquablement traduit par Peggy Sastre, dont la thèse de doctorat portait précisément sur Darwin [1].
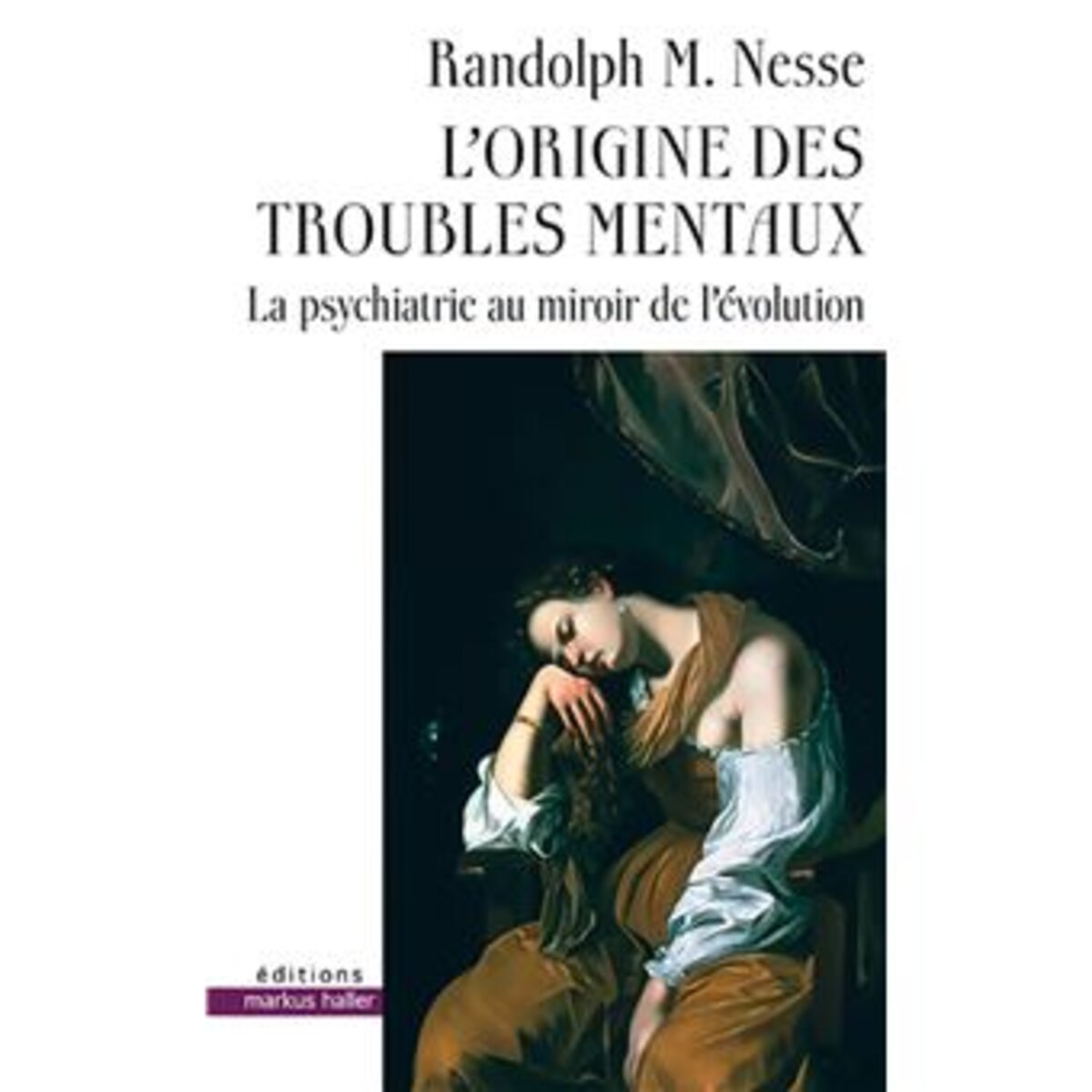
On peut noter que le titre français ne correspond pas au titre original : Good reasons for bad feelings (New York, Penguin Random House, 2019). Le titre français L’origine des troubles mentaux fait spontanément penser à des explications en fonction de circonstances et de l’enfance. En fait, comme le précise le sous-titre en français — La psychiatrie au miroir de l’évolution —, il s’agit d’un essai de psychiatrie évolutionnaire. Ed. Markus Haller, Genève, 2021, 464 p.
L’auteur est psychiatre, praticien, chercheur et professeur à l’université du Michigan. Il propose des réponses aux questions : la sélection naturelle peut-elle expliquer des maladies mentales ? Pourquoi sommes-nous vulnérables ? Y a-t-il « de bonnes raisons aux mauvais sentiments » ?
Tous les scientifiques admettent aujourd’hui la théorie darwinienne de l’évolution et considèrent les mutations et la sélection naturelle comme des mécanismes centraux. (Il existe toutefois des phénomènes de dérive génétique : des gènes continuent à être transmis alors qu’ils n’ont pas d’utilité).
La sélection fonctionne de telle façon que, dans un environnement donné, les corps et les comportements instinctifs maximisent le nombre de descendants capables de se reproduire à leur tour. Les variations génétiques des individus ayant le plus d’enfants deviennent plus fréquentes dans les générations ultérieures. Les variations génétiques des individus qui se reproduisent moins se raréfient. Par exemple, les becs et les langues des pics-verts varient légèrement selon les individus. Ceux qui extraient le plus efficacement les insectes des arbres sont mieux nourris et font plus d’oisillons. Ce processus a façonné des becs tranchants, capables de percer rapidement le bois des arbres, et de longues langues agiles qui y débusquent les insectes.
La sélection naturelle a abouti à des mécanismes physiologiques extrêmement utiles : la fièvre est une réaction permettant de lutter contre les infections, la diarrhée élimine des toxines et des infections du tube digestif, la toux élimine les corps étrangers des voies respiratoires, la douleur est un signal d’alarme sans lequel nous ne ferions pas de vieux os.
Tous les gènes n’ont pas que des avantages. Ainsi, ceux qui permettent une guérison rapide des fractures osseuses durant l’enfance causent à un âge avancé la calcification des artères coronaires et finissent par tuer beaucoup de personnes âgées.
La sélection naturelle a façonné les extraordinaires capacités du cerveau. Toutefois, notre façon de penser a de nombreux points faibles. « Si l’esprit avait été le fruit d’une volonté, écrit Nesse, nous pourrions nous demander si ses défaillances résultent de l’incompétence, de la négligence ou de la malveillance de son concepteur. Mais l’esprit n’est pas une machine. Il n’y a pas d’ingénieur. Il n’y a jamais eu de plan directeur » (p. 55).
Les maladies ne sont pas des adaptations façonnées par la sélection naturelle. Elles résultent de traits, qui rendent vulnérables à certaines maladies, et de l’inadaption de notre programmation génétique aux environnements modernes. L’envie de sucre est adaptative dans un environnement où les aliments riches en sucre sont rares. Aujourd’hui en Occident, cette envie peut conduire à de graves problèmes d’obésité et de diabète. On accède facilement à des cigarettes et à de l’alcool bon marché. Il n’est pas très compliqué de trouver des drogues et des seringues. La plupart de nos maladies sont favorisées par l’environnement actuel.
Parmi les traits transmis, beaucoup ont à la fois des avantages et des inconvénients. C’est vrai autant pour des caractéristiques corporelles (le poignet pourrait être plus épais et plus solide, mais il serait moins mobile) que pour des réactions psychologiques. Les impulsions sexuelles favorisent la transmission de gènes, mais elles conduisent régulièrement à des situaions catastrophiques pour des individus.
Nesse passe en revue les principaux affects et divers troubles mentaux. Il montre que beaucoup de réactions causent des souffrances à des individus, mais protègent globalement contre de graves dégâts et favorisent le succès reproductif. La sélection naturelle n’a que faire du bonheur de chacun de nous.
L’anxiété et la jalousie à titre d’exemples d’affects
L’anxiété est un affect qui nous concerne tous, régulièrement, à différents degrés. Ce mécanisme alerte d’un danger. Il fonctionne comme un détecteur de fumée : il signale parfois à tort (« faux positifs »), mais il est fondamentalement indispensable. Les personnes qui éprouvent très peu d’anxiété en cas de situations dangereuses ne font pas de vieux os. Le manque de vertige augmente la probabilité de chute fatale.
La sélection favorise souvent un niveau intermédiaire de réactions affectives. Illustrations de Nesse : « Tous les lapins ne sont pas également téméraires. Les lapins exceptionnellement audacieux terminent dans les estomacs des renards. Les lapins timides fuient si vite qu’ils ont à peine le temps de se sustenter. Les lapins aux niveaux d’anxiété intermédiaires font davantage de lapereaux et leurs gènes deviennent donc plus courants. […] Certains individus sont récompensés par des Darwin Awards [2] pour avoir fait des trucs stupides ayant eu raison de leur personne et de leurs gènes. […] D’autres ont peur de quitter leur maison. Ils ne meurent pas jeunes, mais n’ont pas beaucoup d’enfants non plus. Les personnes ayant un degré d’anxiété plus modéré ont plus d’enfants, ce qui fait que nous sommes une majorité à nous situer au milieu de l’échelle de la prudence » (p. 27).
La jalousie est un sentiment qui, lorsqu’il est intense, a souvent des effets désastreux. Shakespeare l’appelait « le monstre aux yeux verts ». Toutefois, à un degré intermédiaire, la jalousie est globalement favorable à la transmission de gènes. Les hommes peu jaloux ont tendance à avoir peu d’enfants.
Dans les années 1960, plusieurs communautés ont essayé d’éradiquer la jalousie. Les membres prônaient l’amour libre. Ils partaient du principe que la jalousie est une convention sociale, qu’il est possible de déconstruire. En définitive, la jalousie repoussait comme une mauvaise herbe. Quasi aucune de ces communautés n’a survécu.
L’aptitude à ressentir les émotions est un produit de la sélection que nous partageons avec de nombreuses espèces. Toutefois la culture joue sur ces réactions comme elle influence le poids, la tension artérielle et une grande part de l’existence humaine. La culture peut intensifier et atténuer des réactions affectives, mais peut très difficilement les faire totalement disparaître. La compréhension de notre héritage phylogénétique nous aide à dédramatiser et à accepter des émotions pénibles et des « mauvais sentiments ». Fort heureusement, cet héritage nous permet aussi de réguler des impulsions dévastatrices, de réduire des douleurs et de soigner des maladies.
La dépresion comme exemple de trouble mental
Nesse présente longuement divers troubles mentaux : l’état de stress post-traumatique, le trouble anxieux généralisé, les épisodes de manie, les difficultés sexuelles, etc. Nous reprenons quelques-uns de ses aperçus sur la dépression.
Nesse note que la dépression illustre une erreur typique : expliquer un phénomène par une cause unique et croire qu’on dispose dès lors du pouvoir de le modifier. En fait, la dépression dépend à la fois de la génitique et de l’environnement.
Nesse distingue la dépression et la tristesse. Cette dernière résulte de pertes spécifiques et ne présente pas souvent le manque de motivation typique de la dépression.
Une explication évolutionnaire classique est que la dépression est un état provoqué par des situations où il apparaît inutile d’entreprendre des actions. On économise ainsi de l’énergie en attendant des circonstances meilleures. C’est notamment le cas des dépressions qui accompagnent des maladies infectieuses : ce n’est pas le moment de dépenser de l’énergie. C’est vrai pour les animaux : un jeune singe perdu reste immobile et silencieux. Il économise des calories et n’attire pas l’attention de prédateurs. C’est comparable à l’hibernation.
Nous épinglons deux processus détaillés par l’auteur : les dépressions par espoir et par ambition excessive.
La psychologue Jutta Heckhausen et coll. ont suivi un groupe de femmes d’âge moyen sans enfant espérant encore avoir un bébé. À mesure que ces femmes approchaient de la ménopause, leur détresse émotionnelle devenait de plus en plus intense. Mais après la ménopause, celles qui avaient abandonné tout espoir de grossesse étaient débarrassées de leurs symptômes dépressifs [3].
Il est essentiel de savoir quand passer à autre chose. À un moment donné, persévérer est absurde. Il faut évidemment réfléchir à deux fois. De là une question importante en cas de dépression : « Est-ce que vous vous évertuez à réaliser quelque chose de très important sans y parvenir, mais sans pour autant laisser tomber ? »
Un processus du même ordre est la dépression par ambition excessive. Les aventures de célébrités suscitent des ambitions que peu de gens peuvent réaliser. Sur Facebook, le positif est surreprésenté de sorte que les participants se sentent moins bien dans leur vie.
Nos réussites nous rendent désirables, en particulier pour des partenaires sexuels. La sélection naturelle nous a amenés à nous soucier énormément de ce que les autres pensent de nos ressources, de nos aptitudes et de notre personnalité. Nous surveillons constamment la valeur que les autres nous accordent. C’est la principale source l’estime de soi. Nesse écrit : « Chacun veut être quelqu’un, valorisé et apprécié pour ses contributions et ses compétences propres. C’est ce qui rend chaque domaine compétitif. Dans le sport, cela saute aux yeux ; dans la musique et le théâtre, à peine moins. L’observation ornithologique semble égalitaire, jusqu’à ce que vous écoutiez réellement les conversations de férus d’oiseaux. Les collectionneurs de maquettes de trains miniatures affichent leurs connaissances avec la superbe de grands magistrats. Les gens ne peuvent pas s’en empêcher ; ils transforment chaque passe-temps en compétition » (p. 237).
———————
[1] Sastre, P. (2011) Généalogies de la morale : perspectives nietzschéenne et darwinienne sur l’origine des comportements et des sentiments moraux. Thèse de doctorat. Université de Reims, 471 p.
[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_Awards
On notera que, parmi les morts stupides recensées, les hommes sont beaucoup plus nombreux que de femmes. Selon la psychologie évolutionnaire, les femmes doivent assurer leur survie et celle de leurs enfants, tandis que les hommes prennent volontiers des risques, notamment pour maximiser la transmission de leurs gènes.
[3] Heckhausen, J. et al. (2001) Developmental regulation before and after a developmental deadline: the sample case of “biological clock” for childbearing. Psychology and Aging, 16: 400-413.



