Jean TWENGE, professeure de psychologie à l’université de l’État de San Diego, a étudié durant 25 ans les mutations des conduites des jeunes aux États-Unis. Ses recherches, publiées dans les meilleures revues de psychologie, font autorité [1]. Ses livres Generation Me (2006) et The narcissism epidemic (2009) ont fait date. Elle y présente les milléniaux, les enfants du millénaire, nés entre 1980 et 1994, devenus adultes au début du XXe siècle. Cette génération se caractérise notamment par un individualisme croissant, une estime de soi immodérée, un moindre respect des règles [2].
En 2017, J. Twenge a publié une très vaste étude sur la « génération internet » :
iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood. Atria Book, 533 p.
Trad., Génération Internet. Éd. Mardaga, 2018, 464 p.
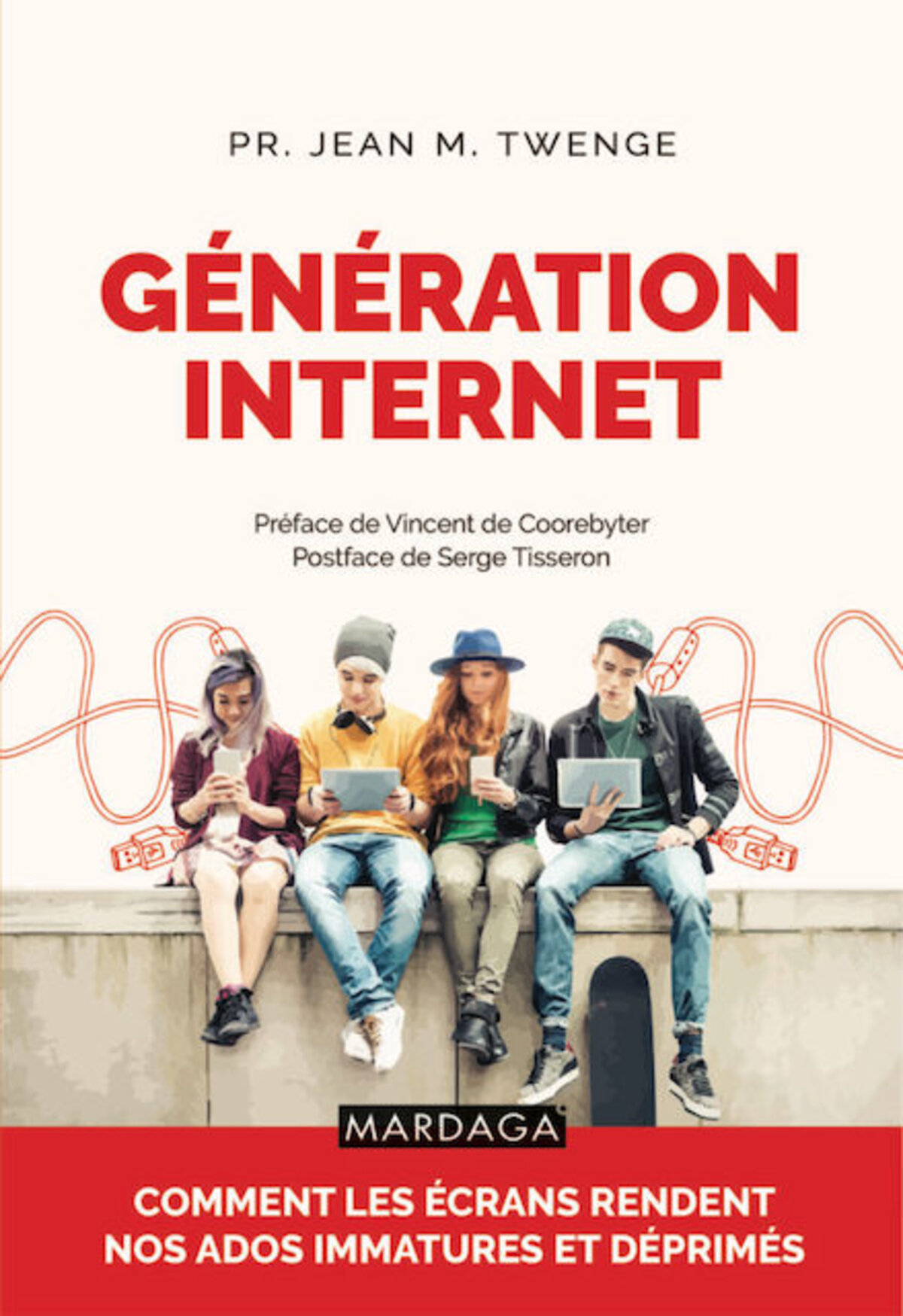
Agrandissement : Illustration 1

Les membres de la génération d’Internet, que Twenge appelle les « iGen », sont nés en 1995, l’année de la commercialisation de l’internet. Ils ont toujours connu l’informatique, l’internet et les réseaux sociaux. Ils ont un smartphone depuis l’enfance. Leur mode de vie est largement déterminé par l’hyper-connection à Internet et aux réseaux sociaux, le plus souvent via un smartphone. Aux États-Unis, les adolescents consultent leur smartphone en moyenne 80 fois par jour.
Par rapport à la génération précédente, les iGen se caractérisent notamment par moins d’autonomie, un sentiment d’insécurité, une capacité moindre d’attention soutenue, une plus grande plus grande préoccupation de l’apparence physique (chez les filles, surtout l’apparence physique « sexualisée »), une forte hausse de troubles mentaux (anxiété, dépression), surtout chez les filles, l’éloignement de la religion, un moindre intérêt pour la politique, une plus grande tolérance à l’égard des choix des autres, des orientations sexuelles et des troubles mentaux.
La relation avec les réseaux sociaux est devenue plus importante que la relation avec les personnes présentes ici et maintenant. Entre amis, le regard est plus souvent tourné vers le smartphone que vers les autres. Quand ils sont en ligne, les iGen répondent par monosyllabes, l’air absent.

Dans sa conclusion, Twenge écrit notamment : « Les iGen sont effrayés, peut-être même terrifiés. Tardant à grandir, élevés dans la culture de la sécurité et inquiets face aux inégalités salariales, ils sont entrés dans l’adolescence à une époque où leur principale activité sociale consiste à regarder un petit écran rectangulaire, source d’amour comme de rejet. Les appareils qu’ils tiennent en main ont prolongé leur enfance tout en les coupant d’une réelle interaction humaine. De ce fait, ils sont à la fois la génération la plus en sécurité physiquement et la plus fragile mentalement » (p. 397).
Un chapitre particulièrement intéressant présente des pistes pour aider les iGen à prévenir et résoudre des problèmes qui les spécifient. Nous en donnons ici un aperçu auquel nous avons ajouté quelques informations.
1. Quand Nick Bilton a interviewé Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, pour le New York Times, il lui a demandé si ses enfants aimaient l’iPad. Jobs a répondu : « Ils ne l’ont pas encore utilisé. Nous limitons l’usage de la technologie pour nos enfants à la maison ». Le journaliste a appris ensuite que beaucoup d’experts de la tech, par exemple le cofondateur de Twitter, restreignaient le temps que leurs enfants passaient devant les écrans. Comme le note Adam Alter dans son livre Irresistible: « Il semblerait que les personnes qui fabriquent des produits technologiques obéissent à la règle cardinale des trafiquants de drogue : ne jamais se défoncer avec sa propre marchandise » [3].
Les entreprises de réseaux sociaux sont dirigées par des personnes qui cherchent avant tout à gagner un maximum d’argent. Elles se moquent des dérives qui en résultent chez les enfants, les adolescents … et les adultes.
Les parents devraient retarder le plus longtemps possible le moment de donner un téléphone portable. Le premier téléphone devrait être un téléphone sans internet, un « dumb phone », un téléphone « stupide », et pas encore un « smartphone », un téléphone « intelligent ».
Lorsqu’un enfant est jeune, le smartphone l’expose au harcèlement et à ses effets néfastes sur la santé mentale. Si l’enfant tient absolument à être sur des réseaux sociaux, l’ordinateur est préférable : le smartphone est en permanence à portée de la main.
2. Le premier smartphone que reçoit l’enfant devrait inclure une application qui limite le temps qu’il y passe.
3. Personne, y compris les adultes, ne devrait dormir à moins de trois mètres du smartphone, éteint. Mettre l’engin en mode silencieux n’est pas une bonne solution car on est tenté de le consulter si l’on n’arrive pas à dormir, y compris en pleine nuit.
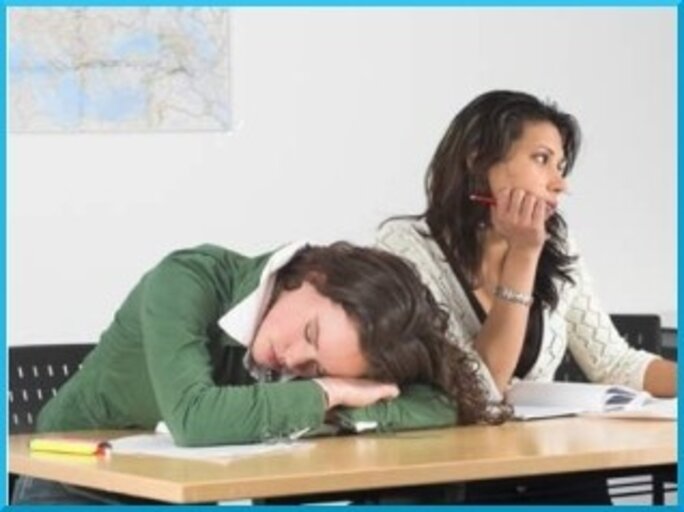
4. Le téléphone ne devrait pas servir de réveil. Il est préférable d’acheter un réveil.
5. Il faudrait s’efforcer de mettre le téléphone de côté lorsqu’on est en présence d’un(e) ami(e). Une règle ingénieuse pour ceux qui prennent un verre ou un repas ensemble : le premier qui consulte son smartphone paie l’addition.
6. Le problème de l’étude :
Les étudiants sont une population à risque. Il est extrêmement tentant d’interrompre l’étude pour consulter un réseau social. Ce comportement ne pose pas de problème si les consultations ne se font qu’après des période de 30 à 40 minutes d’étude et ne durent pas plus de 5 minutes. Dans ce cas il peut s’agir d’une pause bienvenue au cours d’une longue période d’étude (un peu d’exercice physique et le fait de regarder au loin pour reposer les yeux seraient préférables) [4].
Pendant les périodes d’étude, il faut éloigner le téléphone et s’abstenir de consulter les e-mails ou Google.
Toujours se rappeler que le smartphone n’est pas le meilleur ami, certainement pas lorsqu’on est étudiant.
————
Notes
[1] Le site de J. Twenge : http://www.jeantwenge.com/
[2] En français, sur la génération « Me », voir : J. Cottraux (2017) Tous narcissiques. Odile Jacob, 228 p.
Compte rendu : https://www.afis.org/Tous-narcissiques
[3] Irresistible: The rise of addictive technology and the Business of keeping us hooked. New York: Penguin Press.
[4] Peu après la Seconde Guerre mondiale, Norman Mackworth (université de Cambridge) réalisa des expériences à la demande de l’armée anglaise pour comprendre pourquoi les opérateurs de radars, qui devaient repérer des sous-marins, avaient régulièrement failli à la tâche. Le psychologue construisit un appareil comparable au radar et plaça ses sujets dans la même situation : isolement, observation durant deux heures d’affilée de brefs signaux apparaissant de façon aléatoire. Déjà après une demi-heure, les erreurs se multipliaient. Un simple coup de fil au milieu de la séance améliorait la vigilance. Un repos d’une demi-heure chaque demi-heure réduisait considérablement les erreurs (“The breakdown of vigilance during prolonged visual search”, Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1948, 1:6-21).
Depuis, d’autres recherches ont montré que lorsqu’il s’agit d’assimiler la matière d’un cours (pas seulement lire ou recopier des notes), le rendement est le meilleur lorsqu’on fait de courtes pauses environ toutes les 30 minutes. A noter que la capacité d’une attention soutenue augmente avec l’âge. Il s’agit d’un comportement qui, comme la plupart des comportements, peut se développer. Certaines personnes souffrent malheureusement d’un «déficit de l’attention » qui rend l’étude plus difficile.



