Extrait de : Freud et Lacan : des charlatan ? La psychanalyse a-t-elle encore une place au 21e siècle ? Mardaga, 2e éd. revue, 2024, p. 164-167

Agrandissement : Illustration 1
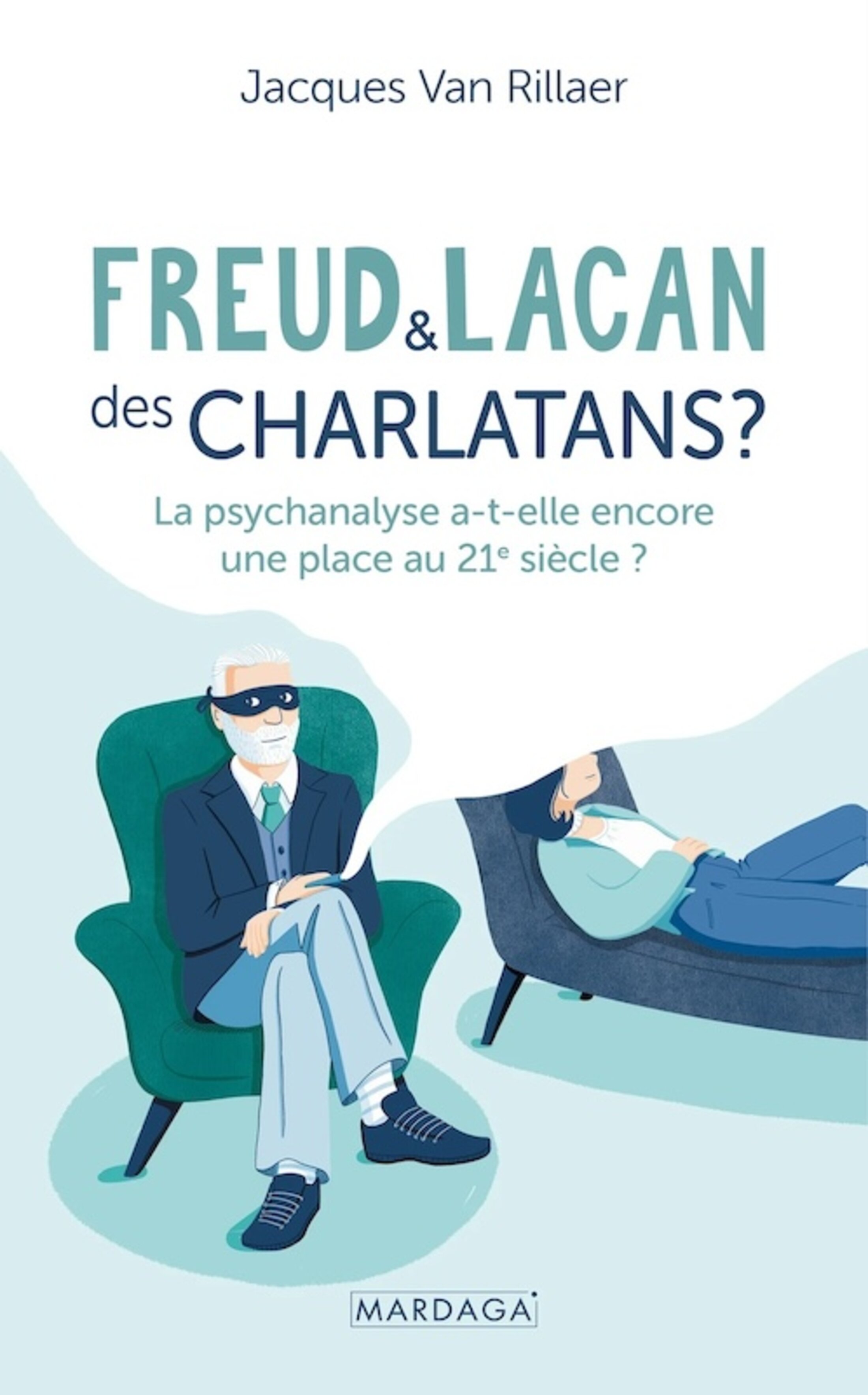
Facteurs du succès de la psychanalyse en France
En 1977, Roland Jaccard, responsable la rubrique psy dans Le Monde, écrivait : « La France fut longtemps terre hostile à la psychanalyse ; l'Université la tenait pour une “psychologie de singe” et la médecine pour une thérapie douteuse. S'il y a près d'un demi-siècle que fut fondée la Société psychanalytique de Paris, le prodigieux essor que connaît la pensée freudienne date de ces dix dernières années seulement : paradoxalement, alors qu'aux États-Unis, comme dans la plupart des pays industrialisés, on assiste à un reflux de la psychanalyse, l'influence qu'elle exerce en France tant sur la psychiatrie que sur la philosophie ou la littérature ne cesse de croître » (Le Monde, 3-11).
Vingt ans plus tard, Roudinesco, gardienne du Temple freudien, constate : « La France est le seul pays au monde où ont été réunies pendant un siècle les conditions nécessaires à une intégration réussie de la psychanalyse dans tous les secteurs de la vie culturelle, aussi bien par la voie psychiatrique que par la voie intellectuelle. Il existe donc dans ce domaine une exception française » (1999: 130).
Le succès de la psychanalyse en France tient à plusieurs facteurs dont le principal est la façon dont Lacan a facilité l’accès au titre de psychanalyste de son École. Nul besoin d’un diplôme de psychologie ou de psychiatrie : une « didactique », l’assistance à des séminaires et des « contrôles » suffisent. Jean Clavreul, fidèle lieutenant de Lacan, a décrit comment ce dispositif a fait exploser le nombre de lacaniens à partir de 1964 : « Le prestige de l’École freudienne fut tel qu’il y eut de plus en plus d’adhésions, à tel point que les demandes d’adhésion devinrent aussi importantes que le nombre d’adhérents, plus de six cents à ce moment-là. Cela était dû au fait que Lacan ne prononçait jamais d’exclusion. Pendant quinze années, l’École freudienne n’a jamais exclu personne » (p. 79).
Lacan, un champion du marketing, disait : « La psychanalyse présentement n’a rien de plus sûr à faire valoir à son actif que la production de psychanalystes – dût ce bilan apparaître comme laissant à désirer » (Annuaire de l’École Freudienne de Paris, 1965), « J’ai réussi en somme ce que dans le champ du commerce ordinaire, on voudrait pouvoir réaliser aussi aisément : avec de l’offre j’ai créé la demande » (1966: 617). Il jubilait du coup porté à l’AIP : le nombre des lacaniens a rapidement submergé celui des freudiens orthodoxes. La psychanalyse française est devenue essentiellement lacanienne.
En outre, sa célèbre formule « le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même » a fait, comme l’écrit Gilbert Diatkine (président de la Société psychanalytique de Paris), qu’« en quelques années, les plus petites villes de France ont vu se multiplier les “analystes” autoproclamés » (p. 249). Bon nombre de ces analystes ont une formation de philosophe, de lettré, de théologien. Ceux-là ont amplement contribué à la diffusion de la doctrine dans les médias.
Les lycéens suivent un cours de philosophie, où un des principaux thèmes est l’Inconscient et où Freud est à l’honneur. Onfray, qui a enseigné dans la classe de philosophie, a décrit à quel point les cours consacrés à la psychanalyse produisent un effet autrement enchanteur que l’allégorie de la caverne de Platon ou l'impératif catégorique de Kant. « Freud affirmait avoir soigné et guéri, la chose était dite, écrite, publiée dans des maisons d'édition respectables, elle se trouvait enseignée dans toutes les classes de philosophie de France et de Navarre, on passait le bac avec ces vérités révélées » (p. 25).
Dans les universités, l’enseignement de la psychiatrie et de la psychologie clinique est largement aux mains de psychanalystes. Nombre d’universités ne présentent guère d’autres orientations psychothérapeutiques. Sur les TCC, on n’y enseigne que quelques caricatures. Dans ces universités, le titre de « professeur » ne requiert pas des recherches empiriques rigoureuses, mais simplement des travaux d’exégèse d’Écritures psychanalytiques. La situation n’évoluera pas rapidement car les nominations se font généralement par cooptation. Ceux qui sont en place s’arrangent pour éviter la concurrence et les critiques.
L’enseignement universitaire de la philosophie est largement imprégné de psychanalyse. Des philosophes français (Althusser, Badiou, Derrida et alii) ont vu dans la « science » psychanalytique, et particulièrement dans la version lacanienne, une occasion de renouveau ou de légitimation de leurs discours alambiqués sur le Sujet, la Parole, le Désir, la finitude, l’être-pour-la-mort, etc. Même des théologiens catholiques ont trouvé chez Lacan de quoi reformuler ou « approfondir » leur foi. Ainsi Louis Panier, professeur de théologie à la Faculté théologique de Lyon, explique dans Le Péché originel (1996) : « La doctrine du péché originel affirme qu’il n’y a pas à proprement parler d’“espèce” humaine, mais un “genre” humain. […] Il n’y a d’humain qu’inscrit dans la génération où il trouve place et où il fait “hiatus” : telle est l’énigme de la filiation. Je fais l’hypothèse que la doctrine du péché originel parle très exactement de cela. Il y a “genre humain” parce qu’à chaque naissance d’humain, l’humanité est mise en cause si la vérité du sujet, en sa singularité inouïe, en appelle à une autre “cause” que la conformité aux traits qui font la définition de la “nature humaine” » (p. 141). Voici un échantillon de la transfiguration opérée par la grâce du lacanisme. On lit dans la Bible : « À la femme, Yahvé Dieu dit : “Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi.” » (Genèse 3: 16). Traduction de Panier en lacanien : « Dieu n'établit pas le pouvoir des hommes, il révèle à la femme la faille “insue” où il sera question pour elle d'entendre l'altérité de la parole » (p. 96). Tout le reste est du même tonneau.
Sherry Turkle, sociologue du Massachusetts Institute of Technology, a mené pendant 18 mois un travail ethnographique sur la psychanalyse française, qu’elle a publié sous le titre La France freudienne. Elle note que Mai 68 a marqué un tournant : « La France fut saisie par une fièvre de parole » (p. 21). La psychanalyse y a contribué et en a largement bénéficié. À partir de ce moment, son « développement a été explosif » : « Le mouvement psychanalytique français, à l’origine insignifiant, a donné naissance à une culture psychanalytique profondément liée à la vie politique et sociale. Le nombre des analystes a augmenté de façon spectaculaire, ainsi que l’intérêt du public pour la psychanalyse. Les livres d’éducation, des conseils d’orientation, l’enseignement, l’assistance sociale sont tous “passés à la psychanalyse”. La psychanalyse tient la une dans la médecine, la psychiatrie et l’édition. […] Le vocabulaire psychanalytique a envahi la vie et le langage, transformant la manière dont les gens pensent en politique, discutent de littérature, parlent à leurs enfants. Les métaphores psychanalytiques ont infiltré la vie sociale française à un point qui est sans doute unique dans l'histoire du mouvement psychanalytique. Même aux États-Unis les choses ne sont jamais allées aussi loin » (p. 24s).
Nous citons rapidement quelques facteurs de la massification de la psychanalyse examinés par Turkle. La psychanalyse apparaît comme une justification rationnelle de la libération sexuelle et un moyen de parler ouvertement de sexualité. Lacan a véhiculé un message de libération du désir, en phase avec les événements de Mai 68. Des psychanalystes ont établi des liens avec le communisme et surtout le gauchisme. Les déçus du marxisme ont trouvé une alternative. L’Église, qui avait condamné la psychanalyse, s’y est ouverte. Les analystes sont apparus aux prêtres comme des modèles en matière d’écoute et de conseil. Mai 68 a déstabilisé les parents d’adolescents et de jeunes adultes de sorte que la demande en experts psys a explosé. Les Français sont habitués depuis le lycée à l’explication de texte et aux citations littéraires. « Beaucoup se pensent profondément nourris des écrits de Lacan bien qu’ils ne puissent comprendre les points délicats de sa théorie. Ils trouvent que Lacan “c’est bien pour penser” » (p. 39).

Agrandissement : Illustration 2

—————————————
Deux sites pour des publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, l'épistémologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.
1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique ; http://www.pseudo-sciences.org/
2) Site à l'univ. de Louvain-la-Neuve:



