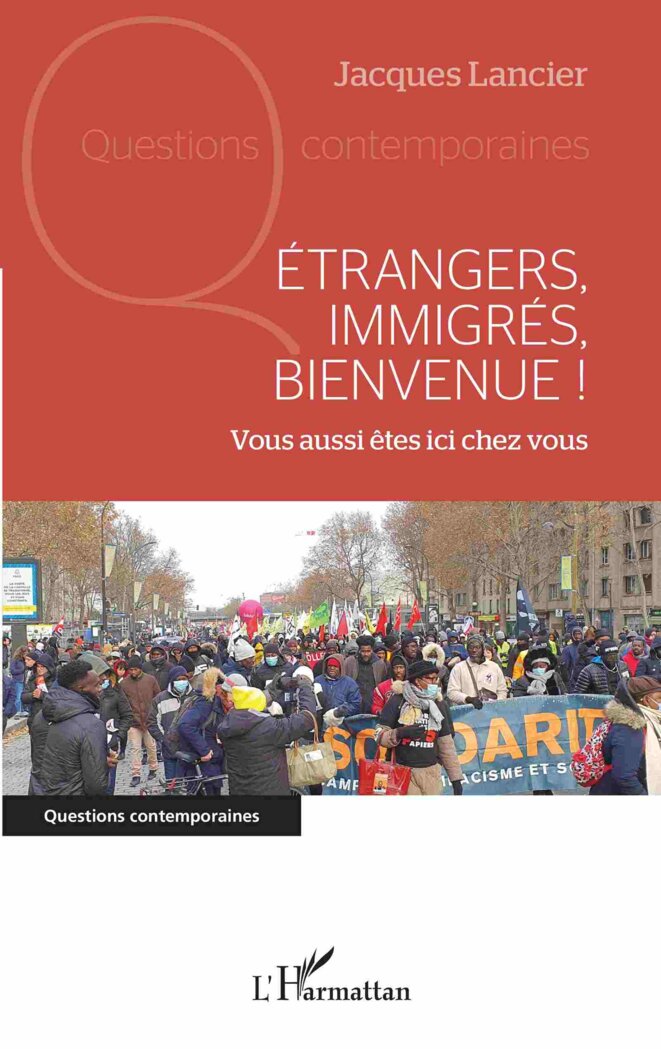La réalité s’impose : représentés par « le président des riches » et appuyés sur divers leviers constitutionnels, les 1% ont le pouvoir. La réforme des retraites leur sert de panneau indicateur à la finance mondiale : « venez chez nous, les riches y sont bien traités et la masse des travailleurs matée ». Chacun pressent que pour que le mouvement obtienne quelque chose il faudrait un saut qualitatif, un bond politique. Or cela ne peut se faire exclusivement sur les retraites. Pour chacun un bond politique ne peut se faire qu’à partir d’une perception plus large, qui comprend des aspect aussi divers que l’augmentation du cout de la vie, la perception de la situation financière à la fois personnelle et globale, les perspectives électorales, les menaces écologiques et le réchauffement climatique, les guerres en Ukraine et ailleurs, les tensions internationales, les questions de santé et de gestion de la fin de vie etc. Est-on prêt à bousculer tout ça ? A une révolution ? Clairement la réponse est non. Une révolution de quel type d’ailleurs? qui déboucherait sur quoi ? Macron a beau être détesté, chacun sait qu’il est le représentant d’une dictature bourgeoise encore supportable. Pour une grande majorité la situation en France n’est pas insoutenable.
Un mouvement encore minoritaire
D’ailleurs bien que massif le mouvement des retraites n’a pas entrainé tout le monde. Les banlieues et les travailleurs immigrés ont peu bougé : les manifs étaient « blanches ». Or les immigrés, si on inclut la 2ème génération, constituent 40% des classes populaires en France[1]. Les manifestations de soutien aux migrants qui avaient lieu en parallèle (les 18 décembre, 4 février, 25 mars, 29 avril) ne réunissaient elles-mêmes que quelques milliers de manifestants, essentiellement des livreurs et des sans-papiers, mais sans mobiliser l’immigration maghrébine par exemple. Celle-ci est pourtant majoritaire dans l’immigration en France. De même des cartes publiées dans le quotidien Le Monde montrent que ce sont les villes à fort secteur public qui se sont mobilisées: le privé à moins bougé. Or le secteur public regroupe 6 millions de travailleurs, le privé 3 fois plus, 20 millions. Si après l’activation du 49.3 on s’est félicité d’un petit regain de mobilisation des jeunes, il est resté faible en regard des 3 millions d’étudiants en France (En 68 les étudiants étaient 6 fois moins nombreux et beaucoup plus mobilisés)…
Bien que massif et soutenu par 90% des actifs, le mouvement restait minoritaire. Le même constat peut être fait à l’égard des Gilets jaunes. Eux aussi bénéficiaient de l’approbation d’une grande majorité de la population, tout en ne rassemblant au plus fort du mouvement que 300 000 personnes. Cependant certains enseignements de leurs luttes sont à garder précieusement : le fait que face à un appareil de production capitaliste éclaté en sous-traitants multiples, les ronds-points, couplés à des manifs musclées, peuvent s’avérer tout aussi efficaces que des grèves éparpillées difficiles à organiser ; que la lutte est possible même en dehors de syndicats institutionnalisés ; le fait de passer rapidement à l’enjeu politique « Même si Macron ne veut pas nous on est là… » etc. Chacune des luttes est minoritaire, même les plus médiatisées d’entre elles comme « Nuits debout » contre la loi travail en 2016…
Grève générale ?
Pour surmonter ce « mur » les blackblocks proposent la casse pour radicaliser le mouvement, d’autres « la grève générale », la « convergence des luttes », avec l’idée que la violence ou un cumul des luttes, ou encore un prolongement dans le temps est la solution. Dans tous les cas c’est l’illusion qu’un simple prolongement linéaire, en durcissant, en faisant durer, en élargissant le mouvement, même sans saut qualitatif, suffit. Comme le notait Marx dans le Manifeste du Parti communiste « Parfois les ouvriers triomphent ; mais c’est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l’union grandissante des travailleurs ». Le gain de la lutte n’est donc pas dans un cumul de succès revendicatifs mais dans quelque chose de nature différente : l’union. Or si même le succès immédiat ne mène pas au triomphe, que dire des impasses et des échecs ? Cependant ces derniers aussi peuvent être utilisés pour contribuer à l’unité. Si on a cet objectif d’unité en vue il serait contreproductif de pousser à des luttes qui isoleraient une partie des combattants. Les militants s’épuiseraient et se décourageraient à « forcer » les luttes, et finiraient par diviser au lieu d’unir. Il serait plus utile de leur part de tirer des leçons de ces luttes. La première leçon est bien évidemment que la solution aux principales revendications est essentiellement politique. Politique ne signifie pas forcément révolution ! et encore moins que cette révolution découlerait de la simple convergence des luttes. Une révolution n’apparaitrait comme nécessaire que face au délabrement du système en place et au constat par tous de l’incapacité de le prolonger. C’est ce qu’on pressent avec l’impasse écologique, les 250 millions de personnes menacées de famine dans le monde (en 2023 !), les inégalités croissantes, l’effroyable nombre de migrants noyés, les instabilités et les crises financières, politiques, les guerres… C’est ce qu’on pressent, mais la situation, du moins en France pour l’instant, n’est cependant pas révolutionnaire. C’est pourquoi la tâche des militants, tout en participant aux luttes, n’est pas de les pousser à bout, mais d’en donner une compréhension générale. Le passage par la théorie est une étape nécessaire avant que la convergence des luttes ne puissent proposer une alternative crédible et réaliste au système qui vacille. Théorie ne veut pas dire rabâcher des vieilles phrases « marxistes », mais faire l’analyse réaliste d’où on en est aujourd’hui. Par exemple, comme plus haut, tenir compte du caractère encore limité des divers mouvements de lutte, mais aussi commencer à dégager un programme alternatif crédible, à la hauteur de la crise du système, qui ne soit pas un simple catalogue de revendications partielles.
Pour ce faire des contradictions sont à surmonter : ainsi étudier semble une perte de temps par rapport à l’action. Critiquer, discuter, peuvent sembler diviser et il peut être tentant de mettre les désaccords sous le tapis au nom de l’unité. Or l’unité sur une ligne floue ou partiellement erronée se fracassera lors d’événements imprévus. « Un se divise en deux, voilà un phénomène universel, et c’est la dialectique » comme le dit le marxiste Mao. Mais comment articuler ça avec l’injonction même de Marx : « Prolétaires de tous les pays unissez-vous » ? Beaucoup se joue là, dans l’articulation des deux propositions. Quelques exemples actuels :
Soutenir les gilets jaunes et lutter contre les dérapages : Les gilets jaunes sont la preuve que l’inévitable lutte de classe n’a pas besoin des militants pour activer les luttes. Elle sait générer en temps voulu les activistes nécessaires. Les militants ont bien souvent été sidérés par la radicalité des gilets jaunes au point pour certains de s’en tenir à l’écart et de tenter de justifier leur dédain. « Poujadistes » disaient-ils, au mépris de l’analyse sociologique, aussi bien des gilets jaunes que des commerçants, incapables aujourd’hui de mener un mouvement poujadiste car ils ont été laminé par la grande distribution. Les gilets jaunes, comme les banlieues en 2005, n’étaient qu’une fraction de la classe ouvrière, et eux aussi avaient leurs « islamistes », les militants d’extrême droite qui tentaient d’orienter le mouvement comme lors de l’assaut sur l’Arc de triomphe le 1er décembre 2018. L’unité avec les gilets jaunes nécessitait en même temps de critiquer de telles déviations ainsi que les 2 ou 3 « quenelles ».
Unité avec les immigrés et critiquer l’islam qu’une partie d’entre eux défendent. Si on veut l’unité de tous les travailleurs il est nécessaire de combattre l’islam (ainsi que les autres religions et autres complotismes…) qui les divisent. Cela exige doigté mais aussi fermeté dans la démarcation à l’égard des comportements critiques portés par l’islam : porosité avec le djihadisme, machisme, port du voile obligatoire, brutalité à l’égard des animaux etc.
Promouvoir l’unité homme femme et dénoncer les comportements machistes : A l’encontre de l’unité immédiate, la nécessaire dénonciation du machisme peut, dans certains contextes, nécessiter des réunions non mixtes, ou des mesures de discrimination positive pour libérer la parole et promouvoir les femmes. C’est vrai aussi pour les minorités sexuelles, ethniques, de langue etc.
La Nupes : Lors des élections de 2022, Jean Luc Mélenchon et LFI ont su unir la gauche. Ils répondaient ainsi à une juste et profonde aspiration. C’est positif. Dans ces conditions la candidature de Fabien Roussel apparaissait comme une candidature de division qui a permis à Marine Le Pen d’être au second tour. Mais l’unité de la Nupes, Mélenchon et Fabien Roussel sont d’accord là-dessus, se fait autour de la célébration de la révolution bourgeoise de 1789, de la Marseillaise et du drapeau tricolore, emblèmes des guerres de colonisation et de l’écrasement de la première révolution ouvrière, la Commune de Paris. Tout en exprimant la volonté louable d’unité, cette orientation politique s’adressant aux « citoyens », divise en fait les travailleurs en écartant les 4 millions d’immigrés majeurs qui n’ont pas le droit de vote. Dans ces conditions la candidature de Philippe Poutou pouvait elle se justifier : internationaliste elle était politiquement différente, et si elle aussi semblait diviser elle préparait l’étape suivante, une unité plus solide car non minée par le chauvinisme.
La révolution mange ses enfants : Marx lui-même, tout en prônant l’unité, n’arrêtait pas de polémiquer, avec Bakounine ou Proudhon par exemple, comme Lénine avec Plekhanov et les mencheviks, Staline avec Trotski, Mao avec Liu shao shi etc. Le député de la Convention Pierre Vergniaud, avant d’être lui-même guillotiné, pouvait dire en 1793 que « la révolution comme Saturne dévore ses enfants ». Il est inéluctable au cours du développement d’un processus que des lignes divergent : « un se divise en deux ». Ce qui n’implique pas, comme lors des grands procès staliniens des années 30 de tuer les tenants des lignes divergentes ! Il s’agit ici de faire jouer un autre principe théorique de base : savoir distinguer la contradiction principale des contradictions secondaires. Voir Mao à ce sujet[2].
Les retraites : Pour en revenir au mouvement des retraites, son avenir parait bouché. La colère et la frustration du report au 6 Juin de la prochaine manifestation intersyndicale est le signal qu’une revendication, même unitaire comme « Non à la retraite à 64 ans », ne suffit pas. Laurent Berger et l’intersyndicale paraissent mesurés et réalistes. Une position centriste apparait toujours plus mesurée et plus réaliste sur l’instant qu’une position révolutionnaire, mais elle ne l’est que pour la période courante. Elle n’aide pas à faire face aux conséquences d’évolutions sous-jacentes déjà en cours, telle que la crise générale du capitalisme dans laquelle s’inscrit forcément telle ou telle revendication particulière comme celle des retraites. L’alternative au capitalisme, le communisme, (quoi d’autre ?), ne découle pas d’une revendication comme celle sur les retraites, ni d’un cumul de celle-ci avec d’autres revendications, mais d’une situation générale que cependant la revendication sur les retraites participe à éclairer : l’injustice et les inégalités insupportables. Proposer l’alternative communiste, bien que paraissant improbable aujourd’hui, bien que minoritaire, et sur l’instant paraissant rompre l’unité, prépare l’unité de demain. C’est elle qui surmontera l’impasse sur laquelle butte la plupart des luttes d’aujourd’hui.
La critique et la discussion semblent créer la division, mais en écartant les « solutions impasses », elles permettent de faire émerger une unité nouvelle plus durable parce que sur des bases plus solides. L’articulation entre unité et lutte idéologique est un processus dynamique toujours recommencé.
[1] Voir Jacques Lancier « Étrangers, immigrés, bienvenue ! vous aussi êtes ici chez vous » L’Harmattan 2023.
[2] Mao Zedong : « De la contradiction » 1937.