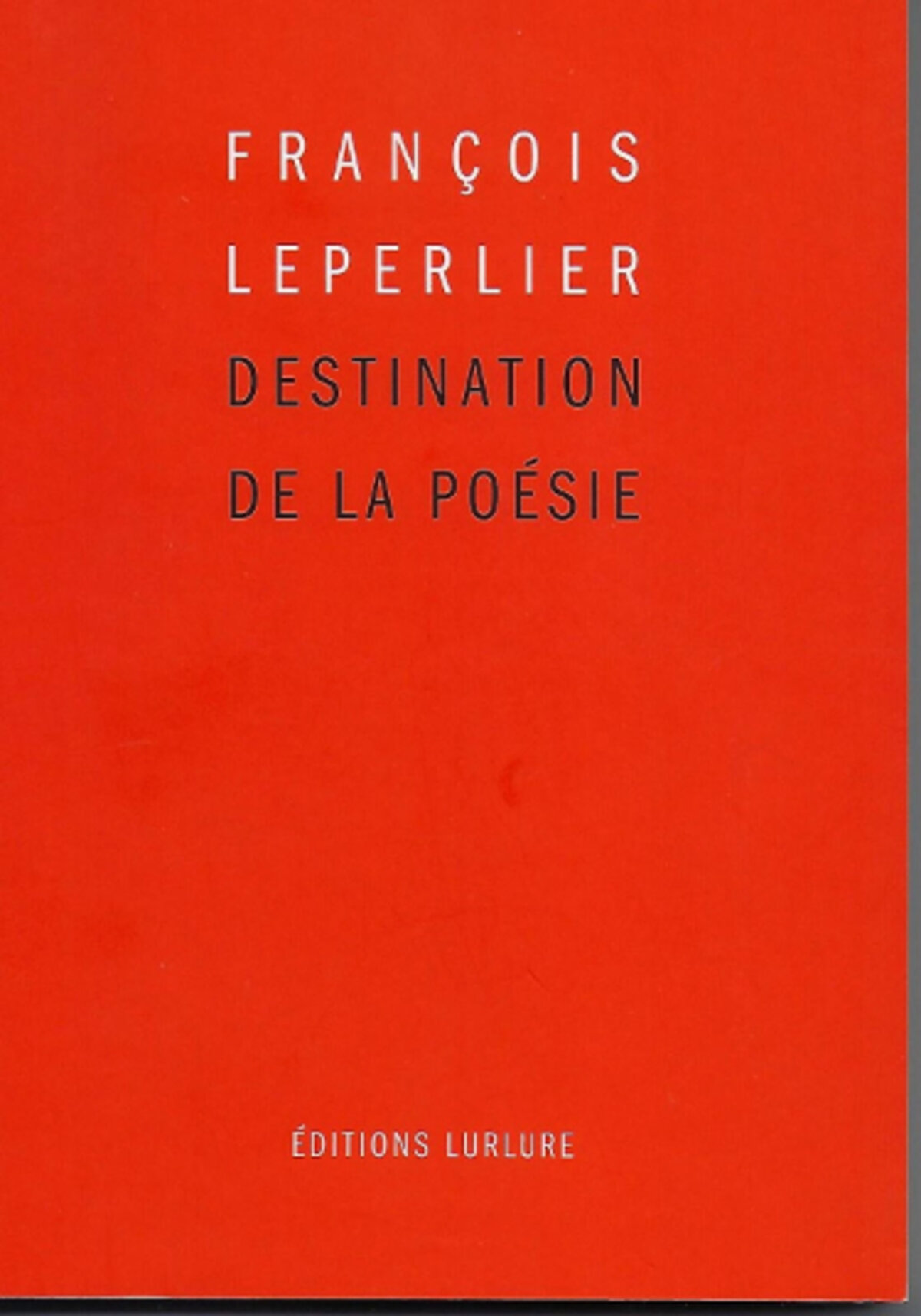
« la poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant. »
Arthur Rimbaud 1
François Leperlier évolue depuis son jeune âge dans l’orbe surréaliste toujours persistante, on le connaît pour ses études consacrées à Claude Cahun, poète et photographe, qu’il a contribué à faire connaître. Ou encore pour avoir établi une édition des œuvres de Magloire Saint Aude2 chez Jean-Michel Place.
Le voici avec un essai consacré à la poésie telle qu’il l’a vécue, la lit et la vit. Leperlier s’y place volontiers à une certaine hauteur, c’est une exigence sans doute, au risque d’une assurance qui peut parfois gêner.
Autobiographique, c’est un mérite de ce livre où l’auteur raconte sa découverte de la poésie, comment on l’appréhendait à l’époque (années 1960), comment il n’a pas changé.
« Au fond, mon adolescence s’est trouvée simplifiée autour de quelques aspirations parfaitement dessinées, dont j’allais bientôt connaître les complications : aller vers les œuvres qui sont plus que la vie, parce qu’elles grandissent l’amour et la mort ; viser à beaucoup de latitude dans la vie sociale et professionnelle ; mettre un maximum de réalité, de vérité, dans les images ; placer ce qu’il y a apparemment de plus gratuit, l’expérience intérieure, la capacité d’émerveillement et de résistance, la volonté de rêver, le parti pris de la beauté, le désir d’éternité, autant dire la poésie elle-même, au centre de tout, au-devant des tout. Et j’en suis toujours-là. »3
Comme il le rappelle, la fin de l’hégémonie surréaliste a souvent fait place à de la spéculation davantage qu’à de l’action, à un retour sur soi davantage qu’à une ouverture.
« Il faut bien reconnaître que ‘‘la fin de l’hégémonie surréaliste’’, comme dit Henri Deluy, s’est accompagnée d’un retour en force de la chose littéraire, précisément de cette « superstition des textes et de la poésie écrite, contre quoi un Antonin Artaud avait pu mettre en garde. Cette restauration a rendu possible des ambitions du type : ‘‘Je n’ai jamais écrit une ligne sur un sujet autre que le sujet d’écrire’ ’’ (Dominique Fourcade), et qui culminent dans cette foutaise : ‘‘La littérature comme ‘poésie de la poésie’ (François Meyronnis, Yannick Haenel). C’est ce qui s’appelle tenir une « ligne de risque ». À quoi ne s’est-on pas exposé ! »
L’ouvrage peut presque se lire comme un recueil de citations, tellement son texte est truffé d’emprunts et montre qu’il doit tout à ceux qui sont ainsi nommés, salués, dont les mots sonnent encore si clairement.
L’image poétique prônée par les surréalistes avait-elle fait son temps ? Cela fait un bail que cela semble être admis. L’existentialisme, le structuralisme, la littéralité, jusqu’aux poètes en vogue depuis plusieurs années (bien souvent des universitaires) lui ont fait un sort.
Tout accès de lyrisme est honni désormais dans ce qui se veut l’avant-garde, mais une poésie émancipée des principes en vogue n’en continue pas moins de subsister, en dépit du dédain qu’elle suscite. Leperlier fait le parallèle avec l’art contemporain d’aujourd’hui qui a réussi à s’imposer dans tous les lieux en vue, en étant l’art qui parle le moins, mais qui fait parler le plus.
Il prend des distances avec ses habituels inspirateurs à propos de la fulgurance associée trop facilement à la poésie, comme si le poème découlait d’un instant. Il préfère suivre Henri Lefebvre qui choisit plutôt le moment, « plus proche de l’expérience même ».
Réjouissantes aussi les pages de Leperlier sur l’institutionnalisation de la poésie. Depuis les Maisons de la Poésie jusqu’aux résidences tout confort (« on ne dit pas s’ils disposent, à défaut d’un ‘‘espace naturel sensible, site exceptionnel et verdoyant’’ d’une cellule de soutien psychologique pour traiter les pannées d’inspiration. »4) la prolétarisation doit concerner les poètes comme les artistes, le marché se doit de tout absorber (même l’auto-stop a été banni, car la gratuité répugne comme la solidarité, et l’on se pâme au contraire du covoiturage payant) et de la sorte les mots rentreront d’autant mieux dans le rang de la communication ambiante, faut-il croire.
Dans la foulée, voici que Leperlier a beau jeu de railler les multiples prix décernés en ce domaine. « Yves Bonnefoy en aurait moissonné une bonne vingtaine. Est-ce raisonnable ? » Et il énumère, non sans produire une sorte d’effet comique, ceux attribués au directeur artistique du Printemps des poètes, qu’il ne nomme pas.5
D’une manière générale, la diffusion forcée de la poésie suffit à la refroidir, « les entreprises de médiatisation, de vulgarisation, de soi-disant démocratisation de la poésie, non seulement ne conduisent jamais à sa popularisation, mais s’y opposent. ».
N’oublions pas, comme nous le rappelle Leperlier, que la plupart des poètes marquants du xxe siècle tomberaient aujourd’hui sous le coup de la loi, « seraient en butte aux avanies judiciaires et médiatiques, attisée par les lobbies citoyens et les ligues de vertu. »
C’est d’ailleurs à l’aune des textes de Debord, de Lefebvre, de Fourier, de la poésie de Nerval, de Lorca, Reverdy, Peret, par exemple, ou des pensées d’Empédocle, de Nietzsche, que l’auteur forge un regard politique.
« La seule utopie viable advient dans le poème, instantané et génératrice, elle n’entre dans le monde que par le poème, à sa hauteur, et n’en doit point sortir. La seule politique que rejoint le poème est celle dont il peut changer la nature, comme il fait de toute chose, pour l’assimiler, à sa substance, en définitive, celle qui s’exerce librement dans la métamorphose, le mythe et l’épopée (de Homère à d’Aubigné, de Hugo à Césaire). »6
*
Sur le site de l'éditeur : ici
1 Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1971, cité in François Leperlier, Destination de la poésie, éditions Lurlure, 2019, p. 171.
2 Cf. https://blogs.mediapart.fr/patrice-beray/blog/200408/mon-ode-magloire-saint-aude
3 François Leperlier, Destination de la poésie, éditions Lurlure, 2019, p. 15.
4 François Leperlier, Destination de la poésie, éditions Lurlure, 2019, p. 110.
5 En fait, Jean-Pierre Siméon, au moment où l’auteur rédige son livre. C’est, depuis 2018, Sophie Nauleau qui assure cette direction.
6 François Leperlier, Destination de la poésie, éditions Lurlure, 2019, p. 154.



