
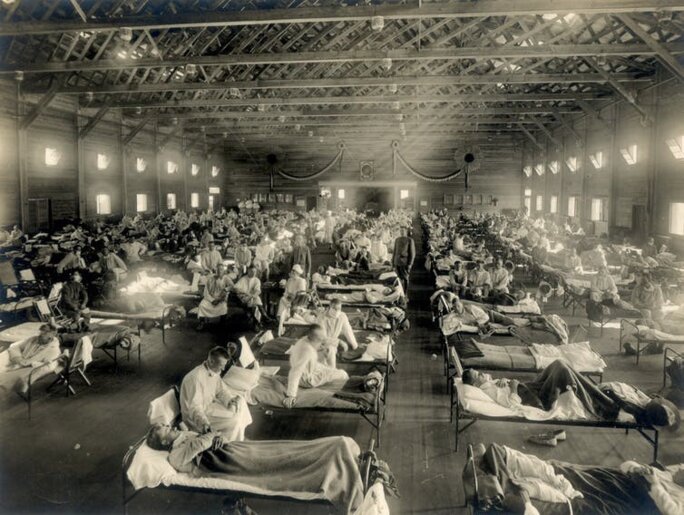
Agrandissement : Illustration 2
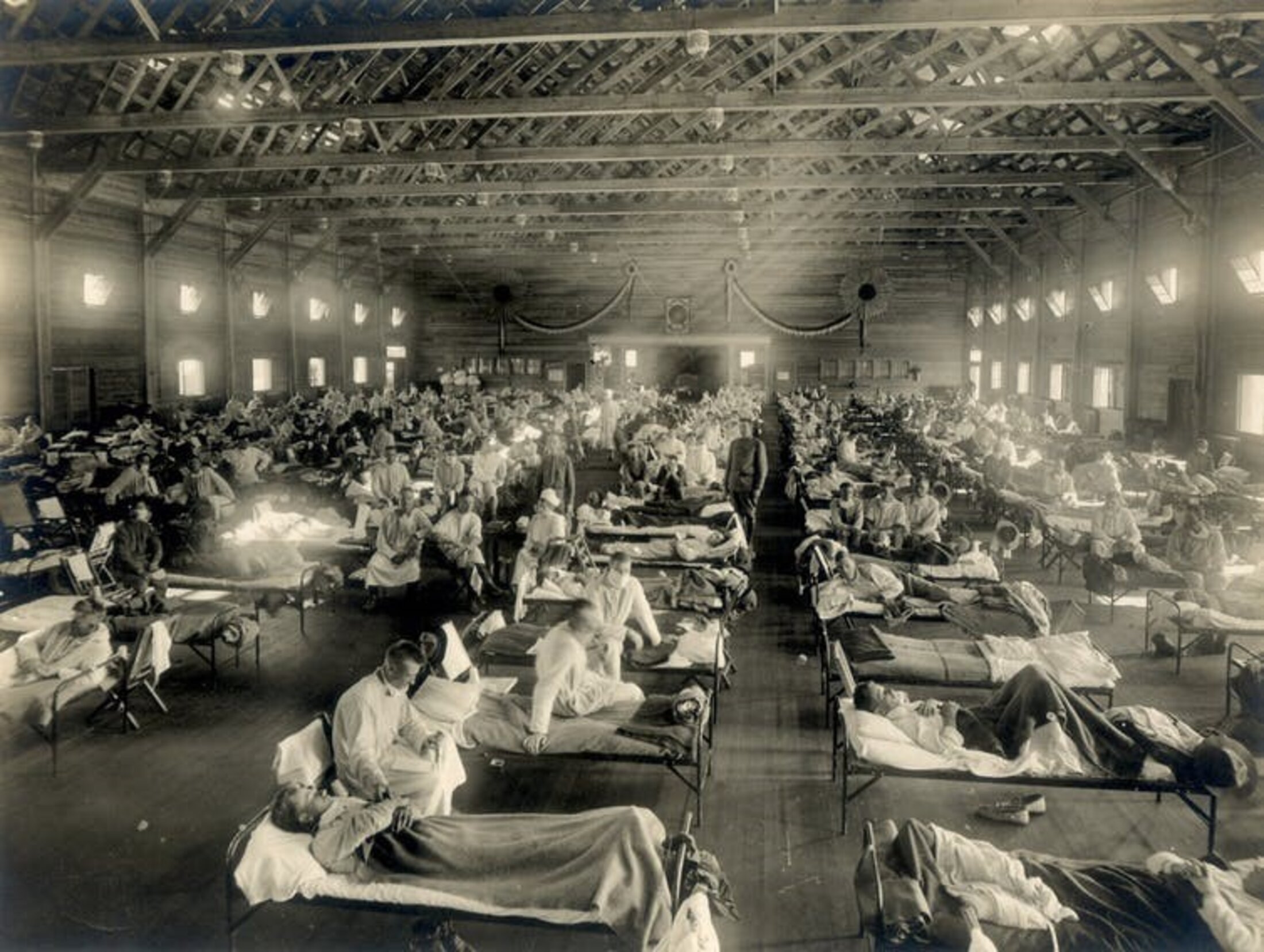

Agrandissement : Illustration 3

(Première version intialement postée sur Facebook le 22 mars 2020)
Dans un ouvrage encore non-traduit en français (The Routledge History of Disease, dirigé par Mack Jackson, Routledge, 2016), Mark Harrison, professeur d’histoire de la médecine à l’Université d’Oxford, rappelle que le terme pan-demos désignait chez Platon un amour pour les corps au hasard des rencontres, par distinction avec un amour céleste tourné vers les idées. C’est seulement au dix-huitième siècle, lorsque les Européens se sont installés durablement sur les autres continents, que le mot en est venu à désigner des épidémies comme la fièvre jaune en Afrique ou aux Antilles. Il était alors lié à l’explication des maladies par le climat : « pan » désignait tous les éléments de l’environnement dont les mauvaises « influences » faisaient mourir les hommes peu « acclimatés ». [à écouter : Risk and Security in the Age of Pandemics, conférence de Mark Harrison (en anglais, 50 minutes].
Au dix-neuvième siècle, deux maladies se diffusent à travers le monde, bouleversant les formes de gouvernement colonial que les Européens mettent alors en place. Le choléra affecte les villes en pleine expansion à travers les systèmes de circulation de l’eau, tandis que la peste se répand depuis les ports à travers les rongeurs transportés par les bateaux.
Dans les années 1970, des historiens de l’environnement comme William McNeill, Alfred Crosby, ou Emmanuel Le Roy Ladurie en France décrivent l’expansion de l’humanité comme une suite de pandémies : la peste d’Athènes décrite par Thucydide, la peste de Justinien à la fin de l’Antiquité, la peste du Moyen-Âge décrite par Boccace, la variole décrite par Las Casas chez les populations américaines récemment conquises…
Ces épidémies n’ont pourtant pas été vécues comme pandémiques par les sociétés touchées, même si chacune pouvait avoir le sentiment que c’était la fin de son monde. Car ces communautés n’avaient pas les moyens de montrer que la maladie en question affectait l’humanité tout entière. [A lire : Évolution microbienne et histoire humaine. Formidable entretien avec Jared Diamond. Propos recueillis, traduits et présentés par Adrien Minard et Aurélien Robert. Revue Tracés, 2011].
Ce qui est nouveau, aujourd’hui, c’est la capacité des systèmes de détection à suivre les mutations des pathogènes sur toute la planète et à anticiper leur potentiel pandémique.
Mais la nouveauté, c’est aussi et surtout le sentiment d’une vulnérabilité partagée entre l’humanité et les espèces animales constituant les réservoirs de ces pathogènes.
Certaines, domestiquées, deviennent malades de nos techniques d’élevage industriel, tandis que d’autres, sauvages, sont menacées d’extinction du fait des transformations que nous imposons à leur environnement.
Bref, « la pandémie est le signe que l’espèce humaine peut disparaître, et que les autres animaux, alliés aux microbes qu’ils partagent avec nous, se vengent des mauvais traitements que nous leur imposons. » Cette affirmation ne vient pas d’une quelconque secte animaliste. Elle est issue des réflexions et écrits de René Dubos, agronome, biologiste et écologue américain d'origine française (1901-1982), qui a préparé en 1972, avec Barbara Ward, le rapport de base de la première Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm (CNUE ou « Sommet de la Terre », intitulé "Nous n'avons qu'une Terre"), et qui fut ensuite à l'origine de la création du Programme des Nations unies pour l'environnement. [A lire : L’Homme et son environnement, entretien avec René Dubos].
Voici quelques citations éclairantes de René Dubos :
« C'est la diversité, et non l'efficacité, qui est la condition sine qua non d'une vie humaine riche et créatrice ».
« C'est dans le processus même d'interdépendance constructive avec le monde et d'adaptation de la nature à ses besoins, à ses désirs et à ses aspirations, que l'homme constitue son humanité. »
Ou encore : « La relation existant entre l'humanité et la nature doit être faite de respect et d'amour, non de domination. »
Ces citations sont extraites des Dieux de l’écologie, paru en… 1973. On ne peut pas dire que nous n’étions pas prévenus ! Mais qui, aujourd’hui, se souvient du nom de René Dubos ?
Et maintenant, on est dans de beaux draps, dans la pandémie jusqu’au cou (et ce n’est pas fini). Il en dit quoi, « le jour d’après » ?
APPENDICES
Pour le chercheur en microbiologie et spécialiste de la transmission des agents infectieux Jean-François Guégan, la pandémie actuelle est « un boomerang qui nous revient dans la figure ». Modification des habitats naturels d’un côté, consommation de viande et de produits d’animaux sauvages de l’autre, massification du transport mondial…, les origines de la propagation du coronavirus sont liées à notre modèle économique et « n’ont rien à voir avec des causes strictement sanitaires ». A lire sur Mediapart



