
C’est, dit la réclame, « le journal qui change des journaux » : le d’Lëtzebuerger Land est un respectable hebdomadaire luxembourgeois « haut de gamme », à caractère politique, économique et culturel fondé en 1954 par des promoteurs issus des milieux économiques, et paraissant sur très grand format le vendredi. Sur 44 pages, son numéro du 20 mai 2016 fut entièrement consacré à L’invitation aux musées, week-end portes ouvertes dans plus de quarante lieux d’exposition. Lancée en 1997 à l'initiative du groupement « d'stater muséeën » et étendue depuis sept ans à une quarantaine de musées au Grand-Duché, cette manifestation annuelle propose aux musées d'ouvrir gratuitement leurs portes un week-end de printemps.
Sans en avoir la preuve formelle, on suppose que ce numéro spécial du d’Lëtzebuerger Land a été rendu possible par un ou plusieurs partenariats avec des institutions culturelles du Grand-Duché, car on ne sache pas qu’au Luxembourg la presse soit mille plus florissante qu’ailleurs, et pour un tirage affiché de 7.500 exemplaires, avec un prix de vente de 3 €, avec le peu d’insertions publicitaires que comporte ce numéro spécial, on ne voit guère quel peut être la recette de son équilibre économique. Certes, le gouvernement luxembourgeois poursuit une politique favorable aux médias, notamment par un subventionnement à travers un généreux système d’aide à la presse écrite, mais ça ne suffit. De fait, dans ce numéro spécial se côtoient présentation de certains musées, entretiens avec des galeristes, directeurs d’institutions culturelles, et jusqu’au « dynamique libéral » ministre luxembourgeois de la Culture (et lui-même collectionneur), Xavier Bettel, ex-président du Parti Démocratique. C’est ce qui s’appelle « servir la soupe », même si la marmite est emballée de toutes les précautions d’usage : « Faut-il acheter des œuvres ou les montrer ? Faut-il engager des médiateurs pour expliquer l’art exposé, des conservateurs pour le classifier, le gérer et développer des expositions pour le montrer ou des responsables communication pour en faire la promotion ? Comment faire pour attirer de nouveaux publics et fidéliser les anciens ? Comment trouver des mécènes et des sponsors pour étayer les budgets de programmation et jusqu’où faut-il suivre leurs revendications ? Les musées doivent-ils être un lieu de contemplation hors du monde ou faut-il, au contraire, les ouvrir à toutes sortes d’événements, concerts, soirées people, dîners, mariages... »
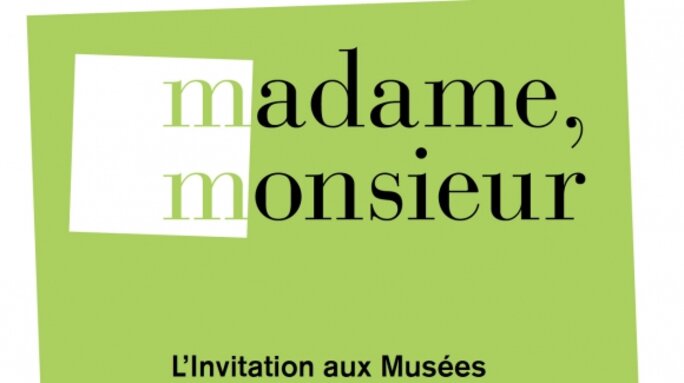
Une petite lueur de mauvaise conscience aurait-elle agité la rédaction du Land ? Toujours est-il que ce numéro spécial se clôt, en dernière page, par une tribune dézingue-tout de Josée Hansen, responsable des pages culturelles du journal. Sous le titre « Embedded », ce texte renferme visiblement un « sous-texte » que l’on a peu de mal à identifier. En effet, l’opinion qui y est exprimée (de façon fort confuse, tant l’article dit une chose et son contraire) soulève des points de débat intéressants, mais semble être traversée par une forme de bile, de rancune, dont l’origine reste mystérieuse. Première question, donc : d’où parle son auteure ? Avouant humblement (bien qu’ayant dirigé pendant 20 ans Mouvement, revue artistique et culturelle pas seulement franco-française), j’avoue que le nom de Josée Hansen n’était encore jamais parvenu jusqu’à mes oreilles… J’ai donc fait une petite recherche sur Internet. J’aurais ainsi été intéressé de connaître ce que tweete Josée Hansen, mais « seuls les abonnés confirmés ont accès aux Tweets et au profil complet de @Josee_Hansen », ce qui est un peu étrange : quand on entend participer au débat public, on ne limite pas ses commentaires à ses seuls « abonnés ». Dans un entretien paru en janvier 2016 dans PaperJam à l’occasion de la parution de « Piccolo Mondo » (livre sur le monde de l’art au Luxembourg), Josée Hansen se présente ainsi : « Je côtoie le milieu culturel et le monde des arts plastiques en particulier au quotidien depuis plus de 20 ans maintenant. »
« Je trouve qu’il y a une grosse fatigue dans le monde de l’art en ce moment au Luxembourg », dit Josée Hansen dans cet entretien. Cette phrase m’en rappelle d’autres, dans d’autres contextes proches, en France : des journalistes qui « dénonçaient » la fatigue, l’essoufflement, l’usure, de telle ou telle part de la création contemporaine, sans dire aux lecteurs qu’eux-mêmes, journalistes, étaient « fatigué-e-s », « usé-e-s ». Je me souviens ainsi, alors que je travaillais au Théâtre de la Bastille, en 1995, d’un long article (1 page) paru dans Le Monde, où la journaliste écrivait : « Le théâtre de la Bastille a cessé de joué son rôle de découvreur de jeunes talents qui fut le sien dans les années 1980 ». Étrange : je venais d’y programmer pour la première fois à Paris, Meg Stuart, Alain Platel, Joao Fiadeiro, Caterina Sagna, Jérôme Bel, Raimund Hoghe…, que la journaliste en question n’était pas venue voir… J’envoyai une bafouille à la rédaction en chef du Monde, que j’avais intitulée « La concierge est dans l’escalier, où est la critique ? » Cela me valut quelque réprimande du directeur du théâtre de la Bastille, mais le rédacteur en chef des pages Culture du Monde me rappela, et nous convînmes d’un déjeuner avec la journaliste en question. Lors de ce déjeuner, alors que je m’étonnais de ce qu’elle avait pu écrire sans avoir mis les pieds depuis plusieurs mois au théâtre de la Bastille, elle reconnut : « c’est vrai, je suis fatiguée, je n’ai pas tellement envie de découvrir de nouveaux chorégraphes. » J’obtins tout de même qu’elle s’engage à venir voir, les jours suivants, le second spectacle de Jérôme Bel (Jérôme Bel) : elle fit un long article, où elle lança le « concept » (erroné) de « non-danse »…
Bref, je ne sais pas si Josée Hansen est atteinte du même syndrome de « fatigue », mais cela se sent un peu, quand même… Sans la connaître, je vois la photo de son profil tweeter : mèche rebelle, encapuchonnée. J’apprends qu’elle use, pour son travail photographique (elle est donc à la fois journaliste ET artiste), du pseudo « Trash Picture Company ». Du coup, je comprends mieux l’allusion à la « contre-culture » qui traverse son article. Voilà un débat intéressant (qu’en est-il aujourd’hui de la contre-culture ?), et le livre du philosophe canadien Alain Deneault (La Médiocratie) qui sert d’accroche à l’article de Josée Hansen, nourrit utilement ce débat.
Mais après ? « Vous publiez ce livre aux éditions d’Lëtzebuerger Land avec la collaboration de l’asbl artcontemporain.lu. Vous avez aussi eu une aide du Focuna. Mais aucune aide d’une des institutions », questionne la journaliste de PaperJam, ce à quoi Josée Hansen répond : « Non, car j’ai voulu rester libre et indépendante, ne surtout pas avoir de ciseaux dans la tête. On peut me reprocher d’être trop subjective, mais c’est vraiment une volonté de ma part. » En quoi le fait de recevoir une aide ou une subvention de la part d’une institution publique ruinerait-il la liberté et l’indépendance de l’artiste (ou de l’auteur) ? Vieux débat… Pour ma part, je constate que souvent, ceux qui tiennent ce genre de « position » ont une rente de situation, une fortune personnelle, ou que sais-je, en tout cas une situation confortablement installée, bourgeoise, qui les dispense d’avoir à affronter les ciseaux des censures économiques (comment je fais pour bouffer, pour payer une location, pour rémunérer les collaborateurs avec qui je choisis de travailler, etc.), autrement plus redoutables… Faut-il nécessairement, comme le dit Josée Hansen, « mener [des] projets avec trois bouts de ficelle et deux clous », pour avoir son brevet d’authenticité et de radicalité ? En d’autres termes : il est urgent de maintenir les artistes dans la plus grande précarité (le « marché de l’art » se frotte déjà les mains) pour garantir leur superbe « indépendance ». Une telle assertion vient ruiner un siècle (au moins) de combats d’artistes pour une meilleure reconnaissance sociale de leur travail, comme elle vient ruiner plusieurs décennies d’instauration de politiques publiques de la culture, à travers des « institutions » publiques qui font vivre (notamment en matière d’art contemporain) un contre-espace nécessaire au seul marché de l’art. Tout n’est pas parfait, certes ! Mais faut-il pour autant, comme le fait si abruptement Josée Hansen, jeter le bébé avec l’eau du bain ? Son point de vue, en tout cas, est celui d’une anarchiste radicale pour qui seuls les capitaux privés des collectionneurs d’art (« comme Patrick Majerus, qui a donné l’année dernière plus d’œuvres au Mudam que le musée n’a pu en acquérir lui-même ») auraient de véritable valeur. Pour le moins paradoxal !
C’est faire montre d’un singulier mépris envers les « politiques » qui ont eu, et ont toujours, le courage (loin de la « démagogie » dont on les taxe souvent) d’engager des fonds publics importants en faveur de la création contemporaine. Mais sans surprise, pour préparer son ouvrage Piccolo Mondo, Josée Hansen confie ne pas avoir daigné les rencontrer : « Pour réaliser ce livre, je me suis entretenue avec près de 70 personnes. Mais pas les politiques, je les ai volontairement mis de côté, parce que, sincèrement, je n’attends pas de grande déclaration en ce moment sur la politique culturelle. Et je voulais rester dans le milieu de l’art. » En somme chacun chez soi, et les vaches (maigres) de l’art contemporain seront bien gardées et continueront d’enfanter le veau d’or du marché de l’art !
Car, s’ils acceptent d’être accueillis par des institutions telles que le Casino ou le Mudam, au Luxembourg, voire à la Biennale de Venise, les artistes seraient forcément « embedded » et contraints de se plier au régime de « l’entertainment » et de « faire des projets plaisants, décoratifs et inoffensifs. » « Le plus révoltant, c’est la servilité des artistes dans la politique officielle », ajoute Josée Hansen qui rend l’exemple flagrant du cinéma (et la Palme d’or que le Festival de Cannes vient de décerner à Ken Loach pour Moi, Daniel Blake, tout comme la Caméra d'or, attribuée à Divines, de la réalisatrice franco-marocaine Houda Benyamina, ne suffiront sans doute pas à calmer son courroux). J’imagine, en tout cas, que Josée Hansen pourra porter cet intéressant débat au sein du Conseil d’administration du Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean où elle siège, « embedded », sans que cela lui semble poser de problème, ni au regard de l’appréciation qu’elle porte sur les institutions publiques, ni davantage au regard des plus élémentaires règles de déontologie professionnelle : comment peut-on à la fois être journaliste-critique d’art dans un grand hebdomadaire (le d’Lëtzebuerger Land) et accepter de siéger au conseil d’administration de l’une des plus importantes institutions d’art contemporain, qu’elle a charge de « couvrir » en tant que journaliste ? Vu de France, le Luxembourg recèle de bien étranges mystères…
J’ai posé la question au gérant et rédacteur en chef du d’Lëtzebuerger Land, Romain Hilgert, tout comme je lui ai proposé de publier dans les colonnes du Land mon commentaire à l’article de Josée Hansen : sur ces deux points, silence radio. Les aides publiques luxembourgeoises dont bénéficie le d’Lëtzebuerger Land doivent, paraît-il, garantir l’indépendance et la liberté de la presse. Mais juqu’à un certain point seulement : il ne faudrait quand même pas exagérer !



