
Agrandissement : Illustration 1

La guerre de conquête que livre la Russie en Ukraine est un turning point dans la mondialisation. Le soutien sans fioritures de la junte birmane, la neutralité de l’Inde dans les instances internationales, les déclarations tièdes du Brésil de Bolsonaro qui revient d’une visite à Moscou montrent qu’une affaire mondiale se joue dans la bataille de Kiev.
Si des conflits éclataient sporadiquement en Afrique et en Asie, le monde croyait l’Europe immunisée après deux guerres mondiales dont elle fut le moteur, l’enjeu et la victime. Le marché commun européen passait pour une méthode de pacification des rivalités nationales. Il était le support publicitaire du « doux commerce », le slogan inspiré par la lecture de Montesquieu.
« Pendant la guerre froide, les analystes ont souvent dit que plus l'Union soviétique et l'Occident devenaient économiquement imbriqués, moins il était probable que des conflits surgissent », rappelait, le lendemain de l’invasion, Patricia Cohen, sur le live . du New York Times, « le commerce – et l'intérêt économique – feraient en fin de compte des alliés de tout le monde. Aujourd'hui, l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial de la Russie, représentant 37% de son commerce mondial en 2020, et reçoit un tiers de son énergie de la Russie. Mais le revers de la médaille de l'intérêt mutuel est la douleur mutuelle. »
LES INVERSIONS DE LA MONDIALISATION
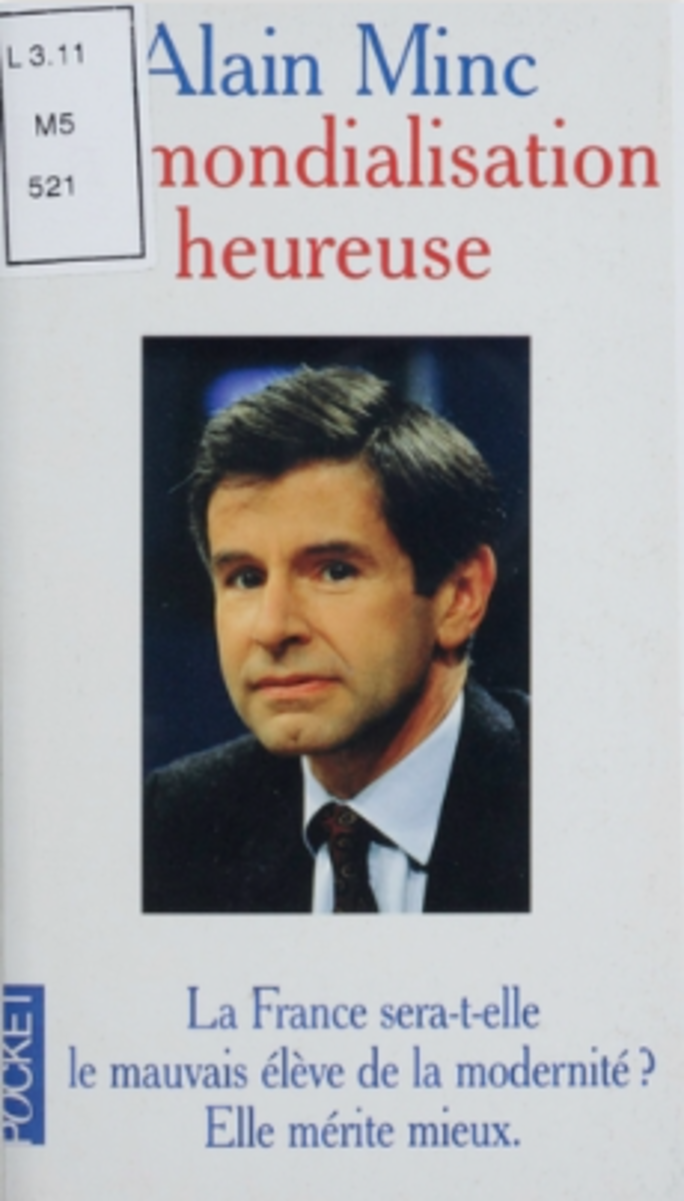
La douleur de la guerre déchire le grand récit de la fin du 20ème siècle, au moment où implosait l’Union soviétique, celui de Francis Fukuyama de « la fin de l’histoire » et d'Alain Minc d’une « mondialisation heureuse » comme un long fleuve tranquille. Heureux les lendemains de la mondialisation pilotée par les Etats-Unis depuis les années Reagan ? Comment oublier les crises et les guerres qui avaient sonné le glas de celle conduite par le Royaume Uni de la reine Victoria. Comme alors les accords de libre-échange fleurissaient et les échanges internationaux se multipliaient. D’ailleurs, des économistes rappelaient que les flux nets de capitaux n’étaient guère plus importants à la fin du 20ème siècle qu’en ses débuts.
Mais, entretemps, « la belle époque » s’était inversée en une époque maudite, d’abord avec les crises de Tanger et d’Agadir entre les puissances européennes qui frôlèrent la guerre, en 1905 et 1911, puis, encadrant la crise économique de 1929, les guerres mondiales à l’issue desquelles l’Europe perdit la place qu’elle avait conquise au centre de l’histoire mondiale.
Aussi, au début du 21ème siècle, bravant la nouvelle doxa de la fin de l’Histoire, quelques social scientists, comme Suzanne Berger, nous incitèrent à tirer des leçons de « Notre première mondialisation, un échec oublié » et de ne pas sombrer dans la béatitude de la mondialisation heureuse. En vain.
Certes, à l’échelle de la planète, la pauvreté marque le pas, voire régresse, la Chine devient une superpuissance économique tirant parti au mieux des négociations de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce. Mais, comme au début du 20ème siècle, les forces libérées par le libéralisme économique sont si puissantes qu’elles ébranlent les structures nationales – étatiques et culturelles- et que la mondialisation se retourne contre elle-même.
Certes, comparaison n’est pas analogie. À la toile des chemins de fer tissée à travers le monde s’est substituée celle d’Internet. Aux marchands de canons, les Krupp et Schneider, ont succédé des savants atomistes qui métamorphosent une guerre mondiale en apocalypse la rendant raisonnablement impossible. L’Europe n’étant plus au centre du monde, on espérait un polycentrisme mondial plus raisonnable. À tout le moins, les européens pouvaient espérer vivre paisiblement à l’écart des grandes tensions mondiales.

Agrandissement : Illustration 3

L’HORIZON DE LA GUERRE
L’inversion de notre mondialisation est engagée depuis des années. En regard de la standardisation et des inégalités charriées par la mondialisation, les idéologies identitaires, prenant appui sur le malheur des déshérités et des marginalisés, ont repris de la vitalité, les unes plus culturelles s’appuyant sur la religion, les autres plus politiques sur la nation. Cette montée des contradictions a débouché sur de nombreux conflits : les guerres civiles qui déchirèrent l’ex-Yougoslavie, le Rwanda, l’est de la république du Congo, la destruction des Twin Towers à New York, la guerre de l’OTAN en Afghanistan, l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, la brève irruption du califat de l’État islamique au Levant. Cette énumération incomplète est suffisante pour attester de l’inversion de la mondialisation, du basculement du « doux commerce » vers la guerre.
Comme être surpris quand le chauvinisme grand-russe s’en prend à l’Ukraine alors que dans notre continent le nationalisme et le racisme, sous des formes modernisées, redeviennent des forces d’importance ? Sans doute notre croyance dans la pacification du monde par le marché mondial est une des explications du choc qui nous a ébranlé au matin où le fracas des missiles et des bombes déversées sur l’Ukraine nous a réveillés. Le moment du « doux commerce » est derrière nous. Et notre « belle époque » avec.
Et, sans doute, avons-nous sous-estimé la perte de prestige des Etats-Unis tant par sa conduite de cette mondialisation que par l’épisode Trump ?
Vladimir Poutine tire profit des contradictions de la mondialisation qui, en trois décennies, ont sapé le consensus dans « la république impériale » des Etats-Unis. Des segments importants des ouvriers américains anxieux des délocalisations industrielles vers les pays aux bas salaires, énervés de la stagnation de leur pouvoir d’achat quand Wall Street flambe, enragés d’être doublés dans les priorités du parti démocrate par les femmes, les afroaméricains, les hispaniques basculent vers l’ethno-nationalisme et l’isolationnisme de Donald Trump. La guerre culturelle entre la nouvelle droite et la nouvelle gauche y fait rage. Cet affaiblissement intérieur de la superpuissance américaine s’est dupliqué sur la scène internationale avec l’échec des guerres d’Afghanistan et du Moyen-Orient. Vladimir Poutine, tire profit du signal géopolitique de cet affaiblissement que fut le départ de l’armée américaine d’Afghanistan.
Mais de Kaboul à Kiev, d’un siège à l’autre, c’est une autre guerre qui vise tout autant, sinon plus, l’Union européenne que les Etats-Unis. D’où le rôle inusité que prennent Ursula von der Leyen et Josep Borrell dans la bataille diplomatique, la conception des sanctions économiques et les livraisons d’armes. Sans aucun doute, le siège de Kiev teste notre détermination d’européens quand, depuis plusieurs jours, le président Volodymyr Zelensky demande à nos dirigeants une adhésion immédiate de l’Ukraine à l’Union européenne.




