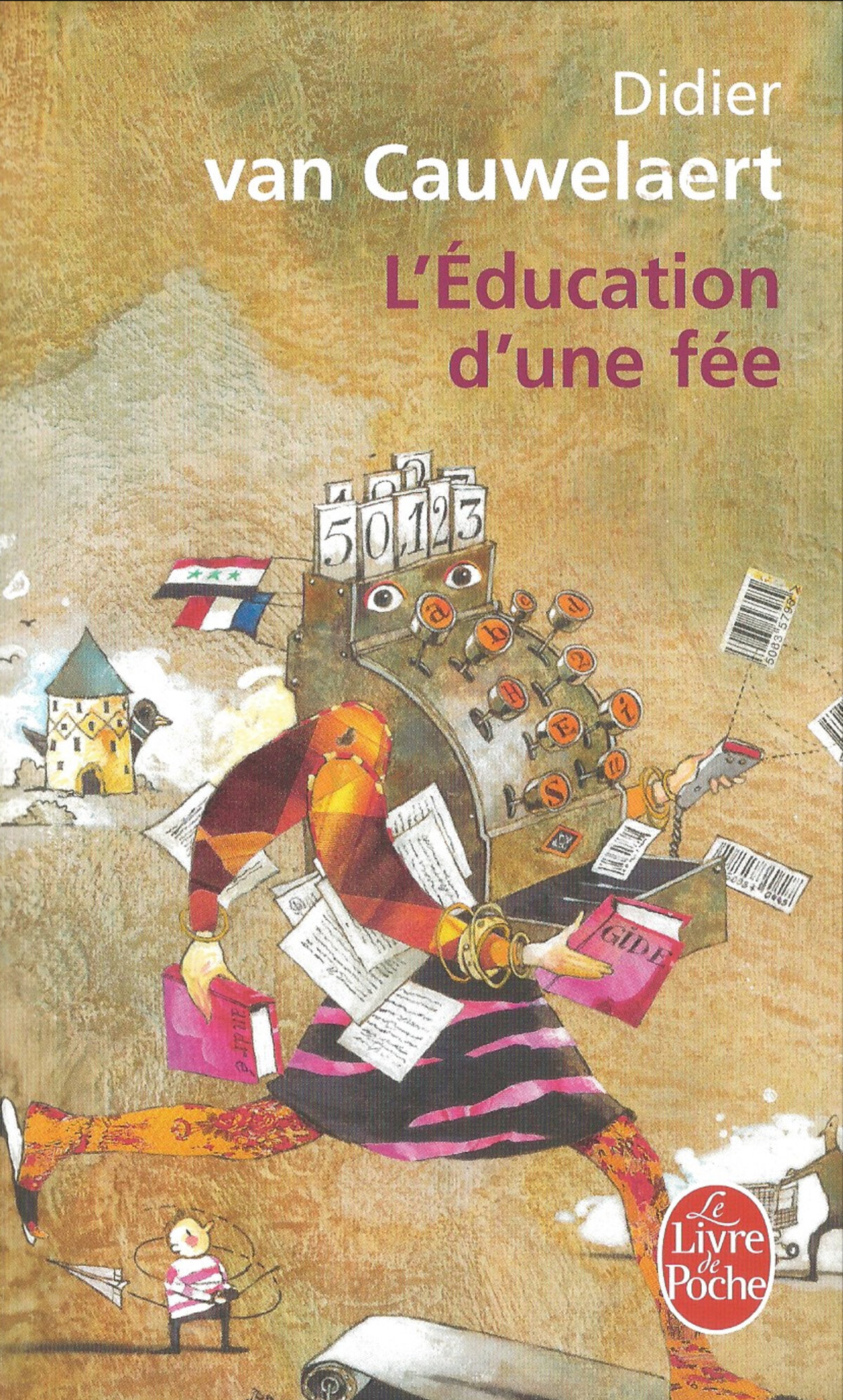
Agrandissement : Illustration 1
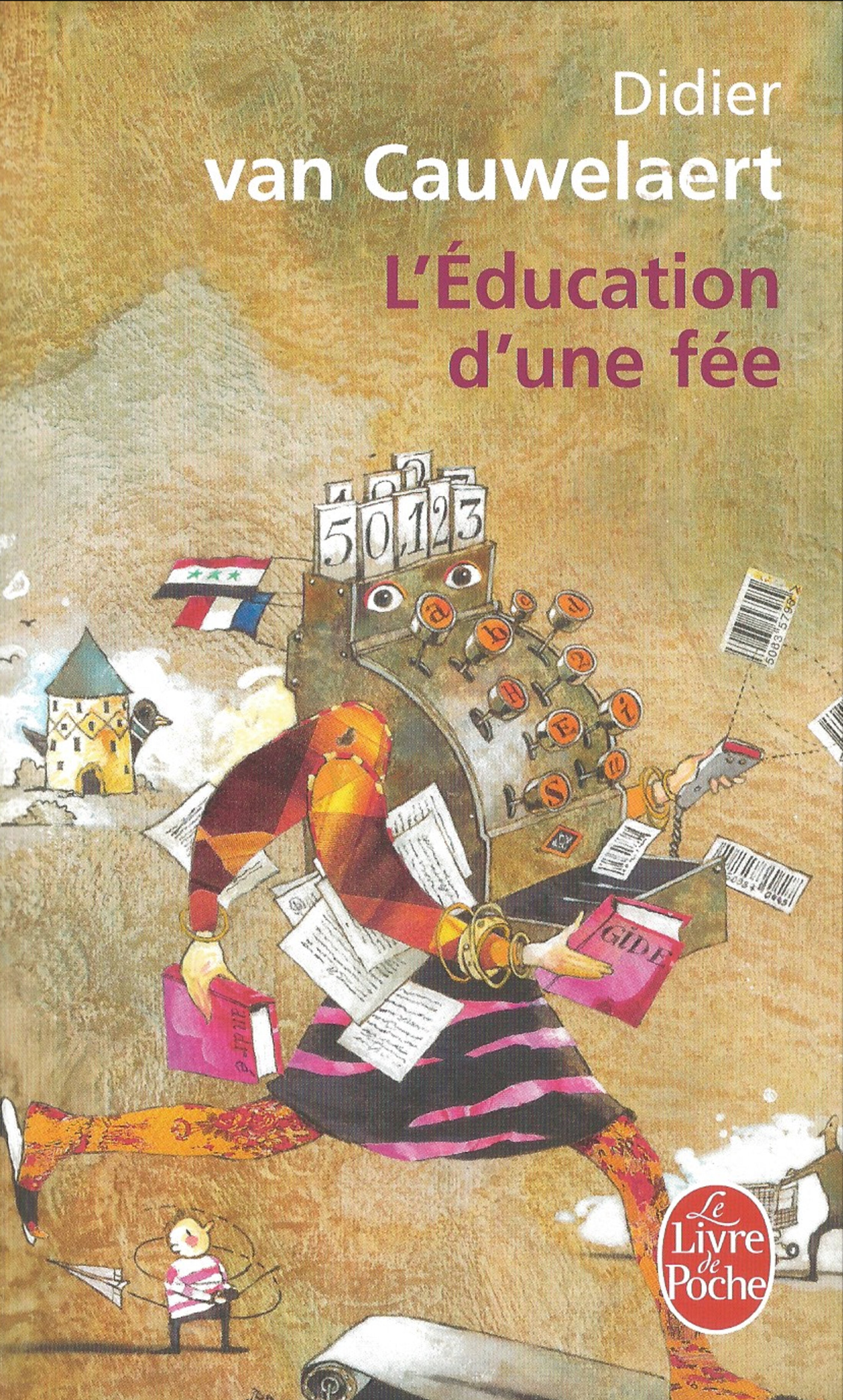
Ce titre m’a accroché, définitivement contaminé que je suis par l’école des sorciers de J.K. Rowling. Sorcière, fée, c’est parfois synonyme, parfois antonyme, le plus souvent c’est deux choses différentes. D’ailleurs, dans Harry Potter, la « fée » n’est qu’une créature magique parmi d’autres. Mais qu’il s’agisse d’un sorcier ou d’une sorcière, d’une fée, d’un enfant, d’un adulte, l‘initiation passe toujours par la vie, par le livre, par la littérature. L’école, on y apprend la science, les pouvoirs, la sagesse, et c’est littérature.
Sezar, la fée de Didier van Cauwelaert, en raison d’une histoire racontée par son père adoptif Nicolas à un garçon de huit ans, va être éduquée, par l’enfant. Le roman est à deux voix. Celle de Nicolas, et celle de Sezar. « Sezar » est un prénom kurde. Mais à la caisse où elle rencontre Nicolas, elle porte un badge « César », son chef ayant estimé qu’il fallait franciser. Le chef, c’est un cas.
Je vais consacrer plusieurs articles à Sezar. Sacrée femme, avant d’être une fée. Insoumise à un chef, insoumise à Mouss et Rachid. Mais soumise à son étude, à ses études, interrompues, qu’elle rêve de continuer à la Sorbonne française. Il ne lui reste plus qu’à y soutenir son « Devoir de joie dans l’œuvre d’André Gide ».
Mais le premier concerne l’incipit, et c’est Nicolas qui parle.
_________________________________
Je suis tombé amoureux de deux personnes en même temps, un vendredi matin, dans un bus d'Air France. Elle est blonde, en tailleur noir, les traits tirés, les yeux rougis, l'air à la fois concentré et absent, les doigts crispés sur la poignée de maintien au-dessus de sa tête. Il est tout petit, avec de grosses lunettes rondes à monture jaune, des cheveux noirs collés au gel qui se redressent en épis, et un chasseur bombardier Mig 29 de chez Mestro dans la main droite. De son autre main il s'accroche à la jupe de sa mère, qui descend de quelques millimètres à chaque secousse, découvrant peu à peu sa culotte bleu pâle. Inconsciente du spectacle qu'elle offre, le corps en extension ballotté par les cahots du bus, elle laisse aller son regard au-dessus des têtes d'hommes d'affaires qui suivent machinalement la progression du strip-tease entamé par son petit garçon.
Tout en elle m'attire et me bouleverse : son chignon qui se défait avec des langueurs d'algue, ses yeux bleus délavés, sa beauté ravagée par les larmes, son alliance au bout d'une chaîne entre des seins qui essaient de se faire oublier ; ce contraste émouvant entre la dignité qu'elle affiche et l'excitation qu'à son insu elle provoque. Et lui, à peine trois ou quatre ans, les lèvres gonflées et la gorge vibrant au bruit des réacteurs de son bombardier, il a cette allure reconnaissable entre mille du rêveur buté, du petit solitaire par défaut qui s'invente un monde clos où il voudrait bien que les autres le suivent.
— Hier, avec Papy, dit-il en atterrissant sur l'épaule d'une commerciale absorbée dans sa conversation portable, on est allés voir un bateau de guerre américain.
— Sauf si Asahi Glass nous cède son verre acrylique, réplique la femme en chassant le bombardier d'une chiquenaude.
— Ratatatata ! riposte le Mig 29 en redécollant, avec une gerbe de flammes en plastique sorties de ses mitrailleuses.
L'ennemie lui tourne le dos.
— Il était si grand que, même avec mon avion, j'aurais pu me poser dessus, insiste le petit garçon en prenant à témoin le comptable assis sur la banquette d'en face. Alors je descendrais, et le capitaine il me demanderait...
— Tu embêtes les gens, Raoul, lui dit sa mère avec une tristesse solidaire qui me noue la gorge.
Le comptable écarlate proteste avec un air de flagrant délit, détourne son regard du ventre nu qui oscille à la hauteur de son nez et replonge dans ses colonnes de chiffres.
— … Le capitaine il me demanderait : « Ça va, Raoul, t'as bien fait la guerre? »
— Ne dis pas ça, chéri. C'est dégoûtant, la guerre. On ne la fait jamais « bien ».
— Ça sert à quoi, alors ?
Elle cherche une réponse, désarmée, rencontre mon sourire. Je viens de passer trois jours en séminaire à Monte-Carlo, j'ai oublié d'ôter mon badge «Hello ! my name is Nicolas Rockel (France) » et je ressemble, costume-cravate-portable, à tous les cadres environnants. Sauf que j'ai l'air déguisé, mon visage de Viking échoué, mes cheveux sans coiffure et ma barbe de six jours démentant, je l'espère, l'accoutrement classique sous lequel je protège ma personnalité lorsque je dois convaincre les pisse-froid chargés de cibler, tester et rentabiliser le fruit de mes délires.
— Ça sert à quoi, alors, la guerre ? insiste Raoul.
— Vous me permettez de lui répondre ?
À peine surprise par mon intervention, elle esquisse un mouvement d'épaules qui traduit moins l'approbation que le renoncement. J'enchaîne, tandis que le bus s'arrête au pied de la passerelle :
— A rien, Raoul. Ça ne sert à rien, la guerre. C'est pour ça que les hommes la font. En partant se battre, ils ont l'impression d'échapper à tout ce qui les retient : leur travail, leur famille...
Elle me dévisage d'un air glacial, en détournant de moi l'enfant captivé par mes paroles, le pousse vers les portes du bus qui se sont ouvertes.
— C'est malin de lui dire ça, me glisse-t-elle entre ses dents. Son père vient de se crasher en Bosnie.



