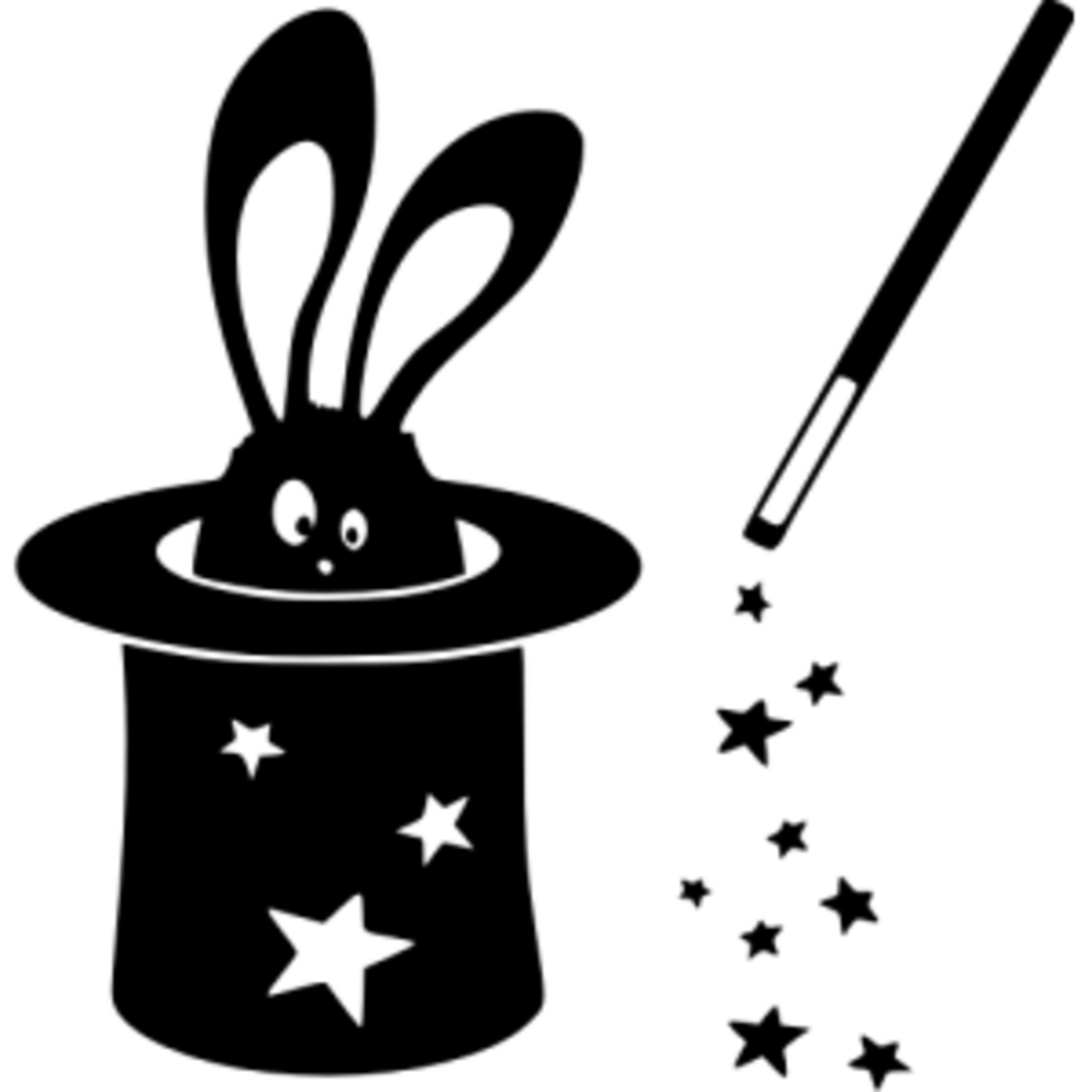
Patrick Rozenblatt est sociologue du travail, a été directeur de l’Institut d’Etudes du Travail de Lyon et co-fondateur de la Chaire Egalité, Inégalités et Discriminations (université de Lyon 2). Militant des mouvements sociaux depuis quarante ans, il a été notamment, dans les années quatre-vingt-dix, un des fondateurs du mouvement Agir ensemble contre le chômage (AC !).
Interview à propos de son ouvrage, Razzia sur le travail (Critique sur l'invalorisation du travail au 21e siècle), qui vient de paraître, aux éditions Syllepse.
À propos du mot « Razzia », les dictionnaires renvoient à l'idée d'une attaque surprise d'une grande violence, avec des synonymes terribles comme « rafle », « raid », « rapine », « pillage », « sac »... Pourquoi as-tu titré ton livre : « Razzia sur le travail » ?
Le mot razzia à propos du travail m’est apparu un jour comme une évidence pour synthétiser ce que j’observais depuis longtemps, dans une perception d’abord diffuse puis systématique, à savoirl’appropriation massive et gratuite du travail, hors le statut de l’emploi salarié.
Ton livre fournit au lecteur et à la lectrice de nombreux exemples concrets de cette « appropriation massive et gratuite du travail », peux-tu nous en citer quelques-uns ?
Je prendrai deux exemples emblématiques que chacun-e peut vivre au quotidien.
Il fut un temps, pas si lointain, où, pour faire le plein de ma voiture, j'avais affaire à un pompiste dont c'était l'emploi. Il exerçaitce travail sous un statut salarié, touchait un salaire et cotisait avec son employeur aux régimes de santé et de retraite. Puis l’emploi a été supprimé... mais le travail à faire lui n’a pas disparu, il m’a été tout simplement transféré !
Me voilà donc obligé d'effectuer des tâches – un travail – dont était auparavant chargé un travailleur salarié. Et c'est moi maintenant qui doit respecter strictement le processus d’organisation qu’un « employeur » m’impose comme si j’étais son « salarié ». J’y suis strictement subordonné et si quelqu’un doute de mon analyse qu’il essaie de se servir autrement qu’en suivant les règles prescrites !
Second exemple, au même moment et au même endroit, après avoir fait des courses tu peux désormais soit passer à une caisse avec une employée avec qui tu partages déjà un peu le travail (tu portes et présente les objets ce qui n’est pas rien), soit faire toi-même la totalité du boulot. Le terme de caisse automatique est là très trompeur puisque tu es obligé de suivre le même processus de travail que la caissière qui travaille aussi à quelques mètres toi. Où va le bénéfice de cette externalisation du travail que nous contribuons alors à développer ? Ni aux caissières et ni à nous !
Ce faisant nous contribuons, si on accepte passivement ces mises au travail gratuites, qui touchent aussi des emplois complexes à forte valeur ajouté notamment avec l’expansion du numérique, à l’affaiblissement global de notre système de protection sociale.
J'invite chacun-e à penser à ce qu’il-elle fait, chaque jour, dans un nombre de situations de plus en plus étendues, que j’aborde dans le livre, où les entrepreneurs et les administrations, dans une logique capitalistique, ont externalisé leurs coûts de main-d’œuvre en nous mettant directement et gratuitement au travail.
Autrement dit, nous serions devenus, sans nous en rendre compte, des « invalorisé.e.s » du travail, comme le suggère le sous-titre de ton livre, non reconnus ni rémunérés comme tels ?
Exactement. La force de ce processus c’est qu’il nous soumet à des contraintes impératives de travail qui sont transférées vers nous et que nous ne pouvons éviter de faire sauf si nous décidions, ce qui montre qu’il s’agit bien d’un agir subordonné, d’employer, avec un contrat et un salaire, d’autres humains pour faire tous ces travaux à notre place
Mais si le travail que tu évoques a été transféré hors l’emploi il n'a pas pour autant disparu, alors où est passé la valeur produite ?
Le tour de magie du capital consiste à faire disparaître toutes références au cadre salarial : proportionnellement au temps travaillé, ni salaires, ni cotisations sociales ne sont versés ! Autant d’économies pour le capital, autant d'argent qu'il se met dans la poche, ni vu ni connu. Et imagines l’état de nos caisses en déficit, de notre « dette sociale », si depuis des années et années on avait mis en place une riposte à cette invalorisation du travail ! Nous vivons dans le déficit, mais ne serions-nous pas dans l’opulence si l’accumulation qui s’est faite, depuis une bonne cinquantaine d’années sur notre labeur, avait été transférée dans les bonnes caisses ?
L’invalorisation du travail serait une espèce de jeu de bonneteau sur l’emploi et le travail ?
C’est une très bonne image. Cette réalité – l'invalorisation du travail – fait violence au droit dit du travail qui encadre en fait l’organisation de l’emploi tout en s’appropriant les fruits du travail accompli, et cela sans que ses auteurs ne soient jamais inquiétés puisqu’ils avancent masqués dans leur rapine !
Comment expliques-tu que cette razzia sur le travail, son invalorisation, soit complètement absente de cette campagne présidentielle ?
À mon sens, dans cette élection, la réalité de ce qui affecte profondément la vie quotidienne de la très grande majorité n’est traitée que dans un cadre de pensée très conformiste. Au sujet du travail, on entend donc parler sous des formes variables de la résolution de l’équation croissance, emploi, chômage avec l’espoir pour certains d’une baisse du chômage grâce par exemple à l’expansion du numérique alors que cette expansion des formes d’automation ne pourra qu’accroître les formes de mise au travail externalisées. C’est de cela dont il faudrait parler afin d’inventer les reconnaissances économiques et sociales du travail gratuitement accompli.
Pourtant, un des candidats de la présidentielle, Benoît Hamon, parlait de taxer les robots, qu'en penses-tu ?
Dans les deux exemples cités, de la distribution d’essence ou des caisses, nous sommes face à des automates mais seul notre travail les rend opérationnels. Si l’idée nous venait de ne plus les utiliser, par une sorte de grève, le système productif s’arrêterait ! Soyons donc conséquent avec la réalité, avant de penser à la taxation des robots, faisons payer, en respectant tout simplement le cadre légal, tout le temps de travail que l’automation permet de mesurer.
Il n’y a aucune difficulté technique pour en évaluer la réalité, il suffit, en fonction de la position de l’emploi externalisé dans les classifications professionnelles, de branche et d’entreprise, de faire payer, en fonction du temps de chaque activité, un salaire et les cotisations sociales liées. Avec les automates la mesure est plus qu’exacte, sur un programme informatique il suffit d’afficher l’heure du début et l’heure de fin de l’activité comme sur une pointeuse !
On pense aussi aux syndicats, y a-t-il de leur côté une réflexion sur les questions que tu soulèves dans ton livre ?
Pourquoi les syndicats ne s’y attellent pas ? C’est plutôt à eux qu’il faut poser la question. Pour moi c’est impensable qu’ils n’aient pas perçu l’ampleur du phénomène ! À titre d’hypothèse, s’ils ne s’en sont pas emparés pour l’analyser et l’intégrer dans une pensée revendicative, voire alternative, c’est par peur ou angoisse que ce fil tiré ne les entraine dans une dynamique de remises en question permanentes.
Par exemple, si tout la valeur du travail razzié était récoltée qu’en ferait-on ? Il serait certainement difficile de l’attribuer directement aux invalorisé.e.s mais alors comment penser la redistribution ? Faudrait-il laisser la gestion aux politiques, aux « partenaires sociaux » ? Faudrait-il reconnaître les invalorisé.e.s comme une figure sociale ? On perçoit les remises en cause des frontières dans lesquelles le syndicalisme est et s’est installé institutionnellement.
Dans la même veine de réflexion, si le phénomène était reconnu et approprié par le mouvement syndical, pourrait-il continuer à considérer ces millions d’invalorisé.e.s comme n’ayant rien à voir avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent et les syndicats qui y existent. N’aurait-il pas alors à remettre en question le quant à soi dans lequel le syndicalisme évolue avec un droit dit du travail qui tend à ne plus considérer comme travailleurs que les employés des entreprises ?
Comment expliques-tu une telle cécité sur ce travail caché ?
Si on tire le fil de ce que je viens de dire, on peut penser que les catégories de chômeur comme celle d’inactif, si chères aux dominants et xénophobes, perdraient rapidement de leurs légitimités à diviser la population entre ceux qui contribuent à la production de richesse et ceux qui vivent à leurs crochets ! Ne pourrait-on pas à partir de là s’engager dans un processus de reconnaissance des apports de tous les membres de la société à la production de valeur ? Nos regards respectifs sur les uns, les unes et les autres ouvriraient alors sur une reconfiguration possible de nos valeurs sociales ! Si la razzia sur le travail devient un objet de débat public et est, au-delà de mon livre, massivement déconstruite et analysée, elle permettra de rendre imaginable une autre société d’activité et de bien-être mais c’est peut-être pourquoi ce travail est si bien caché !
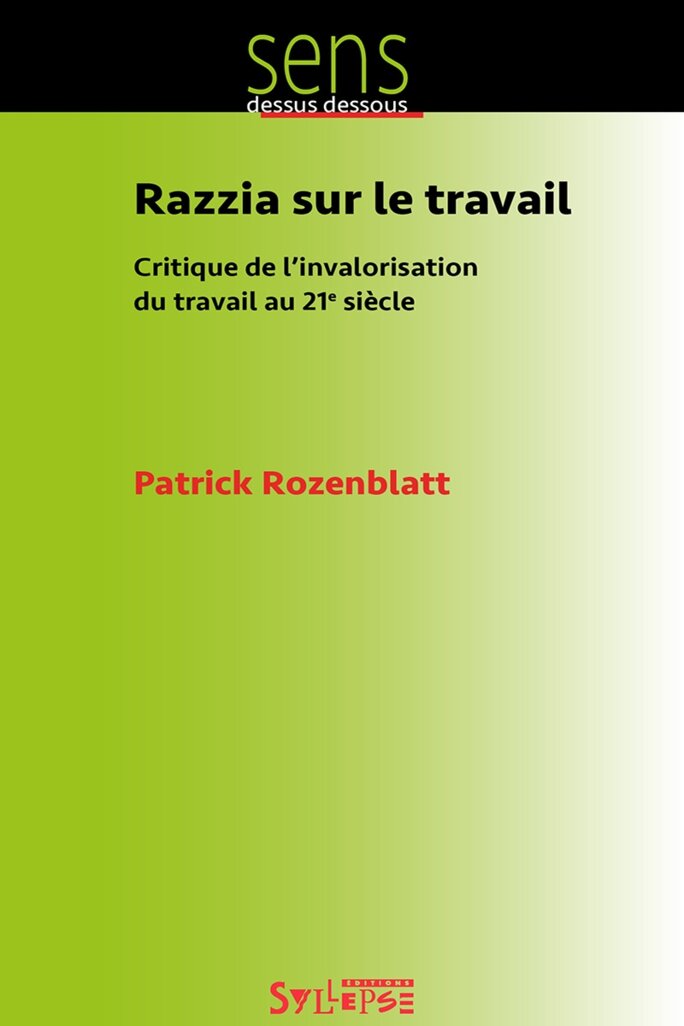
Agrandissement : Illustration 2
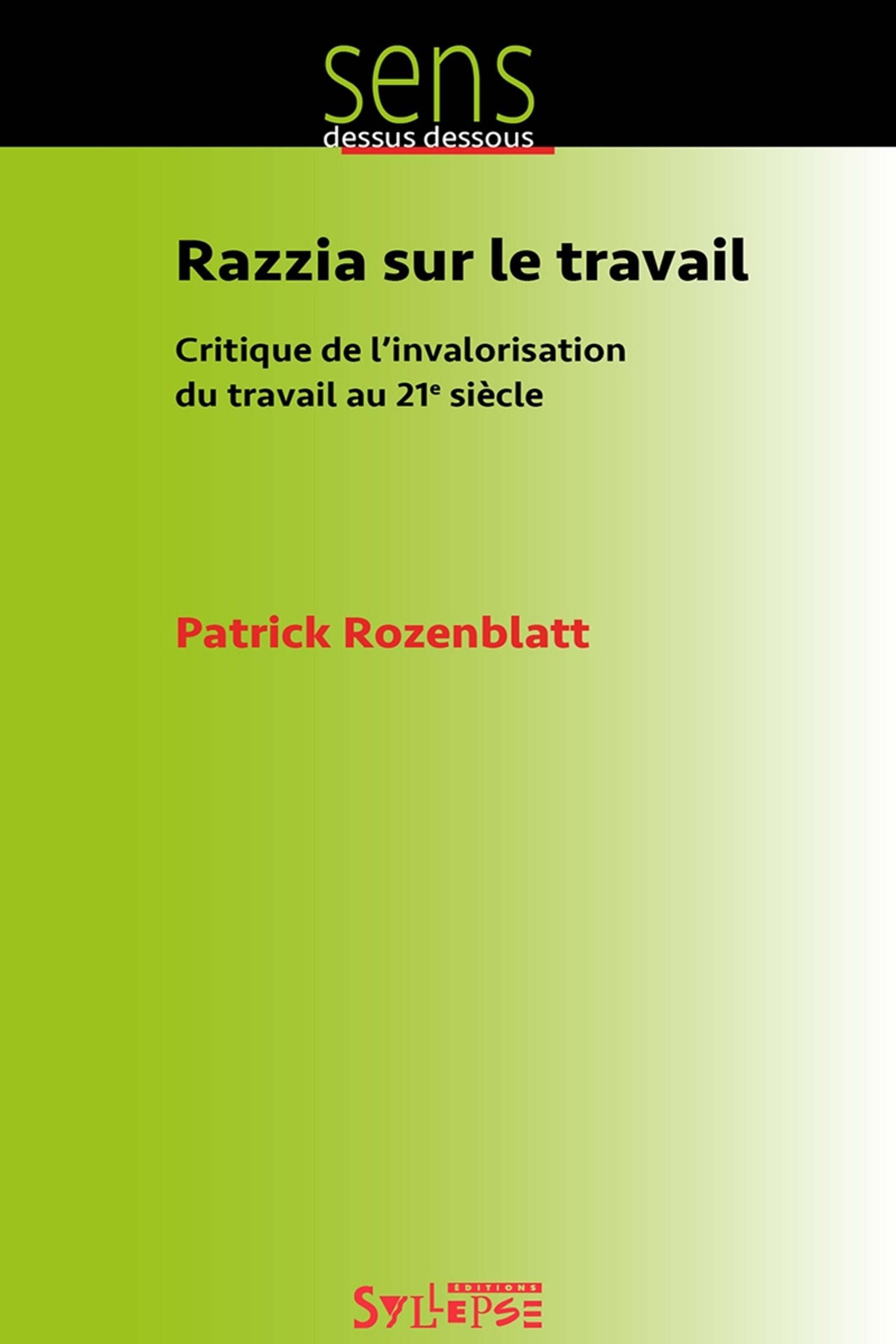
Razzia sur le travail, Critique de l'invalorisation du travail au 21e siècle
Éditions Syllepse (ICI) Collection Sens dessus dessous
160 pages, 10 euros



