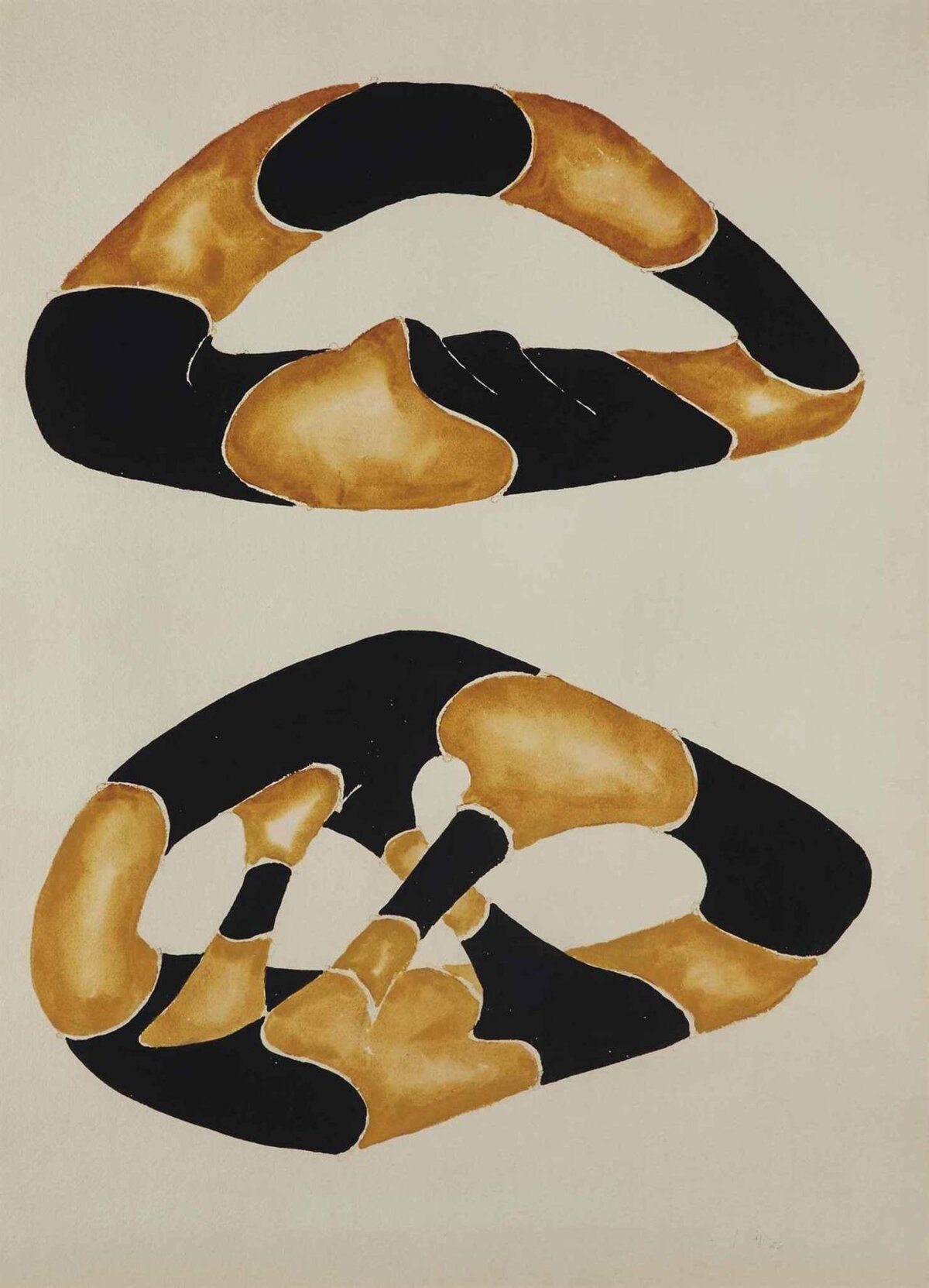
Agrandissement : Illustration 1

Les chercheurs généralisent à toute la population les premières évolutions sociales, alors qu’elles ne concernaient d’abord que l’élite lettrée
Je suis souvent étonné que des chercheurs chevronnés attribuent des mentalités à des individus de classes autres que celles qui étaient concernées. Comme j’ai pu vivre dans ces autres classes à des époques dont ils parlaient, j’ai pu constater qu‘ils ignoraient, de fait, les mentalités réelles de ces autres classes, leur attribuant celles des classes « supérieures » qui les ont vécu en premier…
Par exemple Farhad Khoroskhavar, sociologue qui travaillait sur le jihadisme des jeunes Européens : il parle de l’utopie qui aurait disparu de notre société contemporaine, de la philosophie des Lumières qui semble abandonnée et de l’égoïsme, nouveau, qui expliqueraient l’absence ou l’insuffisance de solidarité pour faire face aux aléas du nouveau monde… pour cause de la « déviance » des jeunes jihadistes occidentaux.
Je suis assez âgé pour avoir vécu les périodes précédentes dans des classes non élitaires : je sais pour l’avoir vécu, que l’on n’y vivait pas selon la philosophie des Lumières, ni sur une utopie quelconque et que l’égoïsme y était plus grand qu’aujourd’hui. La question (et la réponse) sont ailleurs.
La socialisation individualiste change l’assise existentielle des individus
Dans la société grégaire, sous toutes ses formes, les individus sont portés comme dans un cocon, ils n’ont pas à s’assumer seuls, ils ont juste à prendre leur place dans la hiérarchie.
Dans la société individualiste, ils doivent se socialiser de leur propre initiative, à égalité avec les autres ; cette égalité est extraordinairement exigeante, elle oblige chacun à « être égal pour seulement exister dans cette société-là ». Sinon ils sont exclus.
En 1945 entre 2/3 et 3/4 des Français vivaient encore selon des codes paysans, aujourd’hui seulement 4 à 5% des emplois dans les territoires ruraux sont des emplois agricoles, et les néo-ruraux ne connaissent pas les codes paysans, ils y vivent selon des codes urbains.
Pendant les 30 Glorieuses l’exode rural a déplacé des masses de paysans vers l’industrie, donc vers le « milieu ouvrier », et non vers la classe ouvrière qui est un terme militant politique. Donc un déplacement d’une structure grégaire, paysanne, à une autre structure grégaire, ouvrière.
À la fin des 30G la société paysanne avait disparu et le milieu ouvrier se défaisait avec l’avènement de la mondialisation : cette fois-ci, les derniers vestiges grégaires ont définitivement disparu.
Ainsi, les ouvriers puis les paysans devenus ouvriers ont perdu leur appartenance grégaire. Et les immigrés déjà exilés de leur société grégaire d’origine perdent à nouveau une appartenance sociale par laquelle ils s’étaient intégrés dans la société occidentale : si pour eux-mêmes, à leur âge, la difficulté n’est pas trop importante, pour leurs enfants c’est un handicap supplémentaire qu’ils ont à surmonter pour s’intégrer.
Les codes paysans ne devaient rien aux Lumières
Les codes paysans exprimaient les valeurs ancestrales de la société paysanne : les coutumes, droits coutumiers qui structurent sa hiérarchie grégaire et qui n’ont rien à voir avec les Lumières.
Le sociologue Henri Mendras disait que la société paysanne était une société toujours dominée par une société englobante, celle de l’Ancien-Régime puis ensuite la société bourgeoise-capitaliste.
Les Lumières représentent les valeurs en devenir de la société dominante, « englobante », et celles de la société individualiste en évolution. Je peux témoigner que les Lumières ne régissaient pas la société paysanne. Les Lumières ont « éclairé » la société par en haut, puis elles se sont diffusées au fur et à mesure que se développait la socialisation individualiste ; c’est par la disparition des dernières structures grégaires qu’elles atteignent l’ensemble de la société.
Ni l’humanisme ni les Lumières n’ont déterminé l’avènement de la société occidentale, ils l’ont accompagné seulement
C’est l’humanisme, avant les Lumières, qui a commencé à exprimer les valeurs de la modernité occidentale.
Notre droit occidental est devenu humaniste (Mireille Delmas-Marty), c’est à dire individualiste en ce qu’il affirme et défend la liberté, l’égalité et la légitimité de chacun, de chaque individu donc.
Qu’a fait l’Orient orthodoxe de l’humanisme qu’il a inventé ? Rien. Pourquoi ? Parce que l’évolution individualiste n’ayant pas eu lieu dans l’aire orthodoxe, il n’avait pas de sujets à qui il pouvait s’adresser. Tandis qu’en Occident, l’évolution individualiste en cours émancipaient les individus de leurs familles depuis des siècles, l’humanisme est arrivé à point pour formuler les attendus de la nouvelle « socialité » individualiste. Puis les Lumières ont continué en approfondissant ce droit individualiste.
Ce n’est pas l’utopie qui faisait vivre les paysans et ouvriers, c’était l’appartenance au groupe
La grande majorité des paysans et des ouvriers ne sont pas tenus par une espérance utopique ; ce sont les militants syndicalistes que l’utopie anime parce qu’ils cherchent à exercer un leadership sur les ouvriers.
Je peux témoigner qu’il n’y avait pas d’utopie dans la société paysanne, nous y vivions sur les valeurs de continuité ancestrale, non en attente d’un avenir radieux mais de permanence du passé.
En définitive, au lieu de s’adapter à la modernité individualiste, la société paysanne a disparu. Cela n’a pas causé trop de drames car la grande majorité des paysans étaient devenus des ouvriers et que les autres sont devenus agriculteurs au moment où l’agriculture se modernisait. Le drame est venu lors de la crise de l’agriculture intensive.
Partageant de manière massive une même condition sociale-salariale, les ouvriers vivaient portés par le groupe qui assurait leur sécurité existentielle. Leur vie était difficile certes, mais elle l’était pour tous, leurs difficultés étaient partagées. C’est leur grégarisme qui les sécurisait, et c’est ce grégarisme qui a disparu avec le « milieu ouvrier » à la fin des Trente Glorieuses, chacun se retrouve désormais seul et isolé pour affronter la précarité mobile de l’emploi dans la mondialisation.
-----------------------------
Autre exemple Hartmut Rosa, sociologue allemand, dans son livre Résonance, pour illustrer ses analyses dans l’histoire, cite des paroles de personnes, toutes de l’élite lettrée comme si elles étaient représentatives de l’ensemble de la population, alors que qu’elles n’étaient que la minorité qui vivait ces problèmes en premier, parce que cette élite lettrée était la plus évoluée, c’est-à-dire la plus individualisée, en avance sur l’évolution générale de la société.
XVIIIe siècle et XIXe siècle :
Kant 1724/1804 - Goethe 1749/1832 - Schiller 1759/1805 - Scheiermacher 1768/1834 - Humboldt 1769/1859 - Hölderlin 1770/1843 - Hegel 1770/1831 - Novalis 1772/1801 - Eichendorff 1788/1857 - Schopenhauer 1788/1860 - Heine 1797/1856 - John Stuard Mill 1806/1873 - Kierkegaard 1813/1855 - Thoreau 1817/1862 - Marx 1818/1883 - Mallarmé 1842/1898 - Nietzsche 1844/1900 - Freud 1856/1899 - Durkheim 1858/1917 - Simmel 1858/1918 - John Dewey 1859/1952 - Max Weber 1864/1920 - Proust 1871/1922 - Paul Valéry 1871/1945 - Hugo von Hofmannsthal 1874/192 - Rainer Maria Rilke 1875/1926
Hartmut Rosa cite tous ces personnages au long de ses analyses, ce sont des membres de l’élite lettrée de leurs époques respectives : leur sensibilité, leur mentalité ne ressemblent pas à celles de l’ensemble de la population de ces mêmes époques. Ils sont en fait les précurseurs de la société future ; effectivement, l’ensemble des différentes populations qui composent la société finiront par rejoindre ces précurseurs, mais longtemps, très longtemps après.
L’élite est pionnière
Dans l’évolution sociale, les changements premiers concernent d’abord l’élite, pendant que le reste de la société continue à vivre selon les mentalités anciennes. Ce n’est que plus tard que ces classes non élitaires accèdent aux changements. Et l’erreur que commentent ces chercheurs est d’attribuer à l’ensemble de la société ce qui ne concerne que l’élite. C’est-à-dire que ces changements sont les mêmes pour tout le monde, mais qu’ils atteignent certaines classes avant d’autres, qui sont pionnières en fait.
En étant pionnières, ces élites préfigurent l’avenir de la société. Mais la très grande majorité de la population continuait à vivre selon les préceptes de la société grégaire où c’est le groupe qui prime sur les individus.
En fait, l’individualisme des Lumières n’a commencé à être vécu par l’ensemble de la population qu’après la fin des Trente Glorieuses, lorsque les derniers vestiges des la société grégaire - société paysanne et milieu ouvrier - avaient disparu.
Désormais, les mentalités et les droits grégaires ne commandent plus la vie de notre société, nous sommes tous devenus exclusivement individualistes… et notre équilibre collectif individualiste n’est pas encore acquis, à mon avis.
Au contraire, chaque fois que nous sommes en difficulté, chaque fois que notre « socialisation individualiste » est en difficulté, nous revenons à des comportements grégaires : bandes de jeunes, xénophobies, démarches d’appartenance à un groupe, façons d’affirmer son identité par opposition à d’autres, etc. Ainsi, chaque fois que notre socialisation individualiste est en difficulté, notre « vivre ensemble » est remis en question et avec lui, l’équilibre social tout entier.
La tentation du retour en arrière est très dangereuse parce qu’il est impossible, et que cette impossibilité sacrifie à la fois le présent et l’avenir. Malheureusement, c’est ce retour en arrière qui semble être la bonne réponse.
Jean-Pierre Bernajuzan



