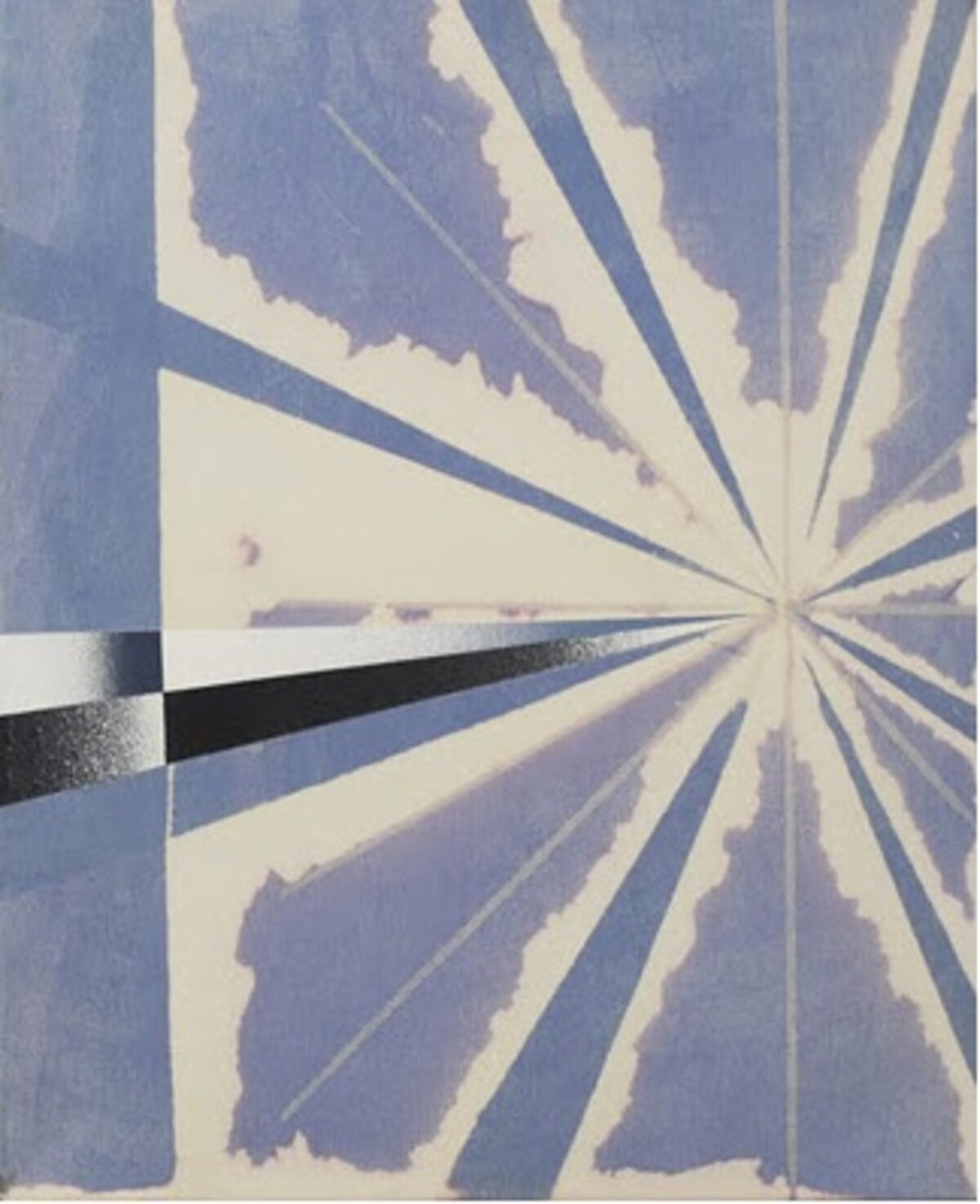
Bernard Lahire a publié « Savoir ou Périr » au SeuilLibelle.
Il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre Max Weber/ENS de Lyon, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, et fondateur du Groupe Edgar Théonick. Auteur de nombreux ouvrages, il dirige aux Éditions La Découverte les collections Laboratoire des sciences sociales et Sciences sociales du vivant.
Pour une espèce aussi culturelle qu’Homo sapiens et dont la survie dépend désormais d’une masse de savoirs extraordinairement variés et complexes, la transmission scolaire et la création continue ne sont pas des questions sectorielles, elles sont vitales. Or, on ne peut que constater et déplorer que les faibles moyens alloués au système d’enseignement et aux organismes de recherche, de même que le fonctionnement actuel du système scolaire et des conditions dans lesquelles se fait la recherche scientifique, constituent des freins objectifs à l’apprentissage comme à l’avancée des connaissances.
Un système scolaire aux programmes surchargés, qui ne laisse pas toujours le temps de l’approfondissement ou de l’intériorisation durable des connaissances, et qui est entièrement piloté par l’évaluation, alors que celle-ci n’aurait dû rester qu’un simple moyen de s’assurer de la bonne acquisition des connaissances par les élèves ; un système scolaire qui trie, oriente et sépare les élèves en filière, cursus, établissements plus ou moins nobles ; un enseignement supérieur semestrialisé, qui réduit le temps d’apprentissage des étudiants et leur autonomie de pensée, avec l’objectif de rentabilité à court terme ; des institutions académiques qui retirent aux chercheurs et enseignants-chercheurs la denrée la plus précieuse en matière scientifique - le temps, nécessaire à tout apprentissage et à toute création véritable ; la mise en concurrence généralisée des élèves, des étudiants et des chercheurs, qui rend difficile la coopération, l’entraide et la circulation des informations, des pratiques et des ressources : tel est le champ de ruines laissé par des décennies de politiques scolaires et scientifiques menées par des technocrates de la « réforme ». Responsables politiques de tous bords, hauts fonctionnaires dans les ministères, managers dans les universités et institutions de recherche, ceux qui gouvernent l’enseignement et la recherche n’ont manifestement aucune idée de ce que sont les conditions d’un apprentissage réussi et d’une recherche libre, indépendante et inventive.
Le savoir, c’est la survie
Comme n’importe quelle autre espèce, l’espèce humaine a dû affronter le problème de la survie. Si elle n’avait pas trouvé les moyens de « s’orienter correctement dans le monde » elle aurait tout simplement disparu. Cela signifie que les premières sociétés humaines n’ont pas pu vivre dans l’illusion permanente, les fausses croyances et la pensée magique, qu’elles disposaient d’un minimum de savoirs et de savoir-faire réalistes et efficaces, « congruents à la réalité », leur permettant d’interagir favorablement avec leur environnement.
Dès le début de l’humanité s’est donc posée la question de bien connaître la réalité et de veiller à ce que le « fonds de connaissance adéquates à la réalité, fussent-elles imprégnées d’imaginaire » puisse se transmettre, par imitation directe ou par des formes plus ou moins élaborées d’enseignement, d’une génération à l’autre. Sans ces savoirs et savoir-faire, et sans leur transmission, point de salut possible pour l’espèce.
Nous ignorons tout des groupes humains qui ont peut-être disparu. Mais nous savons que seuls ceux « possédant un fonds suffisant ajustés à la réalité ont survécu ». C’est ce fonds de connaissance qui leur a permis de se nourrir et de se protéger de leur environnement. Par exemple, le - smong » tradition ancestrale indonésienne, qui a permis aux habitants de l’île de Simeulue d’être très faiblement touchés par le tsunami de 2004, des chercheurs ont démontré que cette tradition avait été créée à la suite du tsunami datant de 1907. Les chercheurs parlent du smong comme d’un véritable manuel de survie.
Ces savoirs et savoir-faire doivent être acquis directement par les populations concernées.
La vie c’est l’apprentissage
Au sens large du terme, l’apprentissage est la capacité à prélever des informations sur soi ou sur son environnement, à les mémoriser, et à en déduire pratiquement des actions qui permettent de maintenir ou d’accroître sa survie. L’apprentissage est donc l’un des grands mécanismes fondamentaux du vivant.
Champions toutes catégories en matière d’altricité dans le règne animal, les humains possèdent à la fois de puissantes dispositions à imiter et une grande capacité symbolique leur permettant une grande souplesse et une grande complexité de communication. Au cours de leur histoire, ils ont inventé des moyens d’externaliser et d’accumuler une multitude de savoirs grâce à l’écriture. Lorsque la masse des savoirs scripturaux à maîtriser collectivement a atteint une certaine ampleur et un certain niveau de diversification et de complexité, une double nécessité s’est fait ressentir : tout d’abord, celle d’une « alphabétisation généralisée ». Puis celle d’une transmission systématique de ce patrimoine objectivé de connaissances dans des institutions - scolaires - séparées du cours ordinaire des activités sociales.
Là encore, une vision évolutive très large de la question d’apprentissage, qui traverse l’ensemble du vivant et occupe une place centrale dans la vie des humains, permet de comprendre à quel point les enjeux autour de la création continue des nouveaux savoirs et de leur transmission ne sont ni sectoriels ni secondaires, mais cruciaux pour la vie, et même la survie, des sociétés.
Enfance, curiosité, émerveillement
Ce besoin de savoir et cette nécessité d’apprendre ne sont que la marque de l’un des mécanismes fondamentaux du vivant dans sa totalité, auquel l’espèce humaine ne peut se soustraire.
Chez l’humain, espèce altricielle s’il en est, dont le développement extra-utérin nécessite des interactions sociales permanentes, l’appétit de savoir, la curiosité et le désir d’explorer, d’expérimenter et de découvrir s’expriment sur une très longue période, et se signalent dès l’enfance.
La psychologie de l’enfant a bien montré le besoin chez le bébé humain d’une exploration sensori-motrice (Jean Piaget, Henri Wallon) du monde qui l’entoure, avec de nombreuses manipulations d’objets saisis, jetés, portés à la bouche, durant une période pré-langagière où s’exprime une « pulsion de savoir ». Puis il marche et il agrandit sa zone de découverte. C’est dans l’action, le geste, qu’il commence à faire connaissance de son environnement et à le maîtriser. La pulsion exploratrice se manifeste aussi dans le jeu - en tant que répétition d’actions sans implications directes, comme une sorte d’entraînement permanent - dès la période infantile, de même que de nombreuses espèces animales.
Grâce au langage, l’enfant humain exprime son puissant désir de comprendre ; la période des « pourquoi ? » entre trois et six ans en est l’expression. Le désir insatiable de savoir chez l’enfant, de la manipulation à l’interrogation, relève d’une nécessité de base.
On pourrait dire que le « besoin de savoir » est présent autant chez les végétaux que chez les animaux, chez les insectes ou les poissons que chez les oiseaux et les mammifères. Et c’est cette nécessité inscrit dans la logique du vivant qu’ignorent les technocrates de l’éducation et de la recherche qui ne voient dans l’apprentissage qu’un moyen « d’insérer professionnellement » les individus et de fournir de la main-d’œuvre compétente à exploiter. Une vision à courte vue, qui réduit l’enseignement et le savoir à leur seule rentabilité économique et à la satisfaction étroite d’intérêts particuliers.
Libido sciendi de l’enfant et création scientifique
L’enfant est curieux et ne craint pas le ridicule en osant formuler des questions que plus personne ne se pose.
« La découverte est le privilège de l’enfant. C’est du petit enfant que je veux parler, l’enfant qui n’a pas encore peur de se tromper, d’avoir l’air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n’a pas peur non plus que les choses qu’il regarde aient le mauvais goût d’être différentes de ce qu’il attend d’elles, de ce qu’elles devraient être, ou plutôt de ce qu’il est entendu qu’elles sont. Il ignore les consensus muets et sans failles qui font partie de l’air que nous respirons - celui de tous les gens sensés et bien connus comme tels. (Grothendieck. I, p. 197-198) »
C’est la même curiosité qu’il observe chez les plus grands savants qui continuent, malgré la masse des savoirs qu’ils acquis, à s’émerveiller, à s’interroger et à rechercher, en se distinguant de beaucoup de professionnels qui semblent sûrs d’eux et « revenus de tout » :
« L’adulte aussi découvre, en ces rares instants où il a oublié ses peurs et son savoir, quand il regarde les choses ou lui-même avec des yeux grands ouverts, avides de connaître, des yeux neufs - des yeux d’enfant. (Grothendieck. I, p.198)
Désir de savoir et pédagogie
Ce que Grothendieck relève chez le petit enfant, c’est cette ouverture maximale au monde, ce désir viscéral de comprendre. Toute pédagogie qui détruirait ce terreau serait nécessairement vouée à l’échec.Croire que l’imposition de connaissances scolaires, sans prise en compte des questionnements de l’enfant, de son envie de savoir ou de sa curiosité, peut suffire à obtenir un bon apprentissage est une illusion.
Albert Einstein s’étonnait déjà que les méthodes rigides d’enseignement de son temps « ne soient pas encore parvenues à étouffer complètement la sainte curiosité pour la recherche. Il serait une grave erreur de croire que la joie de l’observation et de la recherche peut croître sous l’effet de la contrainte et du sens du devoir ».
Des études psychologiques montrent que le niveau de curiosité des enfants tend à diminuer considérablement au moment où ils entrent à l’école, pour chuter à l’âge d’entrée dans le secondaire. Pour résumer, les enfants naissent curieux et les institutions chargées de l’enseignement, qui sont censées aiguiser leur soif de savoir, contribuent paradoxalement à en tarir la source. Programmes et classes surchargés, faible niveau d’interaction interindividuelle enseignant/élève, accélération des séquences d’enseignement qui diminue le niveau de participation, discipline collective qui impose des temps de silence, peur de l’examen, de la faute à la mauvaise note, tout concourt à refroidir les enthousiasmes.
La solution pédagogique optimale ne se trouve ni dans une pédagogie de l’autonomie qui idéalise l’ « Enfant » et ses capacités à aller seul, ni de la pédagogie verticale et autoritaire, qui fait fi de la curiosité dont l’enfant est capable.
L’idéal serait de bâtir des apprentissages sur la base d’une curiosité stimulée par des situations pédagogiques, et de combiner recherche semi-autonome, accompagnée et guidée, formulation par l’enseignant et les élèves des résultats de cette recherche, et retours réguliers sur des questions analogues pour consolider les acquis. Plus l’enfant se sentira concerné par ce qu’il apprend et plus il s’impliquera dans ses tâches scolaires en acceptant les aspects les plus rébarbatifs de l’apprentissage.
Retrouver le sens des priorités
L’inversion des priorités entre l’objectif d’apprentissage et l’objectif d’évaluation des connaisses est le plus destructeur des aspects du système scolaire. Ce qui n’aurait dû rester qu’un simple moyen de s’assurer de la bonne compréhension des élèves est devenu un objectif central, et même une obsession : évaluer, noter, classer, hiérarchiser et trier/sélectionner les élèves objectivement mis en concurrence. Piloter l’institution scolaire à partir de l’objectif de l’évaluation des élèves, c’est lui ôter sa raison d’être et le vider de sa substance et de son sens. C’est aussi détruire le désir de savoir des élèves, le contraire de ce qu’il faudrait faire. Les enseignants sont aussi victimes de ce système, car nombreux sont ceux qui cherchent à les motiver, et c’est contre leur gré qu’ils doivent s’y soumettre (« bachotage ». Autrement dit : hantise de l’examen et du classement). Mais tout le monde, progressistes compris, semble s’y être habitué.
On assiste donc à un renversement : l’apprentissage devient le moyen, et l’évaluation la fin : les évaluations nationales et internationales (PISA OCDE) n’exploitent que cette fin. Puis, tout à coup, on se rend compte que les résultats s’effondrent…
Le plaisir d’apprendre, la curiosité, l’émerveillement ? Préoccupation de doux rêveurs. Les cyniques, les « réalistes » ou les convaincus des vertus de la concurrence se voient comme des êtres lucides et conscients des dures réalités économiques. Le miracle est qu’une partie des élèves puisse continuer à être curieux, à avoir envie d’apprendre et de créer ; et qu’une toute petite minorité ait envie de se diriger vers la recherche.
Les plus grands chercheurs.cheuses qui avaient la science chevillée au corps, ont refusé les prix et autres distinctions.
Alléger les programmes, ralentir le processus d’apprentissage
L’un des problèmes récurrents de l’enseignement est l’obligation pour les enseignants de traiter tout le programme, au risque de forcer les cadences et de privilégier la quantité sur la qualité, et notamment la solidité des acquisitions. Marc Bloch s’en plaignait déjà, trop de connaissances à acquérir, au lieu de développer la capacité de raisonnement. Encore une fois, les plus grands scientifiques ont résisté à un système scolaire qui donne trop de choses à apprendre, en décourageant les élèves qui cherchent vraiment à comprendre.
Tout l’enjeu ici est dépasser l’opposition stérile entre les partisans du savoir et ceux des compétences. Les capacités de raisonnement ne se forment jamais indépendamment des savoirs particuliers.
Alléger les programmes pose donc le défi de décider du minimum de contenus fondamentaux à conserver pour pouvoir apprendre à raisonner avec eux.
Prendre le temps
Le temps est une donnée fondamentale de tout apprentissage, comme de tout processus créatif. Prendre le temps d’explorer, de « patauger » avant de pouvoir commencer à comprendre : le temps est la denrée la plus rare et la plus précieuse, autant pour l’adulte qui enseigne que pour l’élève qui apprend que pour le savant qui, tout en continuant à apprendre, crée à son tour de nouvelles connaissances scientifiques.
L’obsession actuelle des institutions académiques concernant les thèses de doctorat, avec l’injonction de plus en plus marquée à soutenir en trois ou quatre ans, est révélatrice de la méconnaissance profonde chez ceux qui imposent ces règles, des conditions de la création scientifique, variables selon les domaines. De cette manière, il s’agit plutôt de terminer la thèse, plutôt que de « trouver » quelque chose de nouveau ; ce qui produit une recherche de confirmation de l’existant plutôt que l’invention de nouveaux paradigmes. Alors qu’elles devraient veiller à ce que leurs membres puissent régulièrement se soustraire au monde et s’arracher au flux incessant des sollicitations extérieures pour pouvoir se dédier entièrement à la création, elles participent elles-mêmes à l’émiettement du temps de travail créateur. Et la carrière des chercheurs est aiguillée de cette façon. En plus, certaines bonnes âmes cherchent à dresser les enseignants-chercheurs contre leurs collègues chercheurs en attaquent un « privilège » prétendument excessif et injustifiable : celui de consacrer tout son temps à la recherche.
Pour une autre organisation du travail scientifique
La création scientifique, comme n’importe quelle autre création culturelle, suit une loi de la connexion/combinaison/synthèse d’éléments préexistants. C’est pour cela que les historiens des sciences rappellent rituellement qu’il n’existe pas de génie individuel, et que, si génie il y a, celui-ci est nécessairement de nature collective. C’est en reliant des savoirs séparés, en les réarrangeant ou en les réarticulant d’une façon inédite, que ces savants parviennent à faire avancer leur science, à créer de nouvelles connaissances, et parfois même de nouveaux cadres de pensée. Ceux qui opposent le travail de synthèse à la percée révolutionnaire et géniale de quelques visionnaires ont une vision romantique et totalement faussée de l’activité scientifique. Car les révolutionnaires scientifiques sont toujours de grands synthétiseurs, qui ont trouvé la façon de relier et de mobiliser d’une façon claire une masse considérable de travaux et de résultats de recherche.
Pour comprendre cette solidarité entre la synthèse et l’étude spécialisée, il suffit de penser à la théorie de la sélection naturelle de Darwin qui s’appuie sur des faits de nature très différentes - zoologiques, botaniques, physiologiques, anatomiques, morphologiques, embryologiques, éthologiques, « écologiques » - établis par des centaines de chercheurs avant lui, mais dont le cadre permet d’unifier le champ des sciences du vivant et de structurer chacune des spécialisées portant un aspect ou un autre de telle ou telle espèce vivante.
Résister pour créer
Qu’est-ce qu’un bon chercheur ?
Il s’agit d’abord d’un chercheur ayant pu bénéficier de bonnes conditions d’apprentissage, et qui s’est trouvé ensuite placé dans les bonnes conditions pour créer du savoir. Une grande partie de ces conditions dépend de la nature des contextes scolaire/universitaire et scientifique dans lesquelles ont évolué les individus, lesquels sont le produit de toute une histoire des politiques scolaires et scientifique, et de la nature des acteurs fréquentés, enseignants, camarades, collègues. Et une plus faible part, mais qui fait souvent la différence, à résister aux mauvaises conditions auxquelles on est plus ou moins confronté.
Les « bons chercheurs » sont ceux qui parviennent à résister aux forces de dispersion internes ou externes au milieu académique, aux sollicitations extra-académiques comme aux demandes académiques contre-productives, aux modes scientifiques du moment, aux autorités et aux consensus établis qu’ils pensent discutables, aux injonctions à regarder seulement là où tout le monde dit de regarder ou à ne pas regarder dans certaines directions, aux tentatives plus ou moins explicites de découragement ou d’intimidation, à l’enfermement dans une spécialité ou une discipline, et, enfin, à la tentation de vouloir plaire à tout le monde, séduire un auditoire, un comité de rédaction ou un jury.
Sur ce dernier point, on peut remarquer que le conformisme et la docilité commencent très tôt à l’école et se poursuivent tout au long de la vie professionnelle. Les raisons de se montrer docile sont multiples et ne cessent jamais totalement au cours d’une vie de chercheur. Ce n’est pas une question de choix personnel mais de questionnement collectif, car tout le monde est tenu, à un moment ou à un autre, étant donné les enjeux qui se présentent à lui, de donner des gages de conformisme. Finalement, le plus probable est que, à force de différer indéfiniment la prise de risque par peur de perdre l’estime et le soutien d’un milieu, on finisse par mourir avant d’avoir pu montrer un quelconque signe d’indépendance.
Dans un monde scientifique idéal, la capacité de résister devrait faire partie du patrimoine de dispositions professionnelles de tout chercheur ; elle devrait être acceptée et encouragée par les institutions académiques elles-mêmes. Celles-ci devraient être accueillantes à tous ceux/celles qui aiment prendre des risques, qui ont envie de faire bouger les lignes, et ne craignent pas d’affronter la doxa d’une communauté qui croit avoir fixé définitivement les limites du pensable, et qui formule des interdits et décrète des impasses ; elles devraient pour cela à veiller à diversifier les profils des chercheurs recrutés, plutôt que de privilégier les élèves des « grandes écoles », pour « augmenter » les chances de trouver de esprits originaux, de brasser des idées, pais de créer une communauté vivante où les esprits sont plus libres, où il y a moins d’autocensure.
Toute institution cherche à se reproduire, à persévérer dans son être. Mais l’institution scientifique a quand même la vocation de renouveler et donc de dépasser les connaissances établies ; aussi elle tend à la fois à maintenir l’état de la doxa et à aller de l’avant, ce qui est contradictoire. Aussi célèbre-t-elle les gloires anticonformistes scientifique du passé… qu’elle n’a pas su reconnaître en leur temps.
Les premières forces (d’inertie) freinent les secondes (de rupture) et c’est instruite de ce paradoxe que toute politique de la recherche devrait être pensée. Une politique rationnelle de la recherche est une politique qui veille à la fois à reproduire les moyens ordinaires du métier de chercheur, et à soutenir les chercheurs qui rompent l’ordre scientifique existant (« science révolutionnaire »). Autrement dit, les institutions devraient paradoxalement conserver sans encourager le conservatisme.
L’institution scolaire et l’institution scientifique ne sont pas des options dont on pourrait se passer, ce sont des nécessités collectives adaptatives. C’est d’elles dont dépend la capacité des groupes humains à faire face à des difficultés ou à des crises de différentes natures. Créer et transmettre des savoirs sont la condition sine qua non de notre survie.
Dire cela ne signifie pas que l’on place aveuglément notre destin entre les mains toutes-puissantes d’une technoscience sans conscience. Car ces savoirs scientifiques dont dépend notre salut collectif, sont autant ceux des sciences humaines et sociales, qui accroissent notre intelligence des modes d’organisation sociale et des formes culturelles, et qui permettent d’imaginer quels leviers proprement culturels (savoirs, artefacts, pratiques, institutions) permettraient d’agir sur le monde autre que ceux de la matière et de la vie.
Dans cette période d’austérité économique où les coupes budgétaires ni l’enseignement ni la recherche, et où une « guerre contre la science » sans précédent est menée aux États-Unis, il est bon de rappeler les mots de Marie Curie :
« Toute collectivité civilisée a le devoir impérieux de veiller sur le domaine de la science pure où s’élaborent les idées et les découvertes, d’en protéger et encourager les ouvriers et de leur apporter les concours nécessaires. C’est à ce prix seulement qu’une nation peut grandir et poursuivre une évolution harmonieuse vers un idéal lointain ».
Muni d’une vision claire de ces enjeux vitaux, on comprend que tous ceux - présidents, ministres ou députés, représentants du patronat, éditorialistes ou journalistes, « Intellectuels », etc - qui, partout dans le monde, attaquent régulièrement le système scolaire/universitaire et les organismes de recherche ; qui contribuent à réduire leurs moyens matériels, leurs personnels, le temps d’apprentissage ou le temps consacré à la recherche, ne sont pas seulement des adversaires résolus des fonctionnaires, ou de simples propagateurs d’une idéologie anti-intellectualiste et parfois clairement anti-scientifique.
Le problème est en réalité plus grave. En s’en prenant aux institutions du savoir, ils portent une responsabilité majeure dans l’affaiblissement de l’ensemble des groupes humains. Par les politiques qu’ils soutiennent, ils diminuent nos capacités collectives de défense et de survie. Ils ne sont pas des « conservateurs », mais des destructeurs acharnés de nos conditions de vie présentes et à venir.
résumé de « Savoir ou Périr » de Bernard Lahire



