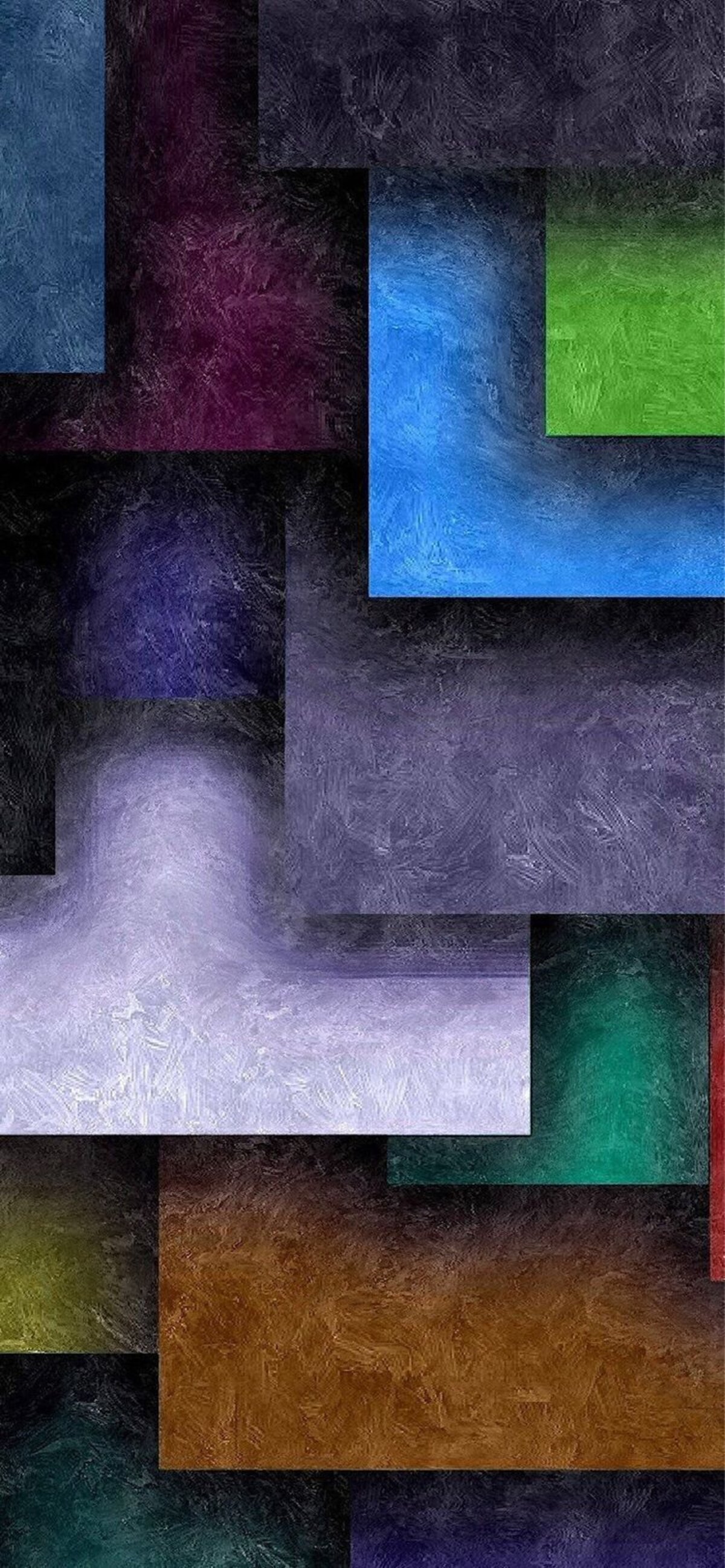
Agrandissement : Illustration 1

La légitimité est la valeur fondamentale sans laquelle les groupes humains, et aussi animaux, ne pourraient survivre.
Commençons par les animaux
On a observé qu’une horde d’une trentaine de hyènes poursuivant une proie, a été chassée de son territoire par un trio de hyènes…
Chez les animaux, mais pas seulement, le territoire est l’élément central de la légitimité : on se sent légitime chez soi, à contrario on se sent illégitime chez les autres ; et quand on se sent légitime on se défend avec plus de force que lorsque on se sent illégitime ; ce qui fait que le rapport de force n’est pas seulement de force pure. Il est évident qu’en force pure la trentaine de hyènes était plus puissante que le trio, mais elle se trouvait sur le territoire du trio, donc en situation illégitime… alors que le trio était sur son propre territoire, donc en situation légitime : la force pure multipliée par le coefficient de la légitimité a donné l’avantage au trio contre la trentaine.
Chez presque tous les animaux le territoire est le fondement de la sécurité, à partir duquel les relations s’établissent avec les autres groupes ; chez les humains il joue un rôle majeur aussi. Le territoire a d’abord été la légitimité fondamentale animale, et elle a logiquement continué dans la structuration des groupes humains.
Le territoire se conquiert par une compétition où les rivaux s’affrontent ; la victoire confère au vainqueur une légitimité pour sa domination sur un groupe avec ses femelles et son territoire : cette légitimité évite l’affrontement permanent, et le reporte à des périodes régulières, rut…, ce qui permet un fonctionnement du groupe à peu près apaisé dans l’intervalle.
- La conquête du territoire est donc une conquête de légitimité.
Chez les loups par exemple, le mâle qui a affirmé sa suprématie en gagnant son combat contre son rival devient avec sa femelle le couple dominant : il est le seul à procréer dans la horde. Les autres adultes subissent une « castration psychologique » (!) ils ne se reproduisent pas, ils deviennent des sortes d’oncles et tantes de la progéniture du couple dominant… jusqu’à ce que le mâle dominant soit à son tour vaincu ; on estime qu’un mâle reste dominant pendant 2 ou 3 ans, ensuite c’est le couple du nouveau vainqueur qui procrée.
- La légitimité est donc la « valeur » qui permet une continuité relativement apaisée de la vie animale entre deux périodes de compétition.
Les humains
- La légitimité est liée au groupe, à la société, à la communauté.
Si nous n’étions pas sociaux, c’est à dire si notre identité n’était pas déterminée par notre relation aux autres, nous n’aurions pas besoin de considérer, d’apprécier les différentes manières d’être, ni les différentes positions sociales ou politiques de chacun.
La vie des groupes humains dérive bien-sûr de la vie animale dont ils sont originaires, on y retrouve donc les mêmes caractéristiques, mais « enrichies » par le développement intellectuel-culturel proprement humain.
- La légitimité joue dans la vie humaine le rôle central de la pacification par la confiance qu’elle produit, pour la pérennité du groupe ou de la communauté, parce qu’il n’y a de vie humaine que sociale : il faut donc que cette vie sociale soit pacifiée pour qu’elle puisse se développer, s’épanouir.
Dans les groupes humains encore davantage, la compétition et la victoire servent d’abord à obtenir la légitimité sur laquelle les vainqueurs pourront asseoir leur pouvoir : sans cette légitimité ils seraient obligés de contraindre les membres du groupe ; ils exerceraient donc leur pouvoir contre le groupe ; leur pouvoir serait menacé en permanence, ils se défieraient de leurs administrés ; ils seraient obligés d’exercer une répression permanente qui susciterait la trahison.
Les sociétés humaines se structurent dans une hiérarchie ; cette structure hiérarchique repose sur la légitimité différenciée sur laquelle les échanges internes se développent. Cela peut sembler superfétatoire, mais imaginons qu’elle fasse défaut : on verrait qu’on ne peut plus se parler car on n’accorderait pas de crédit aux différentes paroles, tout échange et donc toute vie sociale deviendrait impossible.
- Chez les humains aussi, la victoire assure l’accession à une certaine légitimité.
Dans les sociétés archaïques, en tous cas pré-démocratiques, la victoire démontrant la supériorité de la force du vainqueur, que cette force soit celle : physique ou des armes, de l’intelligence, de la ruse, de la cohésion, du charisme… peu importe, c’est le résultat qui compte. Les populations sont alors soumises au vainqueur, sa victoire ayant relativisé ou aboli l’ancienne légitimité de l’ancien dominant.
Il y a la légitimité du vainqueur, mais il y a aussi les légitimités établies, permanentes de la société elle-même : soit le vainqueur s’installe dans ces légitimités-là, en les respectant ; soit il les subvertit, et en institue de nouvelles.
Les légitimités fondamentales qui règlent la vie des sociétés évoluent en même temps que les sociétés elles-mêmes. Agir, gouverner, consistera donc : soit à gérer ces légitimités pour l’harmonie générale, soit à les subvertir pour atteindre une autre harmonie-efficacité sociale-politique.
Dans les sociétés démocratiques la légitimité s’acquiert aussi par la victoire, électorale. Qui s’obtient en s’appuyant sur les légitimités déjà établies, mais en se projetant vers l’avenir, tentent d’en promouvoir d’autres : par exemple actuellement l’égalité homo-hétéro par le mariage pour tous, l’égalité homme-femme dans tous les domaines, le respect de l’enfant même s’il est dépendant et le respect de sa liberté…
L’autorité vient d’en bas
- Une autre valeur essentielle pour le fonctionnement des sociétés est l’autorité.
Elle est absolument nécessaire à tous les niveaux de la société, du plus haut niveau de l’État, jusqu’au niveau le plus ordinaire de la vie courante entre n’importe quels acteurs de la vie sociale ou professionnelle ; sans autorité, toute activité, tout comportement, toutes relations… seraient contraints, et ce serait invivable.
Or l’autorité repose sur la légitimité.
Et cette autorité ne s’impose pas, elle se reconnaît. S’il y a contrainte, il n’y a pas autorité.
Rétablir l’autorité n’est donc pas si facile : il s’agit d’obtenir l’adhésion, l’adhésion volontaire qui ne se contraint pas.
Puisque l’autorité se reconnaît, cela signifie qu’elle vient d’en bas, de ceux qui la reconnaissent, et non de ceux qui prétendent l’imposer d’en haut.
- Reconnaître l’autorité de quelqu’un, c’est lui reconnaître sa légitimité, dans sa fonction, dans son activité, sa responsabilité ; il peut bien avoir le pouvoir même légal, si sa légitimité ne lui est pas reconnue, il n’aura pas d’autorité et ne sera pas obéi.
Toutes populations peuvent reconnaître ou ne pas reconnaître la légitimité d’un responsable, la population civile d’un État, les salariés d’une entreprise, les administrés d’une commune, les enfants d’une famille, les membres de n’importe quelle collectivité…
La personnalité se construit par la légitimité
Si un enfant ne reconnaît pas la légitimité de ses parents et particulièrement celle du parent auquel il s’identifie, son père pour le garçon, sa mère pour la fille, ses parents n’auront pas d’autorité et seront impuissants par rapport à cet enfant qui subira les contraintes qu’on lui imposera, mais qui s’en défera dès que la contrainte cessera… et les parents échoueront dans leur tâche éducative.
- C’est l’enfant qui choisit l’adulte, le parent, auquel il s’identifie ; cette relation d’identification est une initiation où l’enfant se fait conduire par le parent auquel il s’identifie : on le comprend bien, cette initiation repose sur la légitimité qu’il accorde à ce parent. Sans légitimité, rien n’est possible.
Or dans cette identification initiatique, l’enfant « assimile » les frustrations que le parent initiateur lui impose, ce qui lui permet de maîtriser ses désirs ; faute de quoi, il restera en proie à des désirs inassouvissables, addictions, incapable d’accepter la réalité du monde, il ne pourra pas se socialiser.
- On le voit, la légitimité est au cœur de la vie de la société, comme à celui de la personnalité individuelle.
Jean-Pierre Bernajuzan



